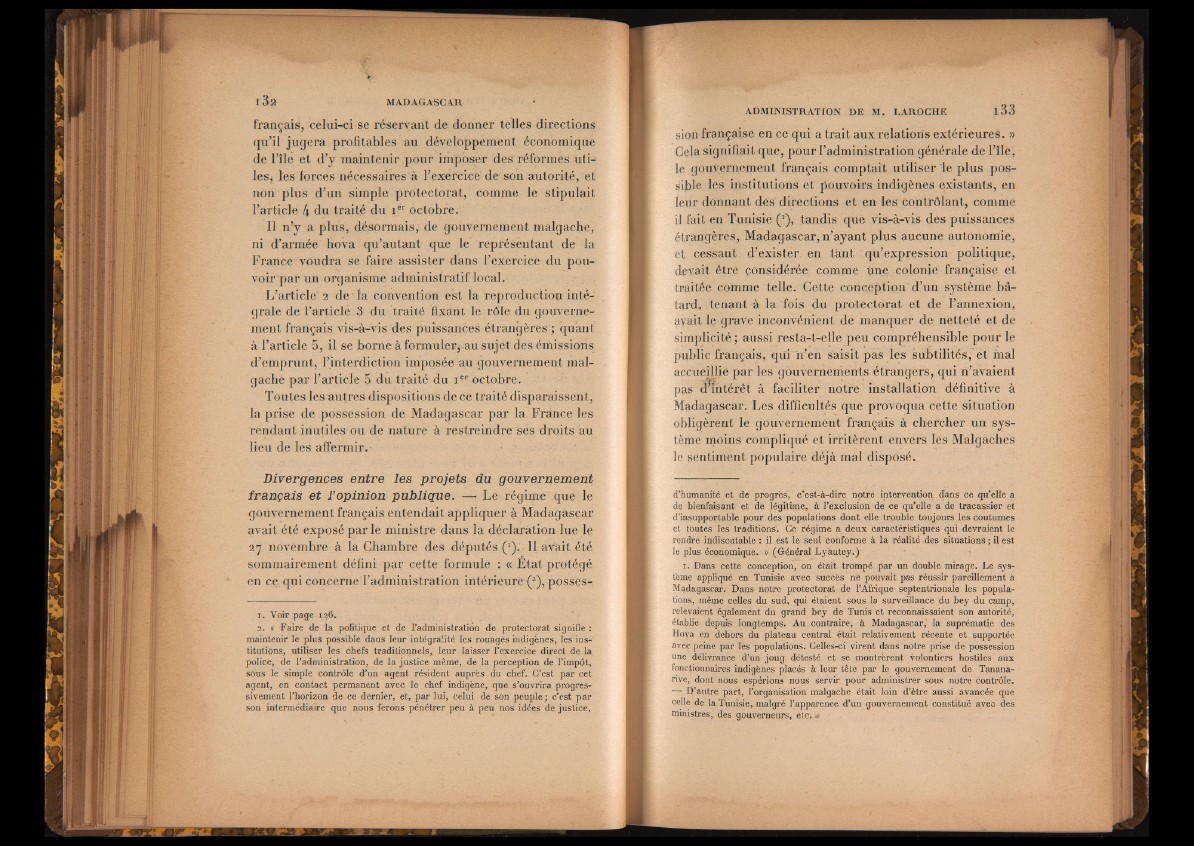
français, celui-ci se réservant de donner telles directions
qu’il jugera profitables au développement économique
de l’île et d’y maintenir pour imposer des réformes utiles,
les forces nécessaires à l’exercice de'son autorité, et
non plus d’un simple protectorat, comme le stipulait
l’article 4 du traité du Ier octobre.
Il n’y a plus, désormais, de gouvernement malgache,
ni d’armée hova qu’autant que le représentant de la
France voudra se faire assister dans l’exercice du pouvoir
par un organisme administratif local.
L’article 2 de la convention est la reproduction intégrale
de l’article 3 du traité fixant le rôle du gouvernement
français vis-à-vis des puissances étrangères ; quant
à l’article 5, il se borne à formuleiq.au sujet des émissions
d’emprunt, l’interdiction imposée au gouvernement malgache
par l’article 5 du traité du i er octobre.
Toutes les autres dispositions de ce traité disparaissent,
la prise de possession de Madagascar par la France les
rendant inutiles ou de nature à restreindre ses droits au
lieu de les affermir.
Divergences entre les projets du gouvernement
français et l ’opinion publique. —• Le régime que ;le
gouvernement français entendait appliquer à Madagascar
avait été exposé par le ministre dans la déclaration lue le
27 novembre à la Chambre des députés (*); Il avait été
sommairement défini par cette formule : « Etat protégé
en ce. qui concerne l’administration intérieurejj), posses-
1. Voir page 126.
2. « Faire de la politique et de l’administration de protectorat signifie :
maintenir le plus possible dans leur intégralité les rouages indigènes, les institutions,
utiliser les chefs traditionnels, leur laisser l’exercice direct de la
police, de l’administration, de la justice même, de la perception de l’impôt,
sous le simple contrôlé d’un agent résident auprès du chef. C’est par cet
agent, en contact permanent avec le chef indigène, que s’ouvrira progressivement
l’horizon de ce dernier, et, par lui, celui de son peuple ; c’est par
son intermédiaire que nous ferons pénétrer peu à peu nos idées de justice,
siop françàisé en ce qui a trait aux relations extérieures. »
Gela signifiait que, pour l’administration générale de l’île,
le gouvernement français comptait utiliser le plus possible
les institutions et pouvoirs indigènes existants, en
leur donnant des directions et en les contrôlant, comme
il fait en Tunisie (’), tandis que vis-à-vis des puissances
étrangères, Madagascar, n’ayant plus aucune autonomie,
et cessant, d’exister en tant qu’expression politique,
devait être considérée comme ùne . colonie française et
traitée comme telle. Cette conception d’un système bâtard,
tenant à la fois du protectorat et de l’annexion,
avait le grave inconvénient de manquer de netteté et de
simplicité ; aussi resta-t-elle peu compréhensible pour le
public français, qui n’en saisit pas les subtilités, et mal
accueillie par les gouvernements étrangers, qui n’avaient
pas d intérêt à faciliter notre installation définitive à
Madagascar. Les difficultés que provoqua cette situation
obligèrent le gouvernement français à chercher un système
moins compliqué et irritèrent envers les Malgaches
le sentiment populaire déjà mal disposé.
d’humanité et de progrès, c’est-à-dire notre intervention dans ce qu’elle a
de bienfaisant et de légitime, à l’exclusion de ce qu’elle a de tracassier et
d’insupportable pour des populations dont elle trouble toujours les coutumes
et toutes les traditions; Ce régime a deux caractéristiques1 qui devraient le
rendre indiscutable : il est le seul conforme à la réalité des situations ; il est
le plus économique. >r (Général Lyàutey.)
1. Dans cette conception, on était trompé par un double mirage. Le système
appliqué en Tunisie avec succès nè pouvait pas réussir pareillement à
Madagascar. Dans notre protectorat de l’Afrique septentrionale les populations,
même celles du sud, qui étaient sous la surveillance du bey du camp,
relevaient également du grand bey de Tunis et reconnaissaient son autorité,
établie depuis longtemps. Au contraire, à Madagascar,’ la suprématie des
Hova en dehors du plateau central était relativement récente et supportée
avec peine par les populations. Celles-ci virent dans notre prise de possession
une délivrance d’un joug détesté et se montrèrent volontiers hostiles aux
fonctionnaires indigènes placés à leur tête par le gouvernement de Tanana-
rive, dont nous espérions nous servir pour administrer sous notre contrôle.
— D’autre part, l’organisation malgache était loin d’être aussi avancée que
celle de la Tunisie, malgré l’apparence d’un gouvernement constitué avec des
ministres, des gouverneurs, etc. »