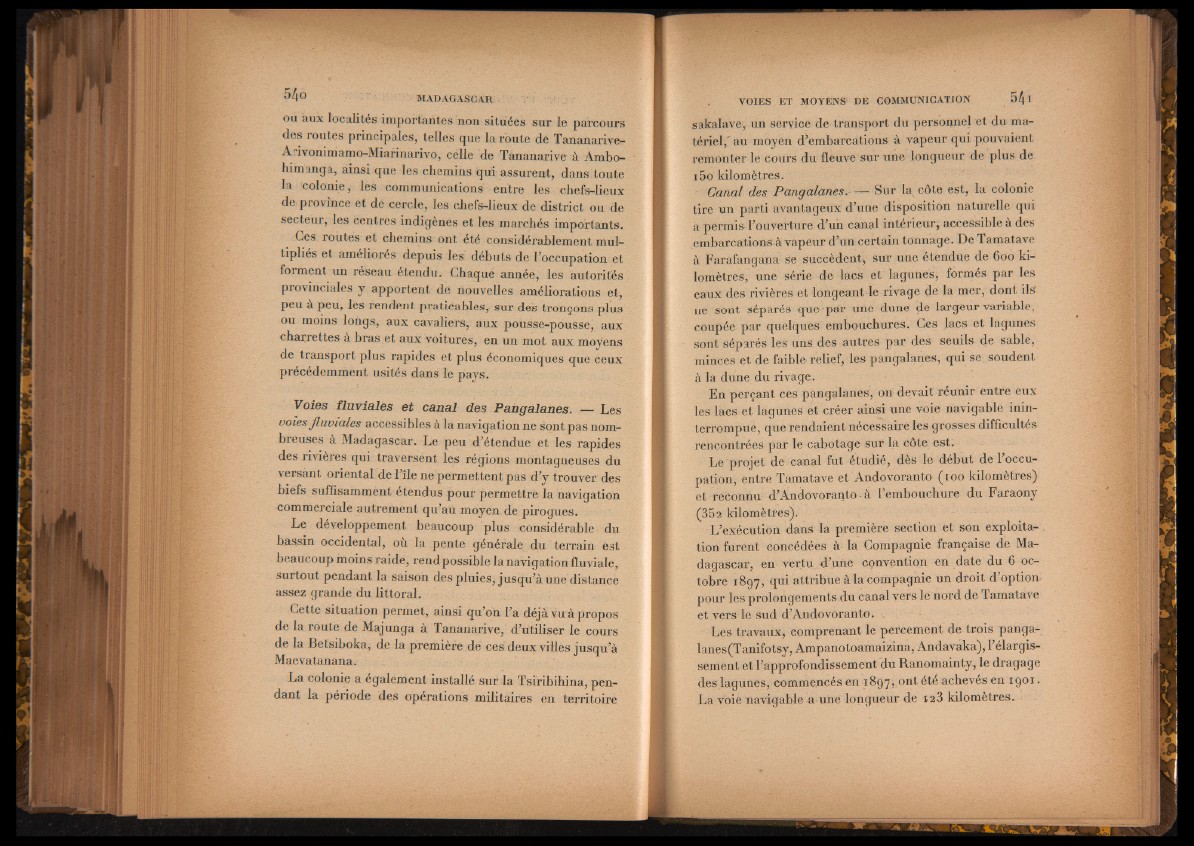
ou aux localités importantes non situées sur le parcours
des routes principales, telles que la route de Tananarive-
Arivonimamo-Miarinarivo, celle de Tananarive à Ambo-
himanga, ainsi que les chemins qui assurent, dans toute
la colonie, les communications entre les chefs-lieux
de province et de cercle, les chefs-lieux de district ou de
secteur, les centres indigènes et les marchés importants.
Ces routes et chemins ont été considérablement multipliés
et améliorés depuis les débuts de l’occupation et
forment un réseau étendu. Ghaquè année, les autorités
provinciales y apportent de nouvelles améliorations et,
peu a peu, les rendent praticables, sur deis tronçons plus
ou moins longs, aux cavaliers, aux pousse-pousse, aux
charrettes a bras et aux voitures, en un mot aux moyens
de transport plus rapides et plus économiques que ceux
précédemment usités dans le pays.
Voies fluviales et canal des Pangalanes. — Les
voies fluviales accessibles à la navigation ne sont pas nombreuses
a Madagascar. Le peu d’étendue et les rapides
des rivières qui traversent les régions montagneuses du
versant oriental de l ’île ne permettent pas d’y trouver des
biefs suffisamment étendus pour permettre la navigation
commerciale autrement qu’au moyen de pirogues.
Le développement beaucoup plus considérable du
bassin occidental, où la pente générale du terrain est
beaucoup moins raide, rendpossible la navigation fluviale,
surtout pendant la saison des pluies, jusqu’à une distance
assez grande du littoral.
Cette situation permet, ainsi qu’on l’a déjà vu à propos
de la route de Majunga a Tananarive, d’utdiser le cours
de la Betsiboka, de la première de ces deux villes jusqu’à
Maevatanana.
La colonie a également installé sur la Tsiribihina, pendant
la période des opérations militaires en territoire
sakalave, un service de transport du personnel et du matériel,'
au moyen d’embarcations à vapeur qui pouvaient
remonter le cours du fleuve sur une longueur de plus de
i 5o kilomètres.
Canal des Pangalanes. Sur la côte est, la colonie
tire un parti avantageux d’une disposition naturelle qui
a permis l’ouverture d’un canal intérieur; accessible à des
embarcations à vapeur d’un certain tonnage. De Tamatave
à Farafangana se succèdent, sur une étendue de 600 kilomètres,
une série de lacs et lagunes, formés par les
eaux des rivières et longeant le rivage de la mer, dont il£
ne sont séparés que par une dune de largeur variable,
coupée par quelques embouchures. Ces lacs et lagunes
sont séparés les uns des autres par des seuils de sable,
minces et de faible relief, les pangalanes, qui se soudent
à la dune du rivage.
En perçant ces pangalanes, on devait réunir entre eux
les lacs et lagunes et créer ainsi une voie navigable ininterrompue,
que rendaient nécessaire les grosses difficultés
rencontrées par le cabotage sur la côte est.
Le projet de canal fut étudié, dès le début de l’occupation,
entre Tamatave et Andovoranto (100 kilomètres)
et rebonnu d’Andovoranto à l’embouchure du Faraony
(352 kilomètres).
L’exécution dans la première section et son exploitation
furent concédées à la Compagnie française de Madagascar,
en vertu d’une convention en date du 6 octobre
1897, qui attribue à la compagnie un droit d’option
pour les prolongements du canal vers le nord de Tamatave
et vers le Sud d’Andovoranto.
Les travaux, comprenant le percement de trois panga-
lanes(Tanifotsy, Ampanotoamaizina, Andavaka), l’élargissement
et l’approfondissement du Ranomainty, le dragage
des lagunes, commencés en 1897,.ont été achevés en 1901.
La voie navigable a une longueur de 123 kilomètres.