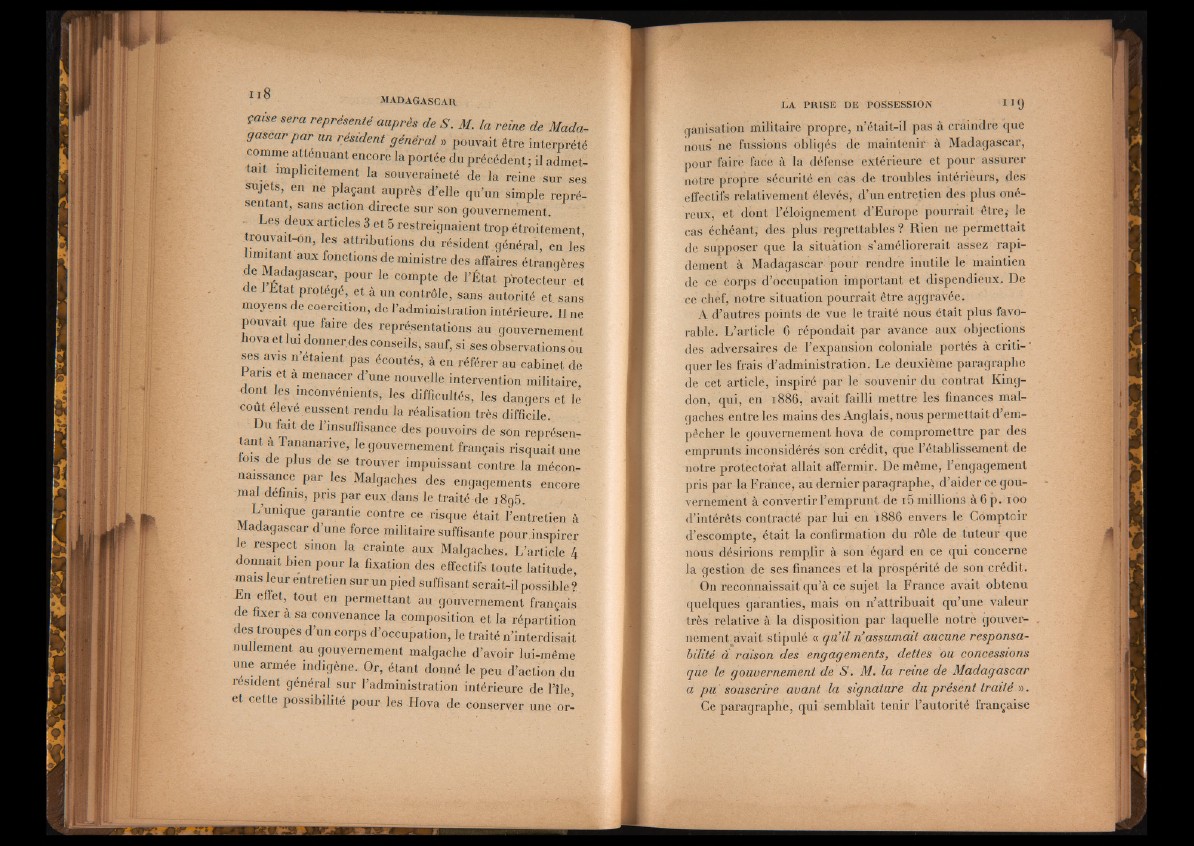
çaise sera représenté auprès de S . M. la reine de Madagascar
par un résident général » pouvait être interprété
comme atténuant encore la portée du précédent; il admettait
implicitement la souveraineté de la reine sur ses
sujets, en ne plaçant auprès d’elle qu’un simple représentant,
sans action directe sur son gouvernement.
Les deux articles 3 et 5 restreignaient trop étroitement,
rouvait-on, les attributions du résident général, en les
limitant aux fonctions de ministre des afTaires étrangères
e Madagascar, pour le compte de l’État protecteur et
e Etat protégé, et à un contrôle, sans autorité et. sans
moyens de coercition, de l’administration intérieure. Il ne
pouvait que faire des représentations au gouvernement
hova et lui donner des conseils, sauf, si ses observations ou
ses avis n étaient pas écoutés, à en référer au cabinet de
ans et a menacer d’une nouvelle intervention militaire
dont les inconvénients, les difficultés, les dangers et le
cout élevé eussent rendu la réalisation très difficile.
Du fait de l’insuffisance des pouvoirs de son représentant
à Tananarive, le gouvernement français risquait une
lois de plus de se trouver impuissant contre là méconnaissance
par les Malgaches des engagements encore
mal définis, pris par eux dans le traité de i8g5.
L’unique garantie contre ce risque était l’entretien à
Madagascar d’une force militaire suffisante pour .inspirer
le respect smon la crainte aux Malgaches. L’article 4
donnait bien pour la fixation des effectifs toute latitude
mais leur entretien sur un pied suffisant serait-il possible ?
En effet, tout en permettant au gouvernement français
de fixer à sa convenance la composition et la répartition
des troupes d’un corps d’occupation, le traité n’interdisait
nullement au gouvernement malgache d’avoir lui-même
une armée indigène. Or, étant donné le peu d’action du
résident général sur l’administration intérieure de l’île,
et cette possibilité pour les Hova de conserver une organisation
militaire propre, n’était-il pas à craindre que
nous’ ne fussions obligés de maintenir à Madagascar,
pour faire face à la défense extérieure et pour assurer
notre propre sécurité en cas de troubles intérieurs, des
effectifs relativement élevés, d’un entretien des plus onéreux,
et dont l’éloignement d’Europe pourrait être,- le
cas échéant, des plus regrettables ? Rien ne permettait
de supposer que la situation s’améliorerait assez rapidement
à Madagascar pour rendre inutile le maintien
de ce corps d’occupation important et dispendieux. De
ce chef, notre situation pourrait être aggravée.
A d’autres points de Vue le traité nous était plus favorable.
L’article G répondait par avance aux objections
des adversaires de l’expansion coloniale portés à criti-'
quer lès frais d’administration. Le deuxième paragraphe
de cet article, inspiré par le souvenir du contrat King-
don, qui, en 1886, avait failli mettre les finances malgaches
entre les mains des Anglais, nous permettait d’empêcher
le gouvernement hova de compromettre par des
emprunts inconsidérés son crédit, que l’établissement de
notre protectorat allait affermir. De même, l’engagement
pris par la France, au dernier paragraphe, d’aider ce gouvernement
à convertir l’emprunt de i5 millions à6 j). 100
d’intérêts contracté par lui en 1886 envers le Comptoir
d’escompte, était la confirmation du rôle de tuteur que
nous désirions remplir à son égard en ce qui concerne
la gestion de ses finances et la prospérité de son crédit.
On reconnaissait qu’à ce sujet la France avait obtenu
quelques garanties, mais on n’attribuait qu’une valeur
très relative à la disposition par laquelle notrè gouver-
nement^avait stipulé « qu’il n’assumait aucune responsabilité
à raison des engagements, dettes ou concessions
que le gouvernement de S . M. la reine de Madagascar
a pu souscrire avant la signature du présent traité ».
Ce paragraphe, qui semblait tenir l’autorité française