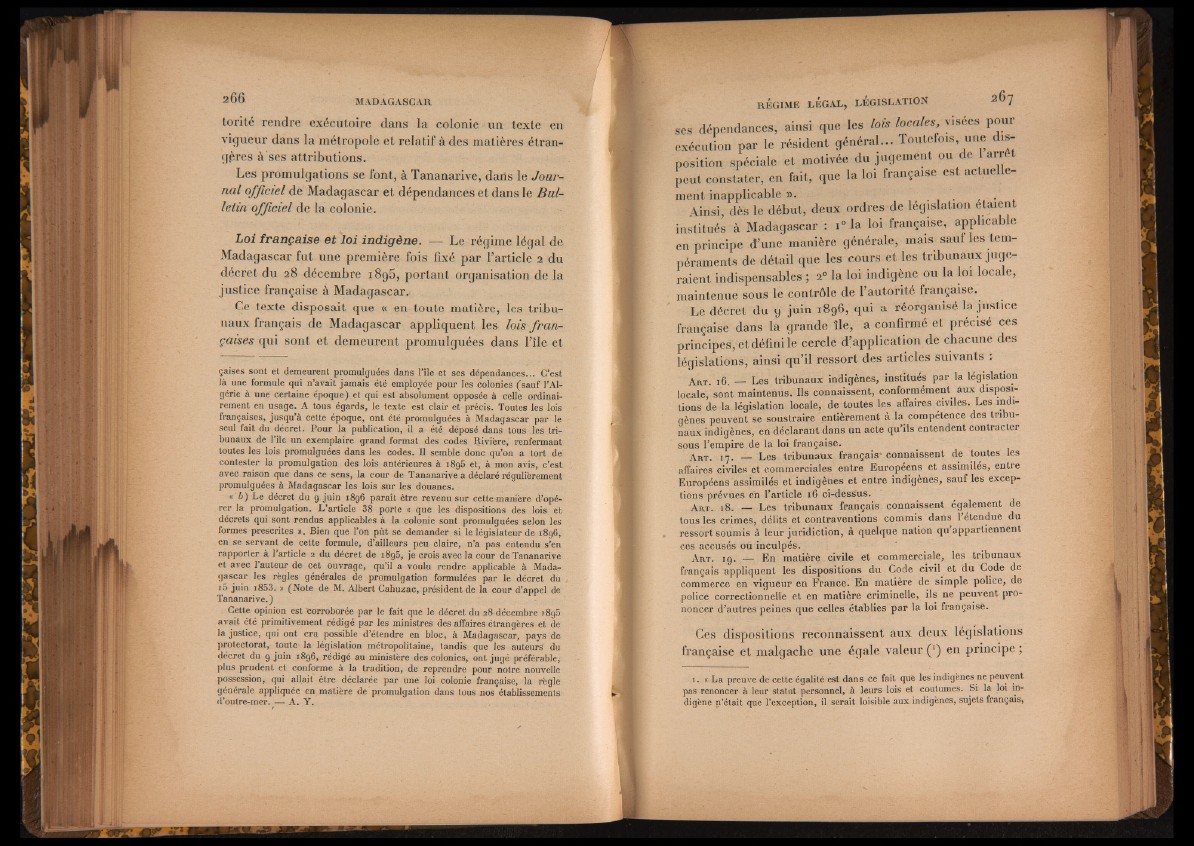
torité rendre exécutoire dans la colonie un texte en
vigueur dans la métropole et relatif à des matières étrangères
à ’ses attributions.
Les promulgations se font, à Tananarive, dans le Journal
officiel de Madagascar et dépendances et dans le Bulletin
officiel de la colonie.
L o i française et loi indigène. —- Le régime légal de
Madagascar fut une première fois fixé par l’article 2 du
décret du 28 décembre 1895, portant organisation de la
justice française à Madagascar.
Ce texte disposait que « en toute matière, les tribunaux
français de Madagascar appliquent les lois françaises
qui sont et demeurent promulguées dans l’île et
çaises sont et demeurent promulguées dans l’île et ses dépendances... C’est
là une formule qui n’avait jamais été employée pour les colonies (sauf l’Algérie
à une certaine époque), et qui est absolument opposée à celle ordinairement
en usage. A tous égards, le texte est clair et précis. Toutes les lois
françaises, jusqu’à cette époque, ont été promulguées à Madagascar par le
seul fait du décret. Pour la publication, il a été. déposé dans tous les tribunaux
de l’île un exemplaire grand format des codes Bavière, renfermant
toutes les lois promulguées dans les codes. Il semble donc qu’on a tort de
contester la promulgation des lois antérieures à 1895 et, à mon avis, c’est
avec raison que dans ce sens, la cour de Tananarive a déclaré régulièrement
promulguées à Madagascar les lois sur les douanes.
« b) Le décret du 9 juin 1896 paraît être revenu sur cette manière d’opérer
la promulgation. L ’article 38 porte « que les dispositions des lois et
décrets qui sont rendus applicables à la colonie sont promulguées selon les
formes prescrites ». Bien que l’on put se demander si le législateur de 1896,
en se servant de cette formule, d’ailleurs peu claire, n’a pas entendu s’en
rapporter à l’article 2 du décret de 1895, je crois avec la cour de Tananarive
et avec l ’auteur de cet ouvrage, qu’il a voulu rendre applicable à Madagascar
les règles générales de promulgation formulées par le décret du
i 5 juin i 853. » (Note de M. Albert Cahuzac, président de la cour d’appel de
Tananarive.)
Cette opinion est 'corroborée par le fait que le décret du 28 décembre 1895
avait été primitivement rédigé par les ministres des affaires étrangères et de
la justice, qui ont cru possible d’étendre en bloc, à Madagascar, pays de
protectorat, toute la législation métropolitaine, tandis que les auteurs' du
décret du 9 juin 1896, rédigé au ministère des colonies, ont jugé préférable,-
plus prudent et conforme à la tradition, de reprendre pour notre nouvelle
possession, qui allait être déclarée par une loi colonie française, la règle
générale appliquée en matière de promulgation dans tous nos établissements
d’outre-mer. — A . Y .
scs dépendances, ainsi que les lois locales, vsées pour
exécution par le résident général... Toutefois, une disposition
spéciale et motivée du jugement ou de 1 arrêt
peut constater, en fait, que la loi française est actuellement
inapplicable ». .
Ainsi, dès le début, deux ordres de législation étaient
institués à Madagascar : i° la loi française, applicable
en principe d’une manière générale, mais sauf les'tempéraments
de détail que les cours et les tribunaux jugeraient
indispensables ; 2° la loi indigène ou la loi locale,
maintenue sous le contrôle de l’autorité française.
Le décret du 9 juin 1896, qui a réorganisé la justice
française dans la grande île, a confirmé et précisé ces
principes, et défini le cercle d’application de chacune des
législations, ainsi qu’il ressort des articles suivants ;
A r t . 16. — Les tribunaux indigènes, institués par la législation
locale, sont maintenus. Ils connaissent, conformément âüx dispositions
de la législation locale, de toutes les affaires civiles. Les (nm-
gènes peuvent se soustraire entièrement à la compétence des tribunaux
indigènes, en déclarant dans un acte qu’ils entendent contracter
sous l’empire.de la loi française.
A r t . 17 . — Les tribunaux français* connaissent de toutes les
affaires civiles et commerciales entre Européens et assimiles, entre
Européens assimilés et indigènes et entre indigenes, sauf les exceptions
prévues en l’article 16 ci-dessus.
A r t . 18. — Les tribunaux français connaissent également de
tous les crimes, délits et contraventions commis dans 1 etendue du
ressort soumis à leur juridiction, à quelque nation qu appartiennent
ces accusés 011 inculpés.
A r t . i g . -— En matière civile et commerciale, les tribunaux
français appliquent les dispositions du Code civil et du Code de
commerce en vigueur en France^ En matière de simple police, de
police correctionnelle et en matière criminelle, ils ne peuvent prononcer
d’autres peines que celles établies par la loi française.
Ces dispositions reconnaissent aux deux législations
française et malgache une égale valeur ( ‘) en principe ;
i . « La preuve de cette égalité est dans ce fait que les indigènes ne peuvent
pas renoncer à leur statut personnel, à leurs lois et coutumes. Si la loi indigène
n’était que l’exception, il serait loisible aux indigènes, sujets français,