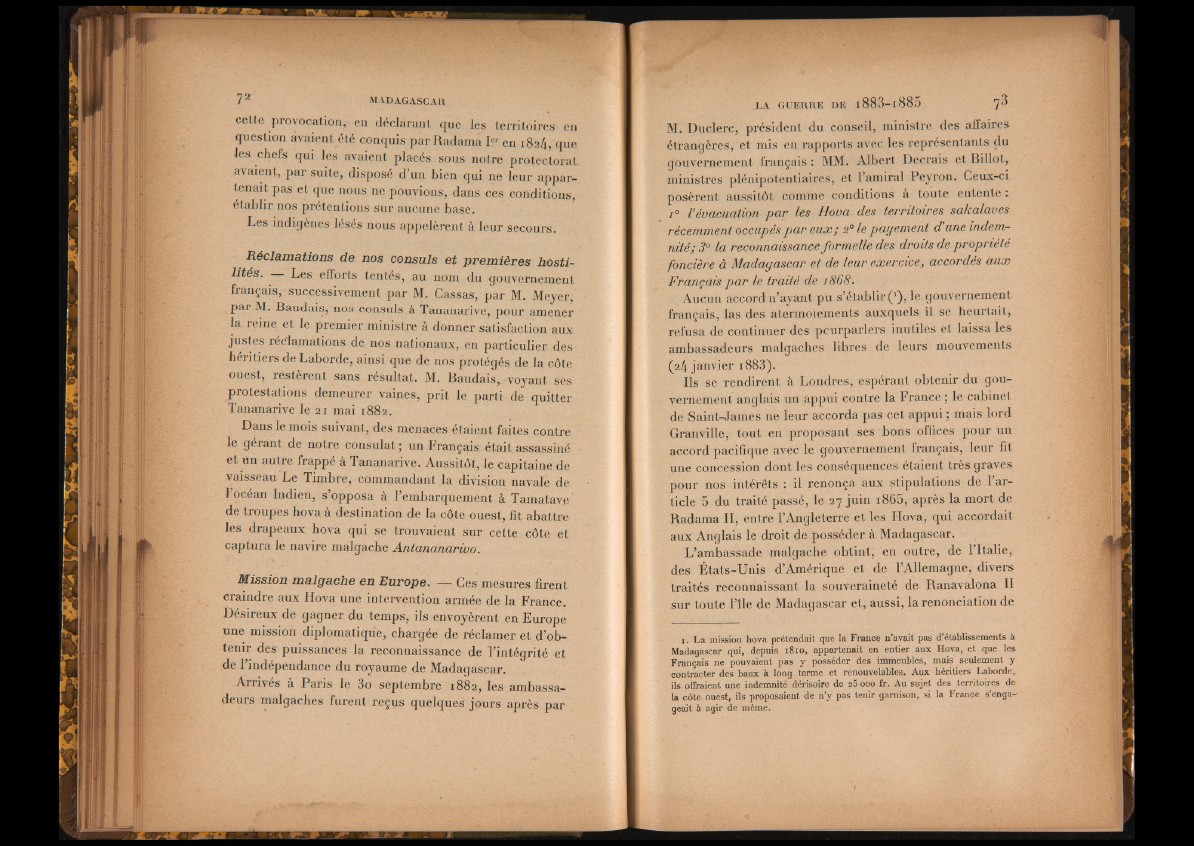
cette provocation, en déclarant que les territoires en
question avaient été conquis par Radama Ier en 1824, que
les chefs qui les avaient placés sous notre protectorat,
avaient, par suite, disposé d’un bien qui ne leur appartenait
pas et que nous ne pouvions, dans ces conditions,
établir nos prétentions sur aucune base.
Les indigènes lésés nous appelèrent à leur secours.
Réclamations de nos consuls et premières hostilités.
Les efforts tentés, au nom du gouvernement
français, successivement par M. Cassas, par M. Meyer,
par M. Baudais, nos consuls à Tananarive, pour amener
la reine et le premier ministre à donner satisfaction aux
justes réclamations-de nos nationaux, en particulier des
héritiers de Laborde, ainsi que de nos protégés de la côte
ouest, restèrent sans résultat. M. Baudais, voyant ses
protestations demeurer vai.nes, prit le parti de quitter
Tananarive le 21 mai 1882.
Dans le mois suivant, des menaces étaient faites contre
le gérant de notre consulat ; un Français était assassiné
et un autre frappe à Tananarive. Aussitôt, le capitaine de
vaisseau Le Timbre, commandant la division navale de
l’océan Indien, s’opposa à rembarquement à Tamatave
de troupes hova à destination de la côte ouest, fît abattre
les drapeaux hova qui se trouvaient Sur cette côte et
captura le navire malgache Antananarivo.
Mission malgache en Europe. — Ces mesures firent
craindre aux Hova une intervention armée de la France.
Désireux de gagner du temps, ils envoyèrent en Europe
une mission diplomatique, chargée de réclamer et d’obtenir
des puissances la reconnaissance de l’intégrité et
de l’indépendance du royaume de Madagascar.
Arrivés à Paris le 3o septembre 1882, les ambassadeurs
malgaches furent reçus quelques jours après par
M. Duclerc, président du conseil, ministre des affaires
étrangères, et mis en rapports avec les représentants du
gouvernement français : MM. Albert Decrais et Billot,
ministres plénipotentiaires, et l’amiral Peyron. Ceux-ci
posèrent aussitôt comme conditions à toute entente .
i° l’évacuation par les Hova des territoires sakalaves
récemment occupés par eux; 2° le payement d une indemnité;
3° la reconnaissance formelle des droits de propriété
foncière à Madagascar et de leur exercice, accordés aux
Français par le traité de 1868.
Aucun accord n’ayant pu s’établir (*), le gouvernement
français, las des atermoiements auxquels il se heurtait,
refusa de continuer des pourparlers inutiles et laissa les
ambassadeurs malgaches libres de leurs1 mouvements
(24 janvier i 883).
Ils se rendirent à Londres, espérant obtenir du gouvernement
anglais un appui contre la France ; le cabinet
de Saint-James ne leur accorda pas cet appui ; mais lord
Granville, tout en proposant ses bons offices pour un
accord pacifique avec le gouvernement français, leur fit
une concession dont les conséquences étaient très graves
pour nos intérêts : il renonça aux stipulations de l’article
5 du traité passé, le 27 juin i 865, après la mort de
ifadama II, entre l’Angleterre et les Hova, qui accordait
aux Anglais le droit de posséder à Madagascar.
L’ambassade malgache obtint, en outre, de l’Italie,
des États-Unis d’Amérique et de l’Allemagne, divers
traités reconnaissant la souveraineté de Ranavalona II
sur toute l’île de Madagascar et, aussi, la renonciation de
1. La mission hova prétendait que la France n’avait pas d’établissements à
Madagascar qui, depuis 1810, appartenait en entier aux Hova, et que les
Français ne pouvaient pas y posséder des immeubles, mais seulement y
contracter des baux à long terme et renouvelables. Aux héritiers Laborde,
ils offraient une indemnité dérisoire de 25 000 fr. Au sujet des territoires de
la côte ouest, ils proposaient de n’y pas tenir garnison, si la France s’engageait
à agir de même.