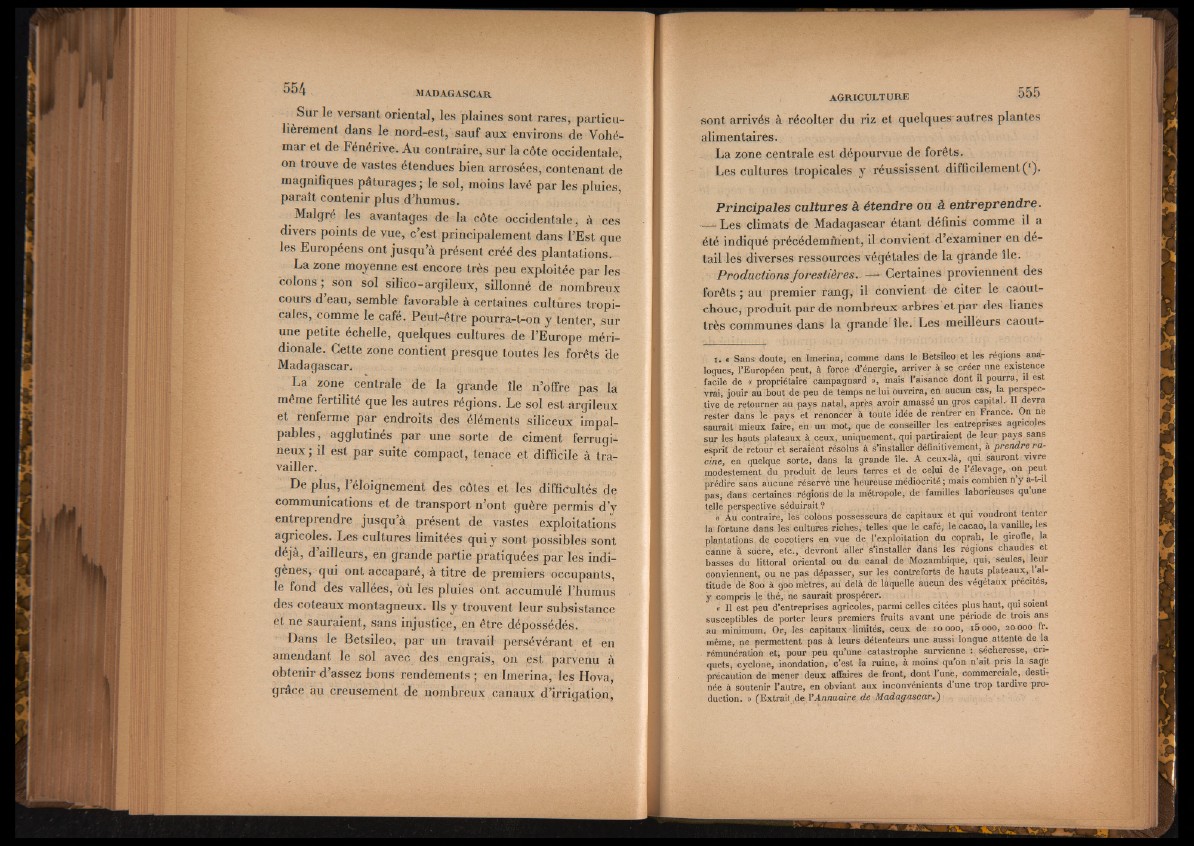
Sur le versant oriental, les plaines sont rares, particulièrement
dans le nord-est, sauf aux environs de Yohé-
mar et de Fénérive. Au contraire, sur la côte occidentale,
on trouve de vastes étendues bien arrosées, contenant de
magnifiques pâturages ; le sol, moins lavé par les pluies,
paraît contenir plus d’humus.
Malgré les avantages de la côte occidentale, à ces
divers points de vue, c’est principalement dans l’Est que
les Européens ont jusqu’à présent créé des plantations.
La zone moyenne est encore très peu exploitée par les
colons; son sol silico-argileux, sillonné de nombreux
cours d’eau, semble favorable à certaines cultures tropicales,
comme le café. Peut-être pourra-t-on y tenter, sur
une petite échelle, quelques cultures de l’Europe méridionale.
Cette zone contient presque toutes les forêts de
Madagascar,
La zone centrale de la grande île n’offre pas la
même fertilité que les autres régions. Le sol est argileux
et renferme par endroits des éléments siliceux impalpables
, agglutinés par une sorte de ciment ferrugineux;
il est par suite compact, tenace et difficile à travailler.
De plus, l’éloignement des côtes et les difficultés de
communications et de transport n’ont guère permis d’y
entreprendre jusqu’à présent de vastes exploitations
agricoles. Les cultures limitées qui y sont possibles sont
déjà, d’ailleurs, en grande partie pratiquées par les indigènes,
qui ont accaparé, à titre de premiers occupants,
le fond des vallées, où les pluies ont accumulé l’humus
des coteaux montagneux. Ils y trouvent leur subsistance
et ne sauraient, sans injustice, en être dépossédés.
Dans le Betsileo, par un travail persévérant et en
amendant le sol avec des engrais, on est parvenu à
obtenir d’assez bons rendements ; en Imerina, les Hôva,
grâce au creusement de nombreux canaux d’irrigation,
sont arrivés à récolter du riz et quelques' autres plantes
alimentaires.
La zone centrale est dépourvue de forêts.
Les cultures tropicales y réussissent difficilement (')•
Principales cultures à étendre ou à entreprendre.
— Les climats de Madagascar étant définis comme il a
été indiqué précédemñient, il convient d’examiner en détail
les diverses ressources végétales de la grande île.
Productions Jorestières- —• Certaines proviennént des
forêts ; au premier rang, il convient de citer le caoutchouc,
produit par de nombreux arbres et par des lianes
très communes dans la grande île. Les meilleurs caouti.
« Sans doute, en Imerina, comme dans le Betsileo et les régions analogues,
l’Européen peut, à force d’énergie, arriver à se créer une existence
facile de « propriétaire campagnard », mais l’aisance dont il pourra, il est
vrai, jouir au bout de peu de temps ne lui ouvrira, en aucun câs, la perspective
de retourner au pays natal, après avoir amassé un gros capital. Il devra
rester dans le pays et renoncer à toute idée de rentrer en France. On ne
saurait mieux faire, en un mot, que de conseiller les entreprises agricoles
sur les hauts plateaux à ceux, uniquement, qui partiraient de leur pays sans
esprit de retour et seraient résolus à s’installer définitivement, à. prendre racine,
en quelque sorte, dans la grande île. A ceux-là, qui sauront vivre
modestement du produit de leurs terres et de celui de l’élevage, on peut
prédire sans aucune réserve Une heureuse médiocrité ; mais combien n y a-t-il
pas, dans certaines régions de la métropole, de familles laborieuses qu une
telle perspective séduirait? . . ,
« Àu contraire, lés colons possesseurs de capitaux et qui voudront tenter
la fortune dans les cultures riches, telles que le café, le cacao, la vanille, les
plantations, de cocotiers en vue de l’exploitation du coprah, le girofle, la
canne à sucre, etc., devront aller s’installer dans les régions chaudes et
basses du littoral oriental ou du Canal de Mozambique, qui, seules, leur
conviennent, ou ne pas dépasser, sur les contreforts de hauts plateaux, 1 altitude
de 8oo à 900 mètres, au delà de laquelle aucun des végétaux précités,
y compris le thé, ne saurait prospérer. y\ .
« Il est peu d’entreprises agricoles, parmi celles citées plus haut, qui soient
susceptibles de porter leurs premiers fruits avant une période de trois ans
au minimum. Or, lès- capitaux limités, ceux de 10000, i 5ooo, 20000 fr.
même, ne permettent pas à leurs détenteurs une a u s s i longue.attente de la
rémunération et, pour peu qu’une catastrophe survienne sécheresse, criquets,
cyclone, inondation, c’est la ruine, à moins quon nait pris la sage
précaution de mener deux affaires de front, dont 1 unè, commerciale, destinée
à soutenir l’autre, en obviant aux inconvénients d une trop tardive production.
» (Extrait,de l’Annuaire de Madagascar,')