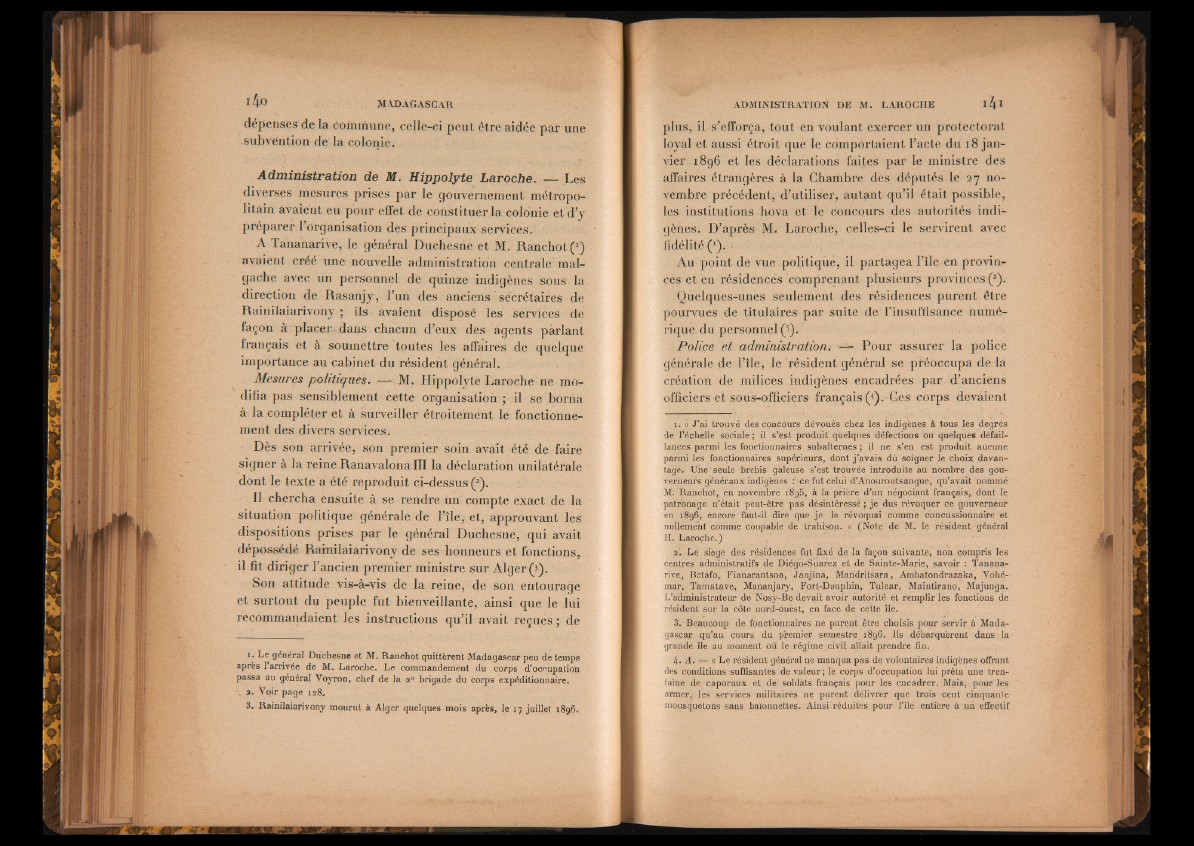
dépenses de la éommune, celle-ci peut être aidée par une
subvention de la colonie.
Administration de AT. Hippolyte Laroche. — Les
diverses mesures prises par le gouvernement métropolitain
avaient eu pour effet de constituer la colonie et d’y
préparer l’organisation des principaux services. *
A Tananarive, le général Duchesne et M. Ranchot (')
avaient créé une nouvelle administration centrale'malgache
avec un personnel de quinze indigènes sous la
direction de Rasanjy, l’un des anciens secrétaires de
Rainilaiarivony ; ils avaient disposé les services de
façon à placer- dans chacun d’eux des agents parlant
français et à soumettre toutes les affaires de quelque
importance au cabinet du résident général.
Mesures politiques. — M. Hippolyte Laroche ne modifia
pas sensiblement cette organisation ; il se borna
à la compléter et à surveiller étroitement le fonctionnement
des divers services.
Dès son arrivée, son premier soin avait été de faire
signer à la reine Ranavalona III la déclaration unilatérale
dont le texte a été reproduit ci-dessus (f).
Il chercha ensuite à se rendre un compte exact de la
situation politique générale de l’île, et, approuvant les
dispositions prises par le général Duchesne, qui avait
dépossédé Rainilaiarivony de ses honneurs et fonctions,
il fit diriger l’ancien premier ministre sur Alger (3).
Son attitude vis-à-vis de la reine, de son entourage
et surtout du peuple fut bienveillante, ainsi que le lui
recommandaient les instructions qu’il avait reçues; de
i. Le général Duchesne et M. Ranchot quittèrent Madagascar peu de temps
après 1 arrivée de M. Laroche. Le commandement du corps d’occupation
passa au général Voyron, chef de la a0 brigade du corps expéditionnaire,
a. Voir page 128.
3. Rainilaiarivony mourut à Alger quelques mois après, le 17 juillet 1896.
plus, il s’efforça, tout en voulant exercer un protectorat
loyal et aussi étroit que le comportaient l’acte du 18 janvier
1896 et les déclarations faites par le ministre des
affaires étrangères à la Chambre des députés le 27 novembre
précédent, d’utiliser, autant qu’il était possible,
les institutions hova et le concours des autorités indigènes.
D’après M. Laroche, celles-ci le servirent avec
fidélité (■). •
Au point de vue politique, il partagea l’île en provinces
et en résidences comprenant plusieurs provinces (2).
Quelques-unes seulement des résidences purent être
pourvues de titulaires par suite de Fin suffisance numérique
du personnel (3).
Police et administration. — Pour assurer la police
générale de l’île, le résident général se préoccupa de là
création de milices indigènes encadrées par d’anciens
officiers et sous-officiers français (4).-Ces corps devaient
i. « J’ai trouvé des concours dévoués chez les indigènes à tous les degrés
de l’échelle Sociale; il s’est produit quelques défections ou quelques défaillances
parmi les fonctionnaires subalternes ; il ne s’en est produit- aucune
parmi les fonctionnaires supérieurs, dont j ’avais du soigner le choix davantage.
Une seule brebis galeuse s’est trouvée introduite au nombre des gouverneurs
généraux indigènes ce fut celui d’Anouroutsangue, qu’avait nommé
M. Ranchot, en novembre i 8g5., à la prière d’un négociant français, dont le
patronage n’était peut-être pas désintéressé ; je dus révoquer ce gouverneur
en 1896, encore faut-il dire que je le révoquai comme concussionnaire et
nullement comme coupable de trahison. » (Note de M. le résident général
H. Laroche.)
SI Lé siège des résidences fut fixé de la façon suivante, non compris les
Centres administratifs de Diéçfo-Suarez et de Sainte-Marie, savoir : Tananarive,
Betâfo, Fianarantsoa, Janjina, Mandritsara, Ambatondrazaka, Vohé-
mar, Tamatave, Mananjary, Fort-Dauphin, Tulear, Maintirano, Majunga.
L’administrateur de Nosÿ-Be devait avoir autorité et remplir les fonctions de
résident sur la côte nord-ôuëst, en faCe de cette île.
3. Beaucoup de fonctionnaires ne purent être choisis pour servir à Madagascar
qu’au cours du premier semestre 1896. Ils débarquèrent dans la
grande île au moment ou le régime civil allait prendre fin.
4. A. a* « Le résident général ne manqua pas de volontaires indigènes offrant
des conditions suffisantes de valeur ; le corps d’occupation lui prêta une trentaine
de caporaux et de soldats français pour les encadrer. Mais, pour les
armer, les services militaires ne purent délivrer que trois cent cinquante
mousquetons sans baïonnettes. Ainsi.réduites pour l’île entière à un effectif