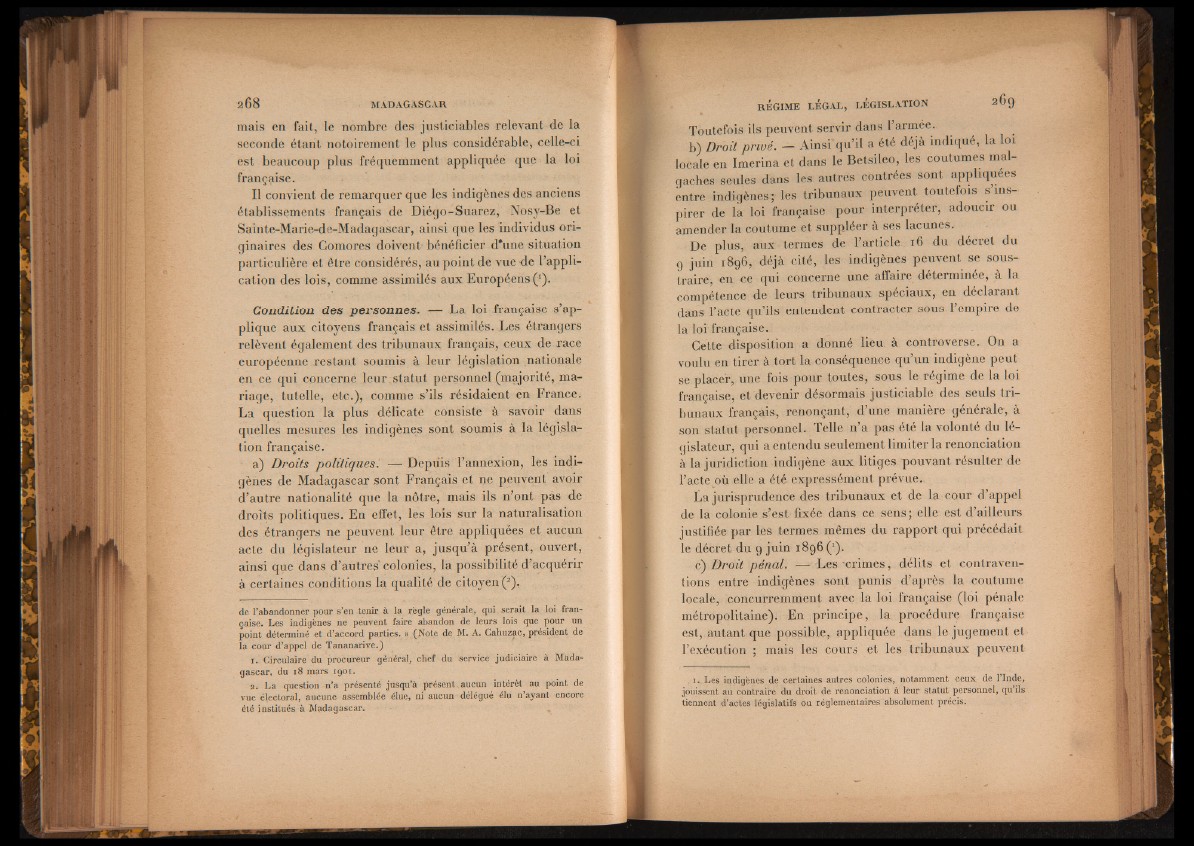
mais en fait, le nombre des justiciables relevant de la
seconde étant notoirement le plus considérable, celle-ci
est beaucoup plus fréquemment appliquée que la loi
française.
Il convient de remarquer que les indigènes des anciens
établissements français de Diégo-Suarez, Nosy-Be et
Sainte-Marie-de-Madagascar, ainsi que les individus originaires
des Comores doivent bénéficier d*une situation
particulière et être considérés, au point de vue <le l’application
des lois, comme assimilés aux Européens (’).
Condition des personnes. -— La loi française s’applique
aux citoyens français et assimilés. Les étrangers
relèvent également des tribunaux français, ceux de race
européenne restant soumis à leur législation nationale
en ce qui concerne leur statut personnel (majorité, mariage,
tutelle, etc.), comme s’ils résidaient en France.
La question la plus délicate consiste à savoir dans
quelles mesures les indigènes sont soumis à la législation
française.
a) Droits politiques. — Depuis l’annexion, les indigènes
de Madagascar sont Français et ne peuvent avoir
d’autre nationalité que la nôtre, mais ils n’ont pàs de
droits politiques. En effet, les lois sur la naturalisation
des étrangers ne peuvent leur être appliquées et aucun
acte du législateur ne leur a, jusqu’à présent, ouvert,
ainsi que dans d’autres' colonies, la possibilité d’acquérir
à certaines conditions ln qualité de citoyen (2),
de l’abandonner pour s’en tenir à la règle générale, qui serait la loi française.
Les indigènes ne peuvent faire abandon de leurs lois que pour un
point déterminé et d’accord parties. » (Note de M. A. Cahuzac, président de
îa cour d’appel de Tananarive.)
1. Circulaire du procureur général, chef du service judiciaire à Madagascar,
du 18 mars 1901.
2. La question n’a présenté jusqu’à présent aucun intérêt au point de
vue électoral, aucune assemblée élue, ni aucun délégué élu n’ayant encore
été institués à Madagascar.
r é g im e l é g a l , l é g i s l a t io n 269
Toutefois ils peuvent servir dans l’armée,
b) Droit privé. — Ainsi qu’il a été déjà indiqué, la loi
locale en Imerina et dans le Betsileo, les coutumes malgaches
seules dans les autres contrées sont appliquées
entre indigènes; les tribunaux peuvent toutefois s inspirer
de la loi française pour interpréter, adoucir ou
amender la coutume et suppléer à ses lacunes.
De plus, aux termes de l’article 16 du décret du
9 juin 1896, déjà cité, les indigènes peuvent se soustraire,
en ce qui concerne une affaire déterminée, à la
compétence de leurs tribunaux spéciaux, en déclarant
dans l’acte qu’ils entendent contracter sous l’empire de
la loi française.
Cette disposition a donné lieu à controverse. On a
voulu en tirer à tort la conséquence qu’un indigène peut
se placer, une fois pour toutes, sous le régime de la loi
française, et devenir désormais justiciable des seuls tribunaux
français, renonçant, d’une manière générale-, à
son statut personnel. Telle n’a pas été la volonté du législateur,
qui a entendu seulement limiter la renonciation
à la juridiction indigène aux litiges pouvant résulter de
l’acte où elle a été expressément prévue.,
La jurisprudence des tribunaux et de la cour d’appel
de la colonie s’est fixée dans ce sens; elle est d’ailleurs
justifiée par les termes mêmes du rapport qui précédait
le décret du 9 juin 1896 (’).
c) Droit pénal. — Les -crimes, délits et contraventions
entre indigènes sont punis d’après la coutume
locale, concurremment avec la loi française (loi pénale
métropolitaine). En principe, la procédure française
est, autant que possible, appliquée dans le jugement et
l’exécution ; mais les cours et les tribunaux peuvent
. i . Les indigènes de certaines autres colonies, notamment ceux de l’Inde,
jouissent au contraire du droit de renonciation à leur statut personnel, qu’ils
tiennent d’actes législatifs ou réglementaires absolument précis.