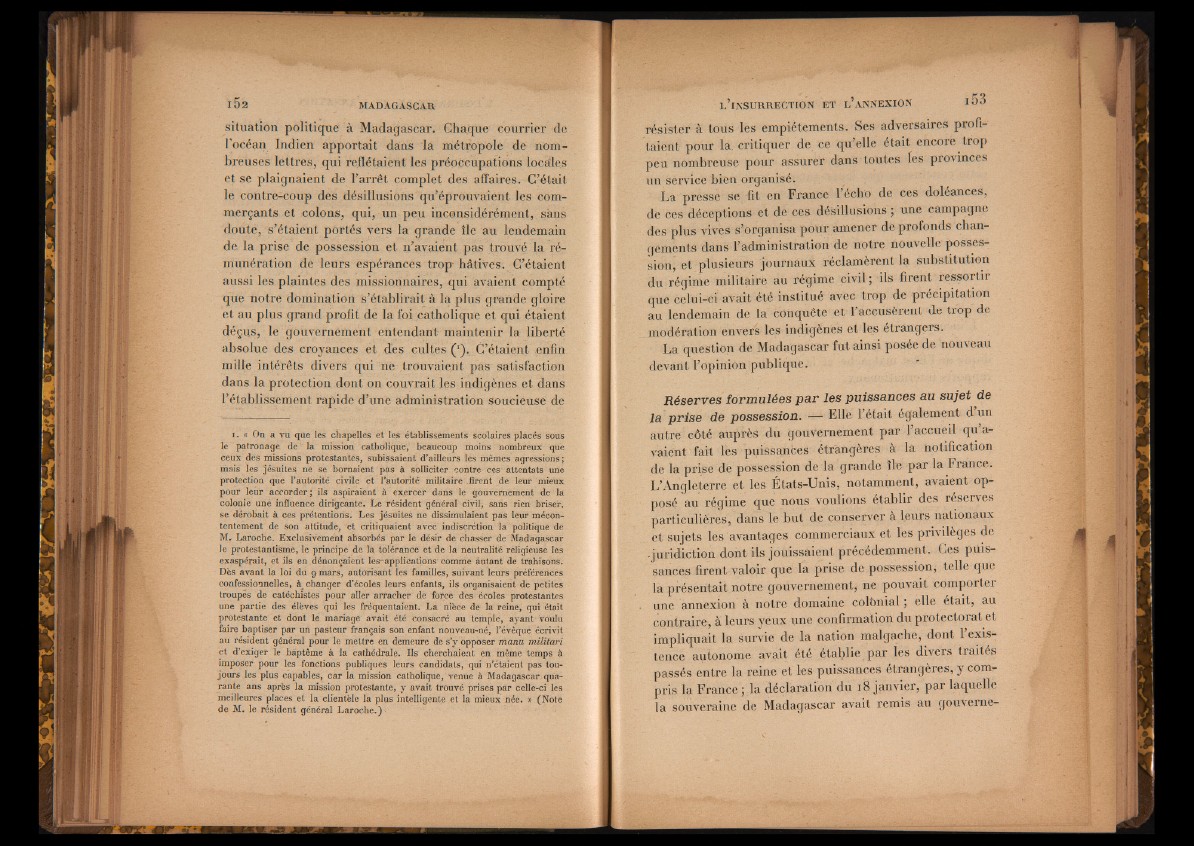
situation politique à Madagascar. Chaque courrier de
l’océan Indien apportait dans là métropole de nombreuses
lettres, qui reflétaient les préoccupations locales
et se plaignaient de l’arrêt complet des affaires. C’était
le contre-coup des désillusions qu’éprouvaient les commerçants
et colons, qui, un peu inconsidérément, sans
doute, s’étaient portés vers la grande île au lendemain
de la prise de possession et n’avaient pas trouvé la rémunération
de leurs espérances trop hâtives. C’étaient
aussi les plaintes des missionnaires, qui avaient compté
que notre domination s’établirait à la plus grande gloire
et au plus grand profit de la foi catholique et qui étaient
déçus, le gouvernement entendant maintenir la liberté
absolue des croyances et des cultes (^. C’étaient enfin
mille intérêts divers qui ne trouvaient pas satisfaction
dans la protection dont on couvrait les indigènes et dans
l’établissement rapide d’une administration soucieuse de
i. c< On a vil que les chapelles et les établissements scolaires placés sous
le patronage de la mission catholique, beaucoup moins nombreux que
ceux des missions protestantes, subissaient d’ailleurs les mêmes agressions ;
mais les jésuites ne se bornaient pas à solliciter contre ces attentats une
protection que l’autorité civile et l’autorité militaire .firent de leur mieux
pour leur accorder ; ils aspiraient à exercer dans le gouvernement de la
colonie uné influence dirigeante. Le résident général civil, sans rien briser,
se dérobait à ces prétentions. Les jésuites ne dissimulaient pas leur mécontentement
de son attitude, et critiquaient avec indiscrétion la politique de
M, Laroche. Exclusivement absorbés par le désir de chasser de Madagascar
le protestantisme, le principe de la tolérance et de la neutralité religieuse les
exaspérait, et ils en dénonçaient les-applications comme àutant de trahisons.
Dès avant la loi du g mars, autorisant les familles, suivant leurs préférences
confessionnelles, à_ changer d’écoles leurs enfants, ils organisaient de petites
troupes de catéchistes pour aller arracher de force des écoles protestantes
une partie des élèves qui les fréquentaient. La nièce de la reine, qui était
protestante et dont le mariage avait été consacré au temple, ayant' voulu
faire baptiser par un pasteur français son enfant nouveau-né, l’évèquê écrivit
au résident général pour le mettre en demeure de s’y opposer manu, militari
et d’exiger le baptême à la cathédrale. Ils cherchaient en même temps à
imposer pour les fonctions publiques leurs candidats, qui n’étaient pas toujours
les plus capables, car la mission catholique, venue à Madagascar quarante
ans après la mission protestante, y avait trouvé prises par celle-ci les
meilleures places et la clientèle la plus intelligente et la mieux née. » (Note
de M. le résident général Laroche.)
r o
résister à tous les empiétements. Ses adversaires profitaient
pour la critiquer de ce qu’elle était encore trop
peu nombreuse pour assurer dans toutes íes provinces
un service bien organisé.
La presse se fit en France l’écho de ces doléances,
de ces déceptions et de ces désillusions ; une campagne
des plus vives s’organisa pour amener de profonds changements
dans l’administration de notre nouvelle possession,
et plusieurs journaux réclamèrent la substitution
du régime militaire au régime civil; ils firent ressortir
que celui-ci avait été institué avec trop de précipitation
au lendemain de la conquête et l’accusèrent de trop de
modération envers les indigènes et les étrangers.
La question de Madagascar fut ainsi posée de nouveau
devant l’opinion publique.
Réserves formulées par les puissances au sujet de
la prise de possession. — Elle l’était également d un
autre côté auprès du gouvernement par l’accueil qu’avaient
fait les puissances étrangères à la notification
de la prise dé possession de la grande île par la France.
L’Angleterre et les États-Unis, notamment, avaient opposé
nu régime que nous voulions établir des reserves
particulières, dans le but de conserver à leurs nationaux
et sujets les avantages commerciaux et les privilèges de
•juridiction dont ils jouissaient précédemment. Ges puissances
firent valoir que la prise de possession, telle que
la présentait notre gouvernementj ne pouvait comporter
une annexion à notre domaine colbnial ; elle était, au
contraire, à leurs yeux une confirmation du protectorat et
impliquait la survie de la nation malgache, dont l’existence
autonome avait été établie par les divers traités
passés entre la reine et les puissances étrangères, y compris
la France ; la déclaration du 18 janvier, par laquelle
la souveraine de Madagascar avait remis au gouverne