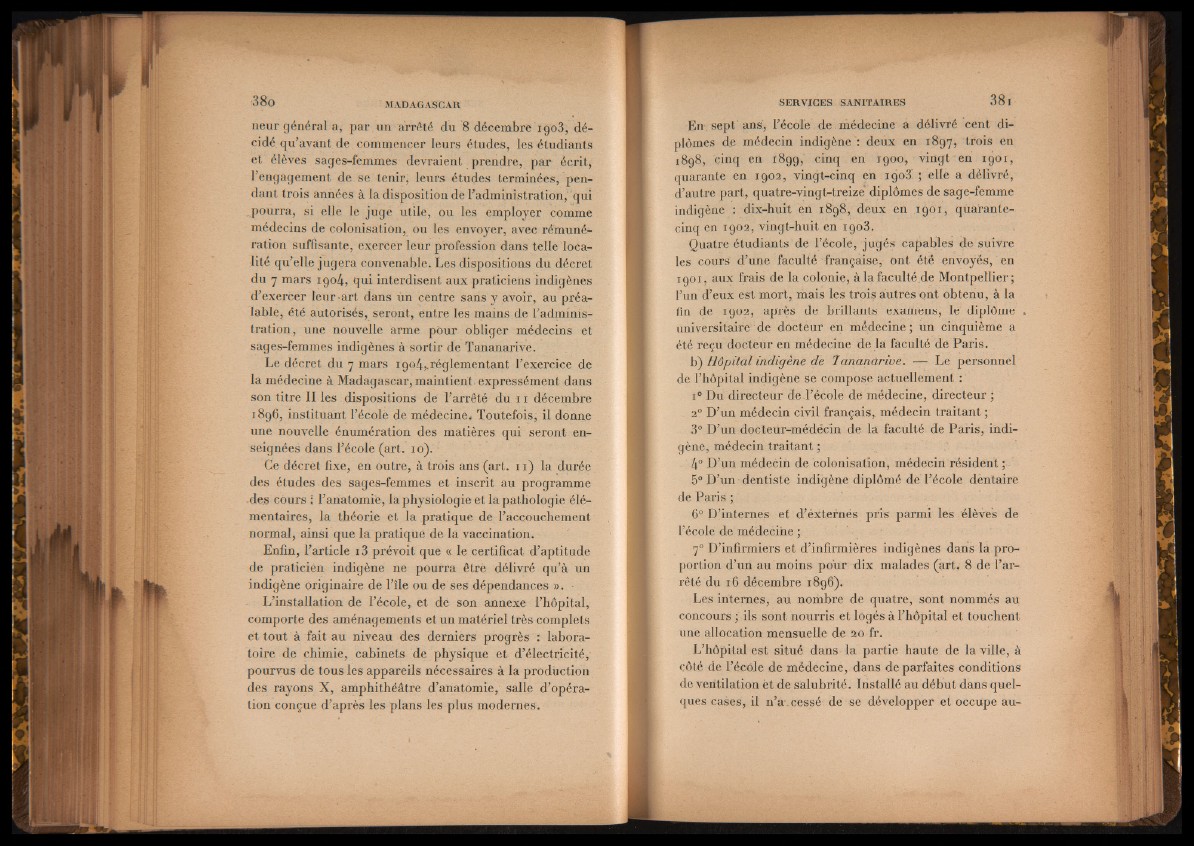
neur général a, par un arrêté du 8 décembre 1903, décidé
qu’avant de commencer leurs études, les étudiants
et élèves sages-femmes devraient prendre, par écrit,
l’engagement de se tenir, leurs études terminées, pendant
trois années à la disposition dè l’administration, qui
pourra, si elle le juge utile, ou les employer comme
médecins de colonisation, ou les envoyer, avec rémunération
suffisante, exercer leur profession dans telle localité
qu’elle jugera convenable. Les dispositions du décret
du 7 mars 1904, qui interdisent aux praticiens indigènes
d’exercer leur art dans un centre sans y avoir, au préalable,
été autorisés, seront, entre les mains de l’administration,
une nouvelle arme pour obliger médecins et
sages-femmes indigènes à sortir de Tananarive.
Le décret du 7 mars 1904,. réglementant l’exercice de
la médecine à Madagascar, maintient expressément dans
son titre II les dispositions de l’arrêté du 11 décembre
1896, instituant l’école de médecine. Toutefois, il donne
une nouvelle énumération des matières qui seront enseignées
dans l’école (art. 10).
Ce décret fixe, en outre, à trois ans (art. 11) la durée
des études des sages-femmes et inscrit au programme
des cours ; l’anatomie, la physiologie et la pathologie élémentaires,
la théorie et la pratique de l’accouchement
normal, ainsi que la pratique de la vaccination.
Enfin, l’article i 3 prévoit que « le certificat d’aptitude
de praticien indigène ne pourra être délivré qu’à un
indigène originaire de l’île ou de ses dépendances ». ■
L’installation de l’école, et de son annexe l’hôpital,
comporte des aménagements et un matériel très complets
et tout à fait au niveau des derniers progrès : laboratoire
de chimie, cabinets de physique et d’électricité,
pourvus de tous les appareils nécessaires à la production
des rayons X, amphithéâtre d’anatomie, salle d’opération
conçue d’après les plans les plus modernes.
En. sept ans, l’école de médecine a délivré cent diplômes
de médecin indigène : deux en 1897, trois en
1898, cinq en 1899, cinq en 1900, vingt en 1901,
quarante en 1902, vingt-cinq en igo3’ ; elle a délivré,
d’autre part, quatre-vingt-treize" diplômes de sage-femme
indigène : dix-huit en 1898, deux en 1901, quarante-
cinq en 1902, vingt-huit en 1903.
Quatre étudiants de l’école, jugés capables de suivre
les cours d’une faculté française, ont été envoyés, en
1901, aux frais de la colonie, à la faculté .de Montpellier;
l’un d’eux est mort, mais les trois autres ont obtenu, à la
fin de 1902, après de brillants examens, le diplôme .
universitaire de docteur en médecine; un cinquième a
été reçu docteur en médecine de là faculté de Paris.
b) Hôpital indigène de Tananarive. — Le personnel
de l’hôpital indigène se compose actuellement :
i° Du directeur ded’école de médecine, directeur ;
20 D’un médecin civil français, médecin traitant ;
3° D’un docteur-médécîn de la faculté de Paris, indigène,
médecin traitant ;
4° D’un médecin de colonisation, médecin résident ;
5° D’un dentiste indigène diplômé de l’école dèntaire
de Paris ;
6° D’internes et d’éxternës pris parmi les élèves de
l’école de médecine ;
70 D’infirmiers et d’infirmières indigènes dans la proportion
d’un au moins pour dix malades (art. 8 de l’arrêté
du 16 décembre 1896).
Les internes, au nombre de quatre, sont nommés au
concours ; ils sont nourris et logés à l’hôpital et touchent
une allocation mensuelle de 20 fr.
L’hôpital est situé dans la partie haute de la ville, à
côté de l’école de médecine, dans de parfaites conditions
de ventilation èt de salubrité. Installé au début dans quelques
cases, il n’a . cessé de se développer et occupe au