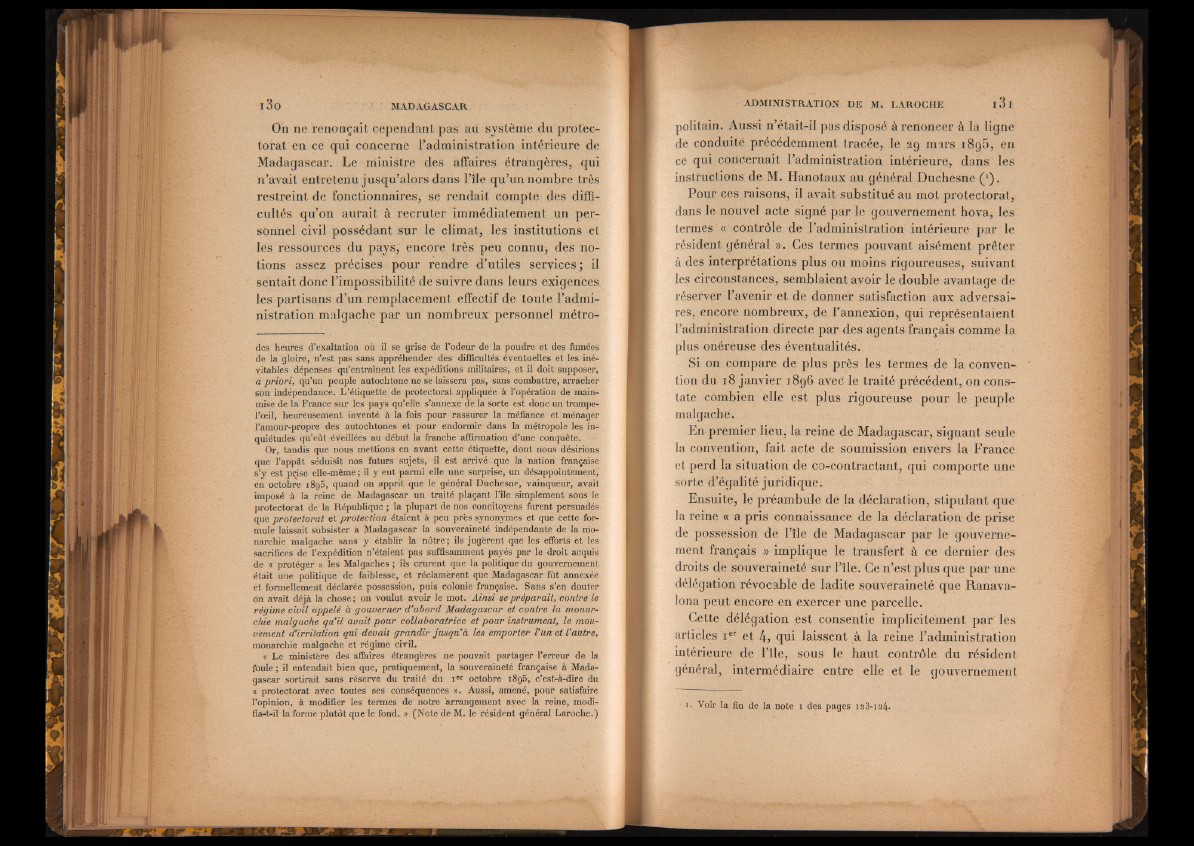
On ne renonçait cependant pas aü système du protectorat
en ce qui concerne ¡’administration intérieure de
Madagascar. Le ministre des affaires étrangères, qui
n’avait entretenu jusqu’alors dans l’île qu’un nombre très
restreint de fonctionnaires, se rendait compte des difficultés
qu’on aurait à recruter immédiatement un personnel
civil possédant sur le climat, les institutions et
lés ressources du pays, encore très peu connu, des notions
assez précises pour rendre d’utiles services ; il
sentait donc l’impossibilité de suivre dans leurs exigences
les partisans d’un remplacement effectif de toute l’administration
malgache par un nombreux personnel métrodcs
heures d’exaltation où il se grise de l’odeur de la poudre et des fumées
de la gloire, n’est pas sans appréhender des difficultés éventuelles et les inévitables
dépenses qu’entraînent les expéditions militaires, et il doit supposer,
a priori, qu’un peuple autochtone ne se laissera pas, sans combattre, arracher
son indépendance. L’étiquette de protectorat appliquée à l’opération de mainmise
de la France sur les pays qu’elle s’annexe de la sorte est donc un trompe-
l’oeil, heureusement inventé à la fois pour rassurer la méfiance et ménager
l’amour-propre des autochtones et pour endormir dans la métropole les inquiétudes
qu’eût éveillées au début la franche affirmation d’une conquête.
Or, tandis que nous mettions en avant cette étiquette, dont nous désirions
que l’appât séduisît nos futurs sujets, il est arrivé que la nation française
s’y est prise elle-même; il y eut parmi elle une surprise, un désappointement,'
en octobre 1895, quand on apprit que le général Duchesne, vainqueur, avait
imposé à la reine de Madagascar un traité plaçant l’île simplement soüs le
protectorat de la République ; la plupart de nos concitoyens furent persuadés
que protectorat et protection étaient à peu près synonymes et que cette formule
laissait subsister à Madagascar la souveraineté indépendante de la monarchie
malgache sans y établir la nôtre ; ils jugèrent que les efforts et les
sacrifices de l’expédition n’étaient pas suffisamment payés par le droit acquis
de « protéger », les Malgaches ; ils crurent que la politique du gouvernement
était une politique de faiblesse, et réclamèrent que Madagascar fut annexée
et formellement déclarée possession, puis colonie française. Sans s’en douter
on avait déjà la chose ; on voulut avoir le mot. Ainsi se préparait, contre le
régime civil appelé à gouverner d’abord Madagascar et contre la monarchie
malgache qu'il avait pour collaboratrice et pour instrument, le mouvement
d’irritation qui devait grandir jusqu’à les emporter l’un et L’autre,
monarchie malgache et régime civil.
« Le ministère des affaires étrangères ne pouvait partager l’erreur de la
foule ; il entendait bien que, pratiquement, la souveraineté française à Madagascar
sortirait sans réserve du traité du ior octobre 1895, c’est-à-dire du
« protectorat avec toutes ses conséquences ». Aussi, amené, pour satisfaire
l’opinion, à modifier les termes de notre arrangement avec la reine, modifia
t-il la forme plutôt que le fond. » (Note de M. le résident général Laroche.)
politain. Aussi n’était-il pas disposé à renoncer à la ligne
de conduite précédemment tracée, le 29 mars 1895, en
ce qui concernait l’administration intérieure, dans les
instructions de M. Hanotaux au général Duchesne ( ‘).
Pour ces raisons, il avait substitué au mot protectorat,
dans le nouvel acte signé par le gouvernement hova, les
termes « contrôle de l’administration intérieure par le
résident général ». Ces termes pouvant aisément prêter
à des interprétations plus ou moins rigoureuses, suivant
les circonstances, semblaient avoir le double avantage de
réserver l’avenir et de donner satisfaction aux adversaires,
encore nombreux, de l’annexion, qui représentaient
l’administration directe par des agents français comme la
plus onéreuse des éventualités.
Si on compare de plus près les termes de la convention
du 18 janvier 1896 avec le traité précédent, on constate
combien elle est plus rigoureuse pour le peuple
malgache.
En premier lieu, la reine de Madagascar, signant seule
la convention, fait acte de soumission envers la France
et perd la situation de co-contractant, qui comporte une
sorte d’égalité juridique;
Ensuite, le préambule de la déclaration, stipulant que
la reine « a pris connaissance de la déclaration de prise
de possession de l’île de Madagascar par le gouvernement
français » implique le transfert à ce dernier des
droits de souveraineté sur l’île. Ce n’est plus que par une
délégation révocable de ladite souvèraineté que Ranava-
lona peut encore en exercer une parcelle.
Cette délégation est consentie implicitement par les
articles Ier et 4> qui laissent à la reine l’administration
intérieure de l’île, sous le haut contrôle du résident
général, intermédiaire entre elle et le gouvernement
1. Voir la fin de la noie 1 des pages 123-124.