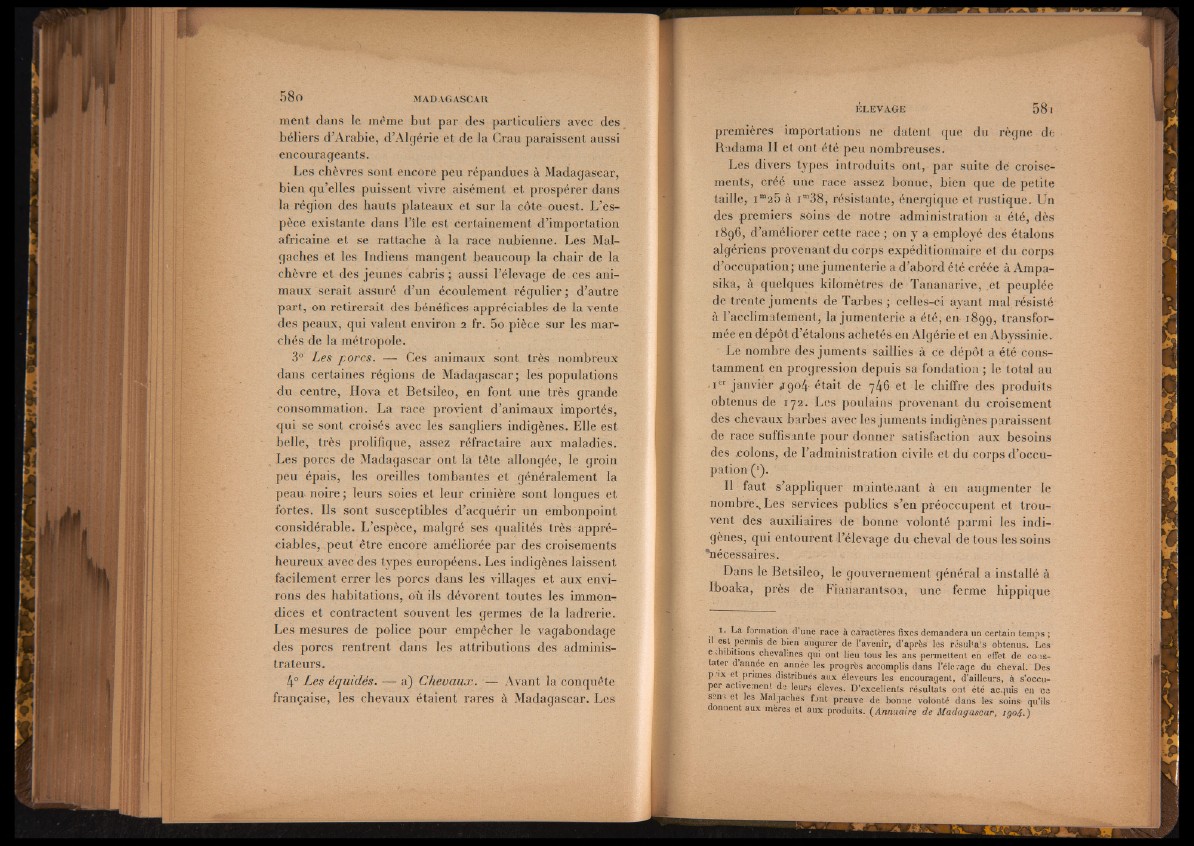
ment dans le mime but par des particuliers avec des
béliers d’Arabie, d’Algérie et de la Crau paraissent aussi
encourageants.
Les chèvres sont encore peu répandues à Madagascar,
bien qu’elles puissent vivre aisément et prospérer dans
la région des hauts plateaux et sur la côte ouest. L’espèce
existante dans l’île est certainement d’importation
africaine et se rattache à la race nubienne. Les Malgaches
et les Indiens mangent beaucoup la chair de la
chèvre et des jeunes cabris * aussi l’élevage de ces animaux
serait assuré d’un écoulement régulier ; d’autre
part, on retirerait des bénéfices appréciables de la vente
des peaux, qui valent environ 2 fr. 5o pièce sur les marchés
de la métropole.
3° Les porcs. —■ Ces animaux sont très nombreux
dans certaines régions de Madagascar; les populations
du centre, Hova et Betsileo, en font une très grande
consommation. La race provient d’animaux importés,
qui se sont croisés avec les sangliers indigènes. Elle est
belle, très prolifique, assez réfractaire aux maladies.
Les porcs de Madagascar ont la tête allongée, le groin
peu épais, les oreilles tombantes et généralement la
peau, noire ; leurs soies et leur crinière sont longues et
fortes. Ils sont susceptibles d’acquérir un embonpoint
considérable. L’espèce, malgré ses qualités très appréciables,
peut être encore améliorée par des croisements
heureux avec des types européens. Les indigènes laissent
facilement errer les porcs dans les villages et aux environs
des habitations, où ils dévorent toutes les immondices
et contractent souvent les germes de la ladrerie.
Les mesures de police pour empêcher le vagabondage
des porcs rentrent dans les attributions des administrateurs.
4° Les équidés. -— a) Chevaux. — Avant la conquête
française, les chevaux étaient rares à Madagascar. Les
premières importations ne datent que du règne de
Radama II et ont été peu nombreuses.
Les divers types introduits ont, par suite dé croisements,
créé une race assez bonne, bien que de petite
taille, im25 à im38, résistante, énergique et rustique. Un
des premiers soins de notre administration a été, dès
1896, d’améliorer cette race; on y a employé des étalons
algériens provenant du corps expéditionnaire et du corps
d’occupation; une jumenterie a d’abord été créée à Ampa-
sika, à quelques kilomètres de Tananarive, et peuplée
de trente juments de Tarbes ; celles-ci ayant mal résisté
à l’acclimatement, la jumenterie a été, en 1899, transformée
en dépôt d’étalons achetés en Algérie et en Abyssinie.
Le nombre des juments saillies à Ce dépôt a été constamment
en progression depuis sa fondation ; le total au
• I er janvier j g o 4 était de 74 6 et le chiffre des produits
obtenus de 172. Les poulains provenant du croisement
des chevaux barbes avec les juments indigènes paraissent
de race suffisante pour donner satisfaction aux besoins
des .colons, de l’administration civile et du corps d’occupation
( ‘).
Il faut s’appliquer maintenant à en augmenter le
nombre.,Les services publics s’en préoccupent et trouvent
des auxiliaires de bonne volonté parmi les indigènes,
qui entourent l’élevage du cheval de tous les soins
'nécessaires.
Dans le Betsileo, le gouvernement général a installé à
Iboaka, près de Fiariarantsoa, une ferme hippique
1. Là formation d'une race à caractères fixes demandera un certain temps ;
il est permis de bien augurer de l’avenir, d’après les résultats obtenus. Les
e xhibitions chevalines qui ont lieu tous les ans permettent en effet de constater
d année en année les progrès accomplis dans féle vage du cheval. Des
p. ix et primes distribués aux éleveurs les encouragent, d'ailleurs, à s’occuper
activement de leurs élèves. D’excellents résultats ont été acquis en ce
s~n. et les Mal jaches font preuve de bonne volonté dans les soins qu’ils
donnent aux mères et aux produits. {Annuaire de Madagascar, 1904.)