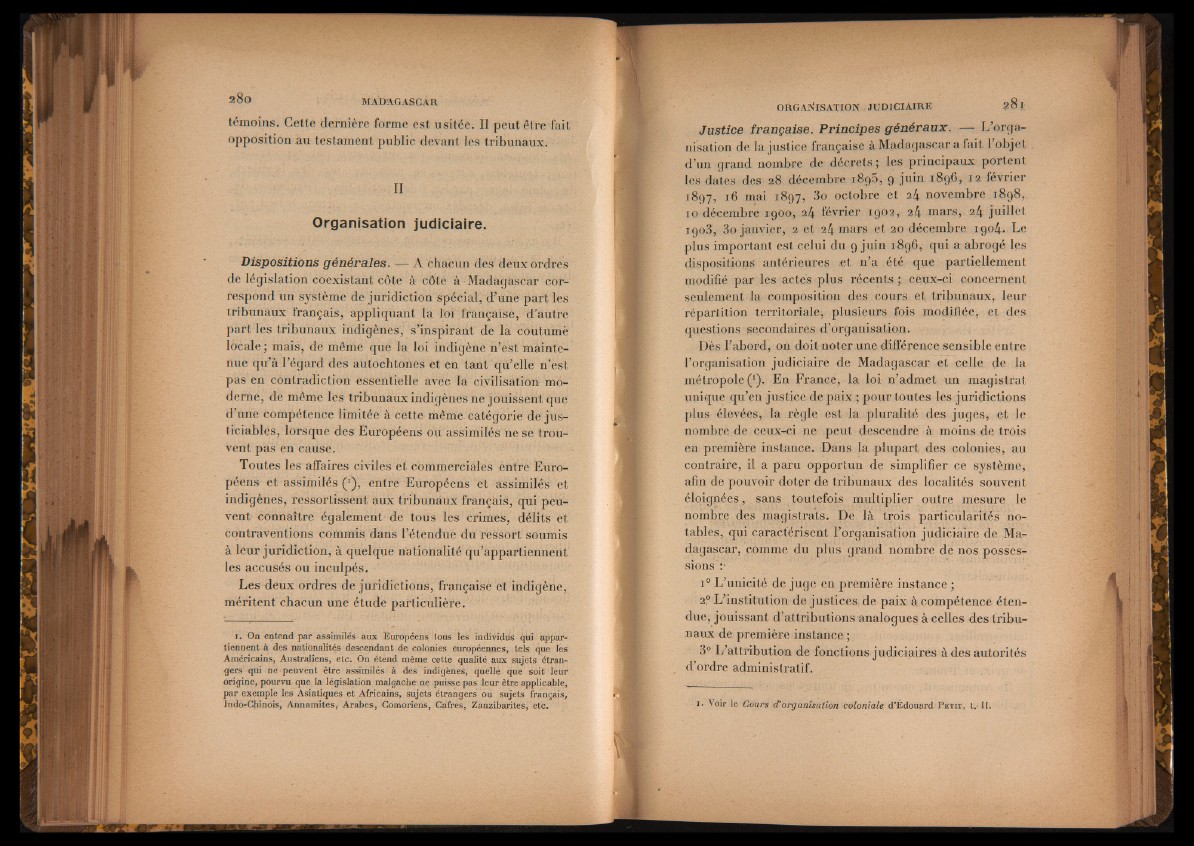
I
témoins. Cette dernière forme est usitée. Il peut être fait
opposition au testament public devant les tribunaux.
II
Organisation judiciaire.
Dispositions générales. — A chacun des deux ordres
de législation coexistant côte à côte à Madagascar correspond
un système de juridiction spécial, d’une part les
tribunaux français, appliquant la loi française, d’autre
part les tribunaux indigènes, s’inspirant de la coutumè
locale ; mais, de même que la loi indigène n’est maintenue
qu’à l’égard des autochtones et en tant qu’elle n’est
pas en contradiction essentielle avec la civilisation moderne,
de même les tribunaux indigènes ne jouissent que
d’une compétence limitée à cette même catégorie de justiciables,
lorsque des Européens ou assimilés ne se trouvent
pas en cause.
Toutes les affaires civiles et commerciales entre Européens
et assimilés ( ’), entre Européens et assimilés et
indigènes, ressortissent aux tribunaux français, qui peuvent
connaître également de tous les crimes, délits et
contraventions commis dans l’étendue du ressort soumis
à leur juridiction, à quelque nationalité qu’appartiennent
les accusés ou inculpés.
Les deux ordres de juridictions, française et indigène,
méritent chacun une étude particulière.
1. On entend par assimilés aux Européens tous les individus qui appartiennent
à des nationalités descendant de colonies européennes, tels que les
Américains, Australiens, etc. On étend même cette qualité aux sujets étrangers
qui ne peuvent être assimilés à des indigènes, quelle que soit leur
origine, pourvu que la législation malgache ne puisse pas leur être applicable,
par exemple les- Asiatiques et Africains, sujets étrangers ou sujets français,
Indo-Chinois, Annamites, Arabes, Comoriens, Cafres, Zanzibarites, etc.
Justice française. P r in c ip e s gé n é rau x. — L ’organisation
de la justice française à Madagascar a fait l’objet
d’un grand nombre de décrets; les principaux portent
les dates des 28 décembre 1895, 9 juin 1896, 12 février
1897, 16 mai 1897, 3o octobre et 24 novembre 1898,
10 décembre 1.900.,.24 février 1902, 24 mars, 24 juillet
1903, 3o janvier, 2 et 24 mars et 20 décembre 1904. Le
plus important est celui du 9 juin 1896, qui a abrogé les
dispositions antérieures et n’a été que partiellement
modifié par les actes plus récents; ceux-ci concernent
seulement la composition des cours et tribunaux, leur
répartition territoriale, plusieurs fois modifiée, et des
questions secondaires d’organisation.
Dès l’abord, on doit noter une différence sensible entre
l’organisation judiciaire de Madagascar et celle de la
métropole (*). En France, la loi n’admet un magistrat
unique qu’en justice de paix ; pour toutes les juridictions
plus élevées, la règle est la pluralité des juges, et le
nombre de ceux-ci ne peut descendre à moins de trois
en première instance. Dans la plupart des colonies, au
contraire, il a paru opportun de simplifier ce système,
afin de pouvoir doter de tribunaux des localités souvent
éloignées, sans toutefois multiplier outre mesure le
nombre des magistrats. De là trois particularités notables,
qui caractérisent l’organisation judiciaire de Madagascar,
comme du plus grand nombre de nos possessions
:•
i° L’unicité de juge en première instance ;
2? L’institution de justices de paix à compétence étendue,
jouissant d’attributions analogues à celles des tribunaux
de première instance;
3° L’attribution de fonctions judiciaires à des autorités
d’ordre administratif.
i . Voir le Cours d’organisation coloniale d’Édouard P e t i t , I. II.