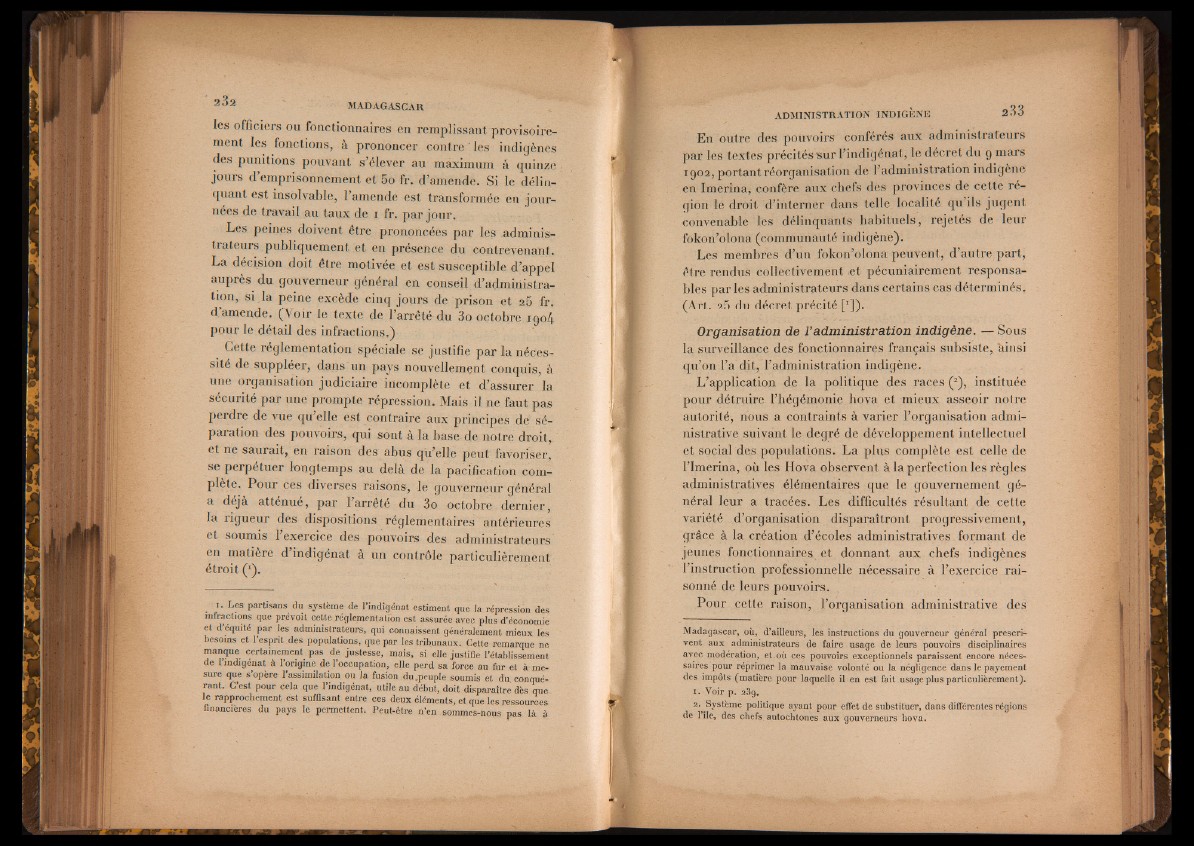
les officiers ou fonctionnaires en remplissant provisoirement
les fonctions, à prononcer contre les indigènes
des punitions pouvant s’élever au maximum à quinze
jours d’emprisonnement et 5o fr. d’amende. Si le délinquant
est insolvable, l’amende est transformée en journées
de travail au taux de i fr. par jour.
Les peines doivent être prononcées par les administrateurs
publiquement et en présence du contrevenant.
La décision doit être motivée et est susceptible d’appel
auprès du gouverneur général en conseil d’administration,
si la peine excède cinq jours de prison et 25 fr.
d’amende. (Voir le texte de l’arrêté du 3o octobre igo4
pour le détail des infractions.)
Cette réglementation spéciale se justifie par la nécessité
de suppléer, dans un pays nouvellement conquis, à
une organisation judiciaire incomplète et d’assurer la
sécurité par une prompte répression. Mais il ne faut pas
perdre de vue qu’elle est contraire aux principes dé séparation
des pouvoirs, qui sont à la base de notre droit,
et ne saurait, en raison des abus qu’elle peut favoriser,
se perpétuer longtemps au delà de la pacification complète.
Pour ces diverses raisons, le gouverneur général
a déjà atténué, par l’arrêté du 3o octobre dernier,
la rigueur des dispositions réglementaires antérieures
et soumis 1 exercice des pouvoirs des administrateurs
en matière d indigénat a un contrôle particulièrement
étroit (*).
I. Les partisans du système de l’indîgénat estiment que la répression des
infractions que prévoit cette réglementation est assurée avec plus d’économie
et d’équité par les administrateurs, qui connaissent généralement mieux les
besoins et l’esprit des populations, que par les tribunaux. Cette remarque ne
manque certainement pas de justesse, mais, si elle justifie l’établissement
de l’indigénat à l’origine de l’occupation, elle perd sa force au fur et à mesure
que s’opère l’assimilation ou la fusion du.peuple soumis et du. conquérant.
C’est pour cela que l’indigénat, utile au début, doit disparaître dès que
le rapprochement est suffisant entre ces deux éléments, et que les ressources
financières du pays le permettent. Peut-être n’en sommes-hous pas là à
En outre des pouvoirs conférés aux administrateurs
par les textes précités sur l’indigéaat, le décret du 9 mars
1902, portant réorganisation de l’administration indigène
en Imerina, confère aux chefs des provinces de cette région
le droit d’interner dans telle localité qu’ils jugent
Convenable les délinquants habituels, rejetés de leur
fokon’olona (communauté indigène).
Les membres d’un fokon’olona peuvent, d’autre part,
être rendus collectivement ,et pécuniairement responsables
par les administrateurs dans certains cas déterminés.
(Art. 25 du décret précité ¡¡§¡¡1
Organisation de l ’administration indigène. — Sous
la surveillance des fonctionnaires français subsiste, ainsi
qu’on l’a dit, l’administration indigène.
L’application de la politique des races (2), instituée
pour détruire l’hégémonie hova et mieux asseoir notre
autorité, nous a contraints à varier l’organisation administrative
suivant le degré de développement intellectuel
et social des populations. La plus complète est celle de
l’Imerina, où les Hova observent à la perfection les règles
administratives élémentaires que le gouvernement général
leur a tracées. Les difficultés résultant de cette
variété d’organisation disparaîtront progressivement,
grâce à la création d’écoles administratives formant de
jeunes fonctionnaires, et donnant aux chefs indigènes
l’instruction professionnelle nécessaire à l’exercice raisonné
de leurs pouvoirs.
Pour cette raison, l’organisation administrative des
Madagascar, où, d’ailleurs, les instructions du gouverneur général prescrivent
aux administrateurs de faire usage de leurs pouvoirs disciplinaires
avec modération, et.où ces pouvoirs exceptionnels paraissent encore nécessaires
pour réprimer la mauvaise volonté ou la négligence dans le payement
des impôts (matière pour laquelle il en est fait usage plus particulièrement).
1. Voir p. a3g.
2, Système politique ayant pour effet de substituer, dans différentes régions
de 1 île, des chefs autochtones aux gouverneurs hova.