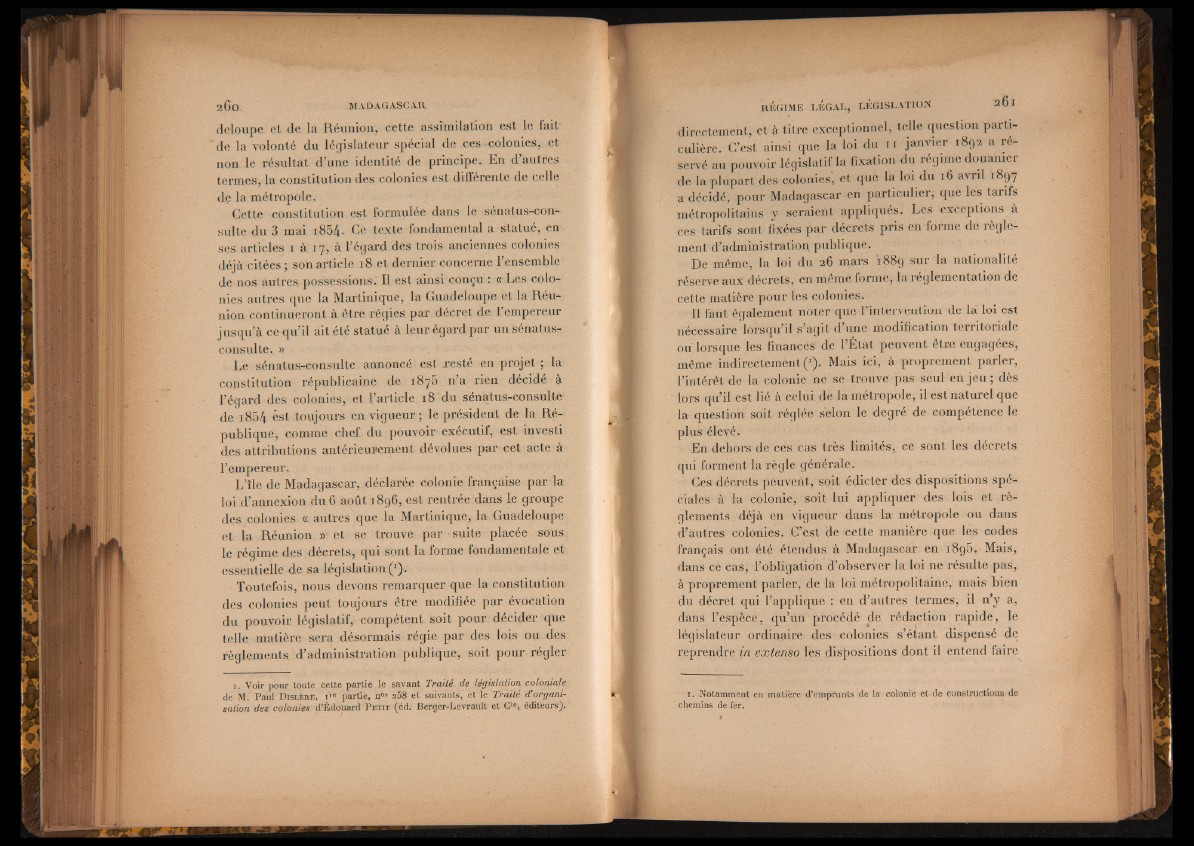
deloupe et de la Réunion, cette assimilation est le fait
de la volonté du législateur spécial de ces colonies, et
non le résultat d’une identité de principe. En d’autres
termes, la constitution des colonies est différente de celle
de la métropole.
Cette constitution est formulée dans le sénatus-con-
sulte du 3 mai i 854- Ce texte fondamental a statué, en
ses articles i à 17, à l’égard des trois anciennes colonies
déjà citées ; son article 18 et dernier concerne l’ensemble
de nos autres possessions. Il est ainsi conçu : « Les colonies
autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion
continueront à être régies par décret de l’empereur
jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard par un sénatuseonsulte.
» ,
Le sénatus-eonsulte annoncé est .resté en projet ; la
constitution républicaine de. 1875 n a rien décidé a
l’égard des colonies, et l’article 18 du sénatus-eonsulte
de i 854 est toujours en vigueur; le président de la République,
comme chef, du pouvoir exécutif, est investi
des attributions antérieurement dévolues par cet acte à
l’empereur.
L’île de Madagascar, déclarée colonie française par la
loi d’annexion du 6 août 1896, est rentrée dans le groupe
des colonies « autres que la Martinique, la Guadeloupe
et la Réunion » et se trouve par • suite placée sous
le régime des décrets, qui sont la forme fondamentale et
essentielle de sa législation Q .
Toutefois, nous devons remarquer que la constitution
des colonies peut toujours être modifiée par évocation
du pouvoir législatif, compétent soit pour décider que
telle matière sera désormais régie par des lois ou des
règlements d’administration publique, soit pour régler
1. Voir pour toute celte partie le savant Traité, de législation coloniale
de M. Paul D i s i . è r e , i™ partie, n°s 208 et suivants, et le Traité d’organisation
des colonies d’Édouard P e t i t (éd: Berger-Levrault et O , éditeurs).
directement, et à titre exceptionnel, telle question particulière.
C’est ainsi que la loi du 11 janvier 1892 a réservé
au pouvoir législatif la fixation du régime douanier
de la plupart des colonies*, et que la loi du 16 avril 1897
a décidé, pour Madagascar en particulier, que les tarifs
métropolitains y seraient appliques. Les exceptions à
ces tarifs sont fixées par décrets pris en forme de règlement
d’administration publique.
De même, la loi du 26 mars 1889 sur la nationalité
réserve aux décrets, en même forme, la réglementation de
cette matière pour les colonies.
Il faut également noter que l’intervention de la loi est
nécessaire lorsqu’il s’agit d’une modification territoriale
ou lorsque les finances de l’État peuvent être engagées,
même indirectement 0 . Mais ici, à proprement parler,
l’intérêt de la colonie ne se trouve pas seul en jeu ; dès
lors qu’il est lié à celui de la métropole, il est naturel que
la question soit réglée selon le degré de compétence le
plus élevé.
En dehors de ces cas très limités, ce sont les décrets
qui forment la règle générale.
Ces décrets peuvent, soit édicter des dispositions spéciales
à la colonie, soit lui appliquer des lois et règlements
déjà en vigueur dans la métropole ou dans
d’autres colonies. C’est de cette manière que les codes
français ont été étendus à Madagascar en 1895. Mais,
dans ce cas, l’obligation d’observer la loi ne résulte pas,
à proprement parler, de la loi métropolitaine, mais bien
du décret qui l’applique : en d’autres termes, il n’y a,
dans l’espèce, qu’un procédé de rédaction rapide, le
législateur ordinaire des colonies s’étant dispensé de
reprendre in extenso les dispositions dont il entend faire
i . Notamment en matière d’emprunts de la colonie et de constructions de
chemins de fer.