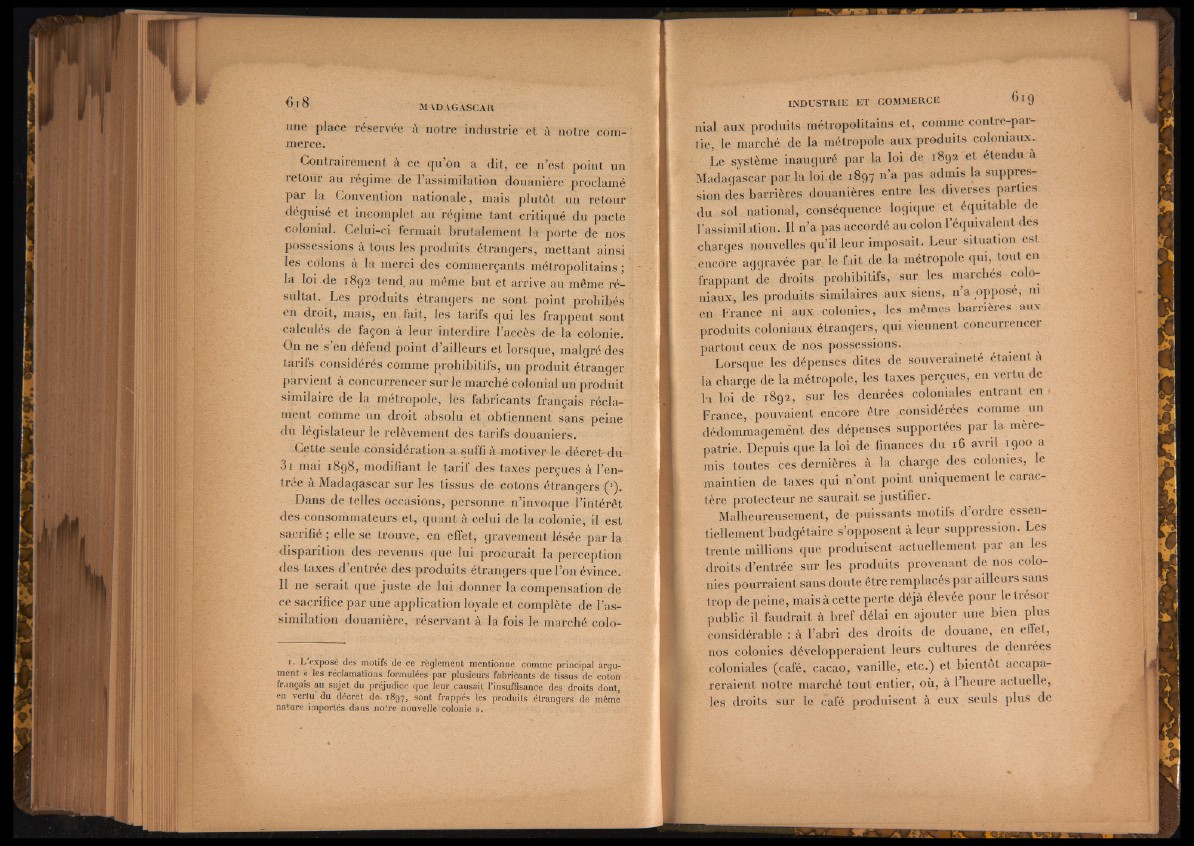
une place réservée à notre industrie et à notre commerce.
Contrairement à ce qu’on a dit, ce n’est point un
retour au régime de ¡’assimilation douanière proclamé
par la Convention nationale, mais plutôt un retour
déguisé et incomplet au régime tant critiqué du pacte
colonial. Celui-ci fermait brutalement la porte de nos
possessions à tous les produits étrangers, mettant ainsi
les colons à la merci des commerçants métropolitains ;
la loi de 1892 tend, au meme but et arrive au même résultat.
Les produits étrangers ne sopt point prohibés
en droit, mais, en fait, les tarifs qui les frappent sont
calculés de façon à leur interdire l’accès de la colonie.
On ne s en defend point d’ailleurs et lorsque, malgré des
tarifs considérés comme prohibitifs, un produit étranger
parvient à concurrencer sur le marché colonial un produit
similaire de la métropole, les fabricants français réclament
comme un droit absolu et obtiennent sans peine
du législateur le relèvement des tarifs douaniers.
Cette seule considération a suffi à motiver le décrets du
3 i mai 1898, modifiant le tarif des taxes perçues à l’entrée
à Madagascar sur les tissus de cotons étrangers (').
Dans de telles occasions, personne n’invoque l’intérêt
des consommateurs et, quant à celui de la colonie, il est
sacrifié ; elle se trouve, en effet, gravement lésée par la
disparition des revenus que lui procurait la perception
des taxes d’entrée des produits étrangers que l ’on évince.
Il ne serait que juste de lui donner la compensation de
ce sacrifice par une application loyale et complète de l’assimilation
douanière, réservant à la fois le marché colo-
1. L’exposé des motifs de ce règlement mentionne comme principal argument
« les réclamations formulées par plusieurs fabricants de tissus de cotoir
français au sujet du préjudice que leur causait l'insuffisance des droits dont,
en vertu du décret de.: 1897, sont frappés les produits étrangers de même
nature importés dans notre nouvelle colonie ».
niai aux produits métropolitains et, comme contre-pai-
tie, le marché de la métropole aux produits coloniaux.
Le système inauguré par la loi de 1892 et étendu à
Madagascar par la loi de 1897 n’a pas admis la suppression
des barrières douanières entre les diverses parties
du sol national, conséquence logique et équitable de
l'assimilation. 11 n’a pas accordé au colon l’équivalent des
charges nouvelles qu’il leur imposait. Leur situation est
encore aggravée par le fait de la métropole qui, tout en
frappant de droits prohibitifs, sur les xnarchés coloniaux,
les produits similaires aux siens, n’a opposé, ni
en France ni aux colonies, les mêmes barrières aux
produits coloniaux étrangers, qui viennent concurrencer
partout ceux de nos possessions.
Lorsque les dépenses dites de souveraineté étaient à
la charge dë la métropole, les taxes perçues, en vertu de
la loi de 1892, sur les denrées coloniales entrant en
France, pouvaient encore être considérées comme un
dédommagement des dépenses supportées par la mere-
patrie. Depuis que la loi de finances du 16 avril 1900 a
mis toutes ces dernières à la charge des colonies, le
maintien de taxes qui n’ont point uniquement le caractère
protecteur ne saurait se justifier.
Malheureusement, de puissants motifs d’ordre essentiellement
budgétaire s’opposent à leur suppression. Les
trente millions que produisent actuellement par an les
droits d’entrée sur les produits provenant de nos colonies
pourraient sans doute être remplacés par ailleurs sans
trop de peine, mais à cette perte déjà élevée pour le trésor
public il faudrait à bref délai en ajouter une bien plus
considérable : à l’abri des droits de douane, en effet,
nos colonies développeraient leurs cultures de denrées
coloniales (café, cacao, vanille, etc.) et bientôt accapareraient
notre marché tout entier, où, à l’heure actuelle,
les droits sur le café produisent à eux seuls plus de