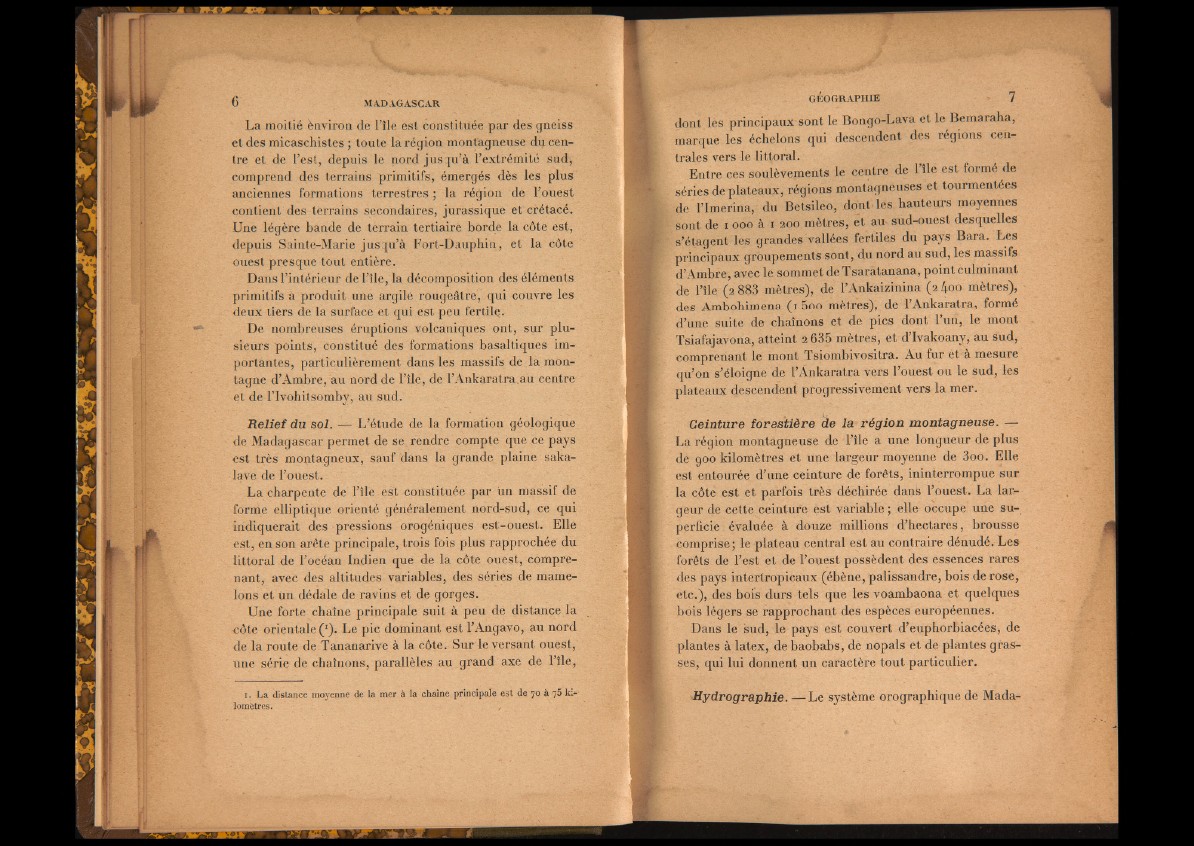
La moitié ènviron de l’île est constituée par des gneiss
et des micaschistes ; toute la région montagneuse du centre
et de l’est, depuis le nord jusqu’à l’extrémité sud,
comprend des terrains primitifs, émergés dès les plus
anciennes formations terrestres ; la région de l’ouest
contient des terrains secondaires, jurassique et crétacé.
Une légère bande de terrain tertiaire borde la côte est,
depuis Sainte-Marie jusqu’à Fort-Dauphin, et la côte
ouest presque tout entière.
Dans l’intérieur de l’île, la décomposition des éléments
primitifs à produit une argile rougeâtre, qui couvre les
deux tiers de la surface et qui est peu fertilç.
De nombreuses éruptions volcaniques ont, sur plusieurs
points, constitué des formations basaltiques importantes,
particulièrement dans les massifs de la montagne
d’Ambre, au nord de l’île, de l’Ankaratra au centre
et de l’Ivohitsomby, au sud.
Re lie f du sol. — L ’étude de la formation géologique
de Madagascar permet de se rendre compte que ce pays
est très montagneux, sauf dans la grande plaine saka-
lave de l’ouest.
La charpente de l’île est constituée par un massif de
forme elliptique orienté généralement nord-sud, ce qui
indiquerait des pressions orogéniques est-ouest. Elle
est, en son arête principale, trois fois plus rapprochée du
littoral de l’océan Indien que de la côte ouest, comprenant,
avec des altitudes variables, des séries de mamelons
et un dédale de ravins et de gorges.
Une forte chaîne principale suit à peu de distance la
côte orientale ('). Le pic dominant est l’Angavo, au nord
de la route de Tananarive à la côte. Sur le versant ouest,
une série de chaînons, parallèles au grand axe de l’île,
i . La dislance moyenne de la mer à la chaîne, principale est de 70 à 75 kilomètres.
/
dont les principaux sont le Bongo-Lava et le Bemaraha,
marque les échelons qui descendent des régions centrales
vers le littoral.
Entre ces soulèvements le centre de 1 île est formé de
séries de plateaux, régions montagneuses et tourmentées
de l’Imerina, du Betsileo, dont les hauteurs moyennes
sont de i ooo à i 200 mètres, et au- sud-ouest desquelles
s’étagent les grandes vallées fertiles du pays Bara. Les
principaux groupements sont, du nord au sud, les massifs
d’Ambre, avec le sommet de Tsàràtanana, point culminant
de l’île (2 883 mètres), de l’Ankaizinina (2 4oo mètres),
des Ambohimena (1 5oo mètres), de l’Ankaratra, formé
d’une suite de chaînons et de pics dont l’un, le mont
Tsiafajavona, atteint 2 635 mètres, et d’Ivakoany, au sud,
comprenant le mont Tsiombivositra. Au fur et à mesure
qu’on s’éloigne de l’Ankaratra vers l’ouest ou le sud, les
plateaux descendent progressivement vers la mer.
Ceinture forestière de la région montagneuse. —
La région montagneuse de l’île a une longueur de plus
de 900 kilomètres et une largeur moyenne de 3oô. Elle
est entourée d’une ceinture de forêts, ininterrompue sur
la côte est et parfois très déchirée danS l’ouest. La largeur
de cette ceinture est variable ; elle occupe une superficie
évaluée à douze millions d’hectares, brousse
comprise; le plateau central est au contraire dénudé. Les
forêts de l’est et de l’ouest possèdent des essences rares
des pays intertropicaux (ébène, palissandre, bois de rose,
etc.), des bois durs tels que les voambaona et quelques
bois légers se rapprochant des espèces européennes.
Dans le sud, le pays est couvert d’euphorbiacées, de
plantes à latex, de baobabs, de nopals et de plantes grasses,
qui lui donnent un caractère tout particulier.
Hydrographie. Le système orographique de Mada