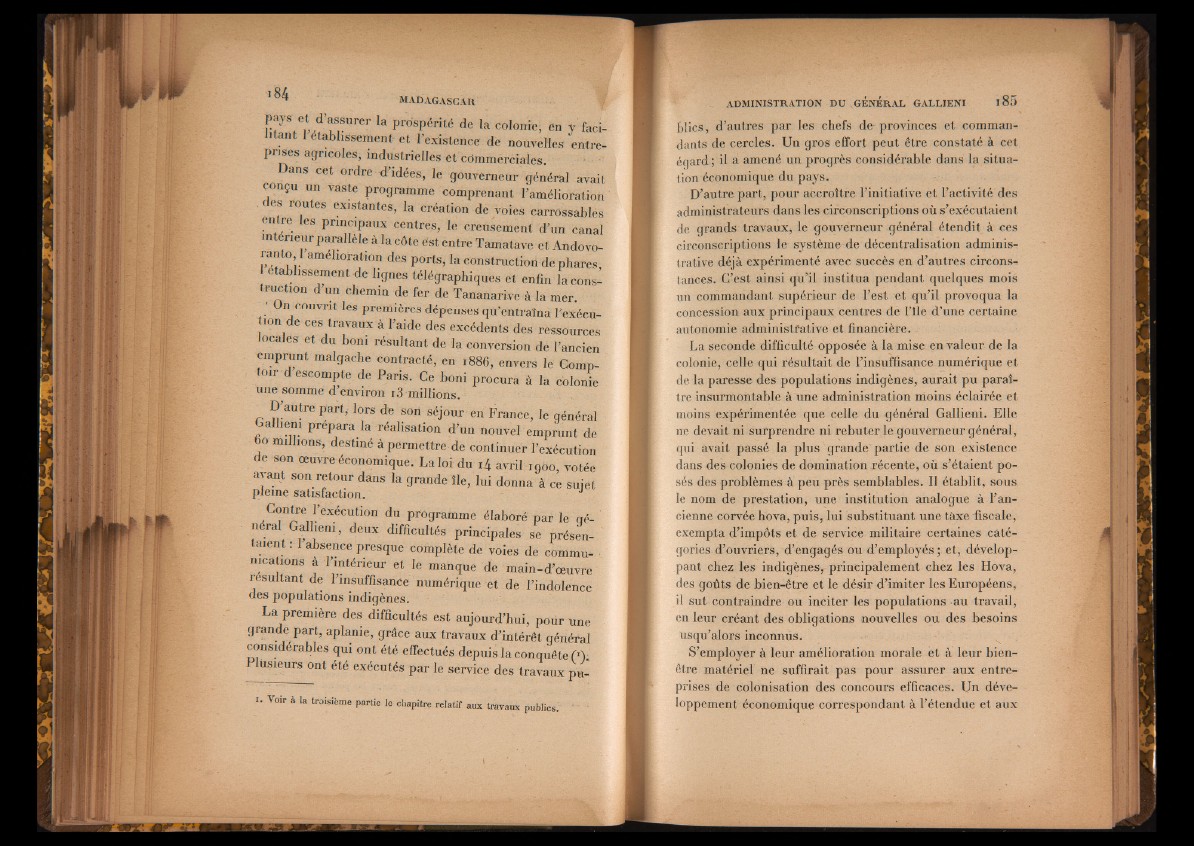
pays et d assurer la prospérité de la colonie^ en y fa c i-
litant 1 établissement et l ’existence de nouvelles entreprises
agricoles, industrielles et cdmmerciales
Dans cet ordre d’idées, le gouverneur général avait
conçu un vaste programme comprenant l’amélioration
es routes existantes, la création de voies carrossables
entre les principaux centres, le creusement d’un Canal
intérieur parallèle à la côte est entre Tamatave et Andovo-
ranto 1 amélioration des ports, la construction de phares,
établissement de lignes télégraphiques et enfin la construction
d un chemin de fer de Tananarive à la mer.
' n couvrit les premières dépenses qu’entraîna l’exécu-
îon de ces travaux à l’aide des excédents des ressources
locales et du boni résultant de la conversion dé l’ancien
emprunt malgache contracté, en 1886, envers le Comptoir
d escompte de Paris. Ce boni procura à la colonie
une somme d’environ 13 millions.
r ^ autre Part’ lors de son séjour en France, le général
Galheni prépara la réalisation d’un nouvel emprunt de
60 millions, destiné à permettre de continuer l’exécution
de son oeuvre économique. La loi du avril 1900, votée
ayant son retour dans la grande île, lui donna à ce sujet
pleine satisfaction.
Contre l’exécution du programme élaboré par le qé-
néral^ Galheni, deux difficultés principales se présentaient
: 1 absence presque complète de voies de commu-
mcations à l’intérieur et le manque de main-d’oeuvre
résultant de l’insuffisance numérique et de l ’indolence
des populations indigènes.
La première des difficultés est aujourd’hui, pour Une
grande part, aplanie, grâce aux travaux d’intérêt général
considérables qui ont été effectués depuis la conquête Cj
Plusieurs ont été exécutés par le service des travaux p«-
1. Voir à la troisième partie le chapitre relatif aux travaux publics.'
blics, d’autres par les chefs de provinces et commandants
de cercles. Un gros effort peut être constaté à cet
égard ; il a amené un progrès considérable dans la situation
économique du pays.
D’autre part, pour accroître l’initiative et l’activité des
administrateurs dans les circonscriptions où s’exécutaient
de grands travaux, le gouverneur général étendit à ces
circonscriptions le système de décentralisation administrative
déjà expérimenté avec succès en d’autres circonstances.
C’est ainsi qu’il institua pendant quelques mois
un commandant supérieur de l’est et qu’il provoqua la
concession aux principaux centres de l’île d’une certaine
autonomie administrative et financière.
La seconde difficulté opposée à la mise en valeur de la
colonie, celle qui résultait de l’insuffisance numérique et
de la paresse des populations indigènes, aurait pu paraître
insurmontable à une administration moins éclairée et
moins expérimentée que celle du général Gallieni. Elle
ne devait ni surprendre ni rebuter le gouverneur général,
qui avait passé la plus grande partie de son existence
dans des colonies de domination récente, où s’étaient posés
des problèmes à peu près semblables. Il établit, sous
le nom de prestation, une institution analogue à l’ancienne
corvée hova, puis, lui substituant une taxe fiscale,
exempta d’impôts et de service militaire certaines catégories
d’ouvriers, d’engagés ou d’employés ; et, développant
chez les indigènesr principalement chez les Hova,
des goûts de bien-être et le désir d’imiter les Européens,
il sut contraindre ou inciter les populations au travail,
en leur créant des obligations nouvelles ou des besoins
usqu’alors inconnus.
S’employer à leur amélioration morale et à leur bien-
être matériel ne suffirait pas pour assurer aux entreprises
de colonisation des concours efficaces. Un développement
économique correspondant à l’étendue et aux