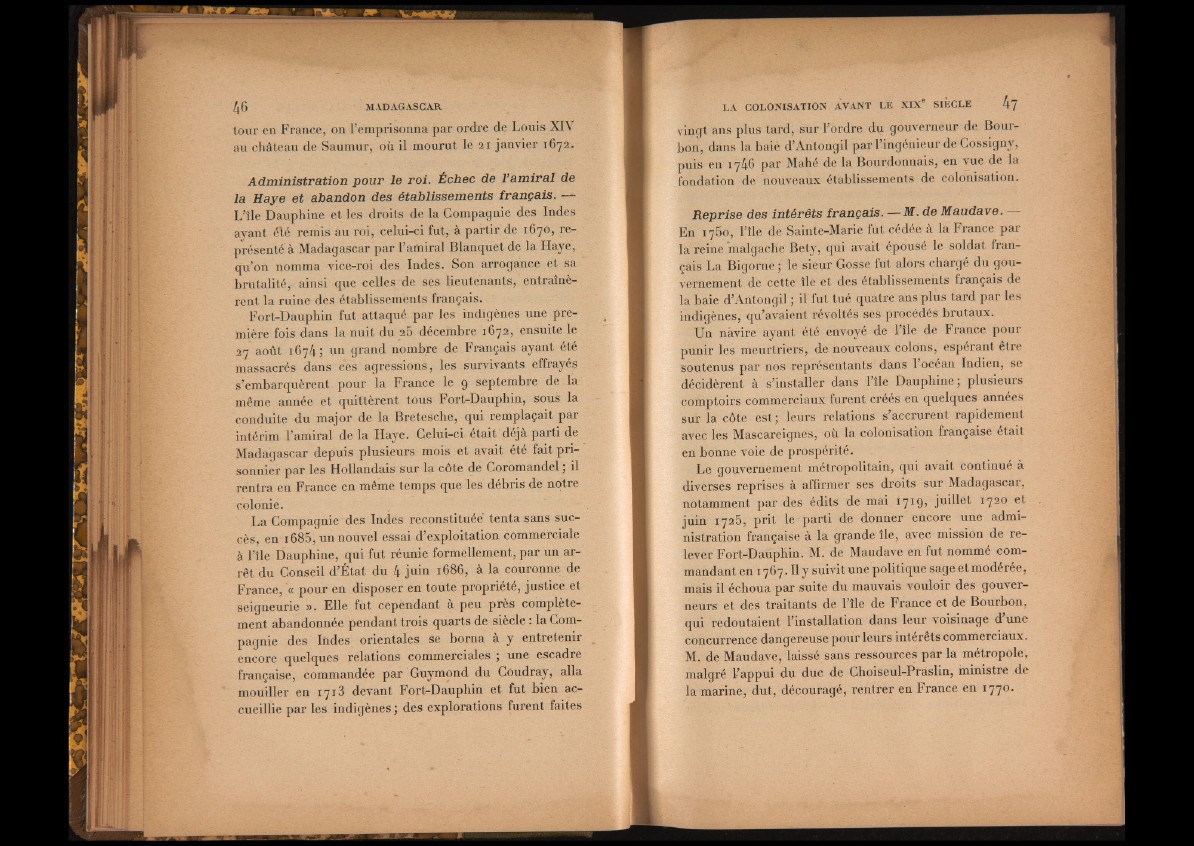
tour en France, on l’emprisonna par ordre de Louis XIV
au château de Saumur, où il mourut le 21 janvier 1672.
Administration pour le roi. Échec de l ’amiral de
la Haye et abandon des établissements français. —
L’île Dauphine et les droits de la Compagnie des Indes
ayant été remis au roi, celui-ci fut, à partir de 1670, représenté
à Madagascar par l’amiral Blanquet de la Haye,
qu’on nomma vice-roi des Indes. Son arrogance et sa
brutalité, ainsi que celles de ses lieutenants, entraînèrent
la ruine des établissements français.
Fort-Dauphin fut attaqué par les indigènes une première
fois dans la nuit du 25 décembre 1672, ensuite le
27 août 1674? un grand nombre de Français ayant été
massacrés dans ces agressions, les survivants effrayés
s’embarquèrent pour la France le 9 septembre de la
même année et quittèrent tous Fort-Dauphin, sous la
conduite du major de la Bretesche, qui remplaçait par
intérim l’amiral de la Haye. Celui-ci était déjà parti de
Madagascar depuis plusieurs mois et avait été fait prisonnier
par les Hollandais sur la côte de Coromandel ; il
rentra en France en même temps que les débris de notre
colonie.
La Compagnie des Indes reconstituée tenta sans succès,
en i 685, un nouvel essai d’exploitation commerciale
à l’île Dauphine, qui fut réunie formellement, par un arrêt
du Conseil d’État du 4 juin 1686, à la couronne de
France, "« pour en disposer en toute propriété, justice et
seigneurie ». Elle fut cependant à peu près complètement
abandonnée pendant trois quarts de siècle : la Compagnie
des Indes orientales se borna a y entretenir
encore quelques relations commerciales ; une escadre
française, commandée par Guymond du Coudray, alla
mouiller en 1713 devant Fort-Dauphin et fut bien accueillie
par les indigènes ; des explorations furent faites
vingt ans plus tard, sur l’ordre du gouverneur de Bourbon,
dans la baiè d’Antongil par l’ingénieur de Cossigny,
puis en 1746 par Mahé de la Bourdonnais, en vue de la
fondation de nouveaux établissements de colonisation.
Reprise des intérêts français. — M. de Maudave. —
En 1750, l’île de Sainte-Marie fut cédée à la France par
la reine malgache Bety, qui avait épousé le soldat français
La Bigorne ; le sieur Gosse fut alors chargé du gouvernement
de cette île et des établissements français de
la baie d’Àntongil ; il fut tué quatre ans plus tard par les
indigènes, qu’avaient révoltés ses procédés brutaux.
Un navire ayant été envoyé de l’île de France pour
punir les meurtriers, de nouveaux colons, espérant être
soutenus par nos représentants dans 1 océan Indien, se
décidèrent à s’installer dans l’île Dauphine ; plusieurs
comptoirs commerciaux furent créés en quelques années
sur la côte est; leurs relations s’accrurent rapidement
avec les Mascareignes, ou la colonisation française était
en bonne voie de prospérité.
Le gouvernement métropolitain, qui avait continué à
diverses reprises à affirmer ses droits sur Madagascar,
notamment par des édits de mai 1719, juillet 1720 et
juin 1725, prit le parti de donner encore une administration
française à la grande île, avec mission de relever
Fort-Dauphin. M. de Maudave en fut nommé commandant
en 1767. Il y suivit une politique sage et modérée,
mais il échoua par suite du mauvais vouloir des gouverneurs
et des traitants de l’île de France et de Bourbon,
qui redoutaient l’installation dans leur voisinage d une
concurrence dangereuse pour leurs intérêts commerciaux.
M. de Maudave, laissé sans ressources par la métropole,
malgré l’appui du duc de Choiseul-Praslin, ministre de
la marine, dut, découragé, rentrer en France en 1770.