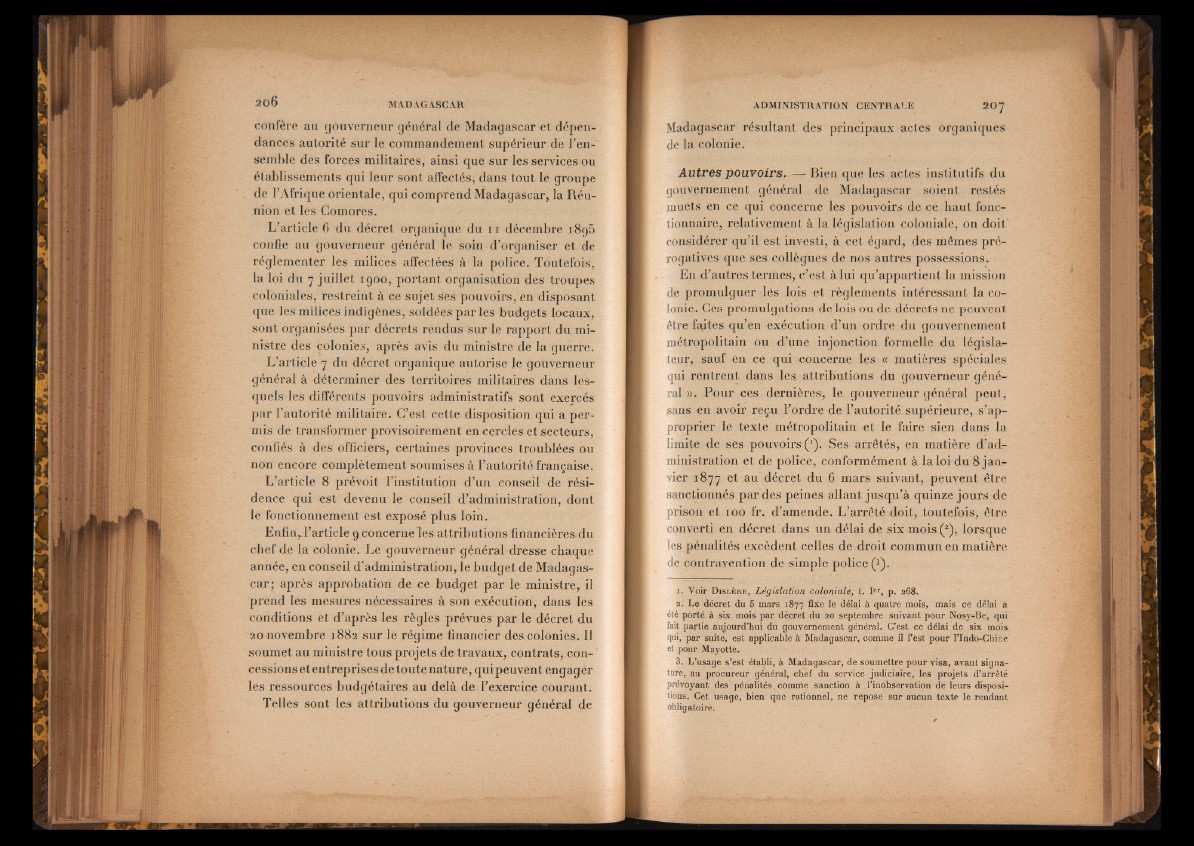
confère au gouverneur général de Madagascar et dépendances
autorité sur le commandement supérieur de Ten-
semble des forces militaires, ainsi que sur les services ou
établissements qui leur sont affectés, dans tout le groupe
de l’Afrique orientale, qui comprend Madagascar, la Réunion
et les Comores.
L’article 6 du décret organique du n décembre 1895
confie au gouverneur général le soin d’organiser et de
réglementer les milices affectées à la police. Toutefois,
la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes
coloniales, restreint à ce sujet ses pouvoirs, en disposant
que les milices indigènes, soldées par les budgets locaux,
sont organisées par décrets rendus sur le rapport du ministre
des colonies, après avis du ministre de la guerre.
L’article 7 du décret organique autorise le gouverneur
général à déterminer des territoires militaires dans lesquels
les différents pouvoirs administratifs sont exercés
par l’autorité militaire. C’est cette disposition qui a permis
de transformer provisoirement en cercles et secteurs,
confiés à des officiers, certaines provinces troublées ou
non encore complètement soumises à l’autorité française.
L’article 8 prévoit l’institution d’un conseil de résidence
qui est devenu le conseil d’administration, dont
le fonctionnement est exposé plus loin.
Enfin,T’article 9 concerne les attributions financières du
chef de la colonie. Le gouverneur général dresse chaque
année, en conseil d’administration, le budget de Madagascar;
après approbation de ce budget par le ministre, il
prend les mesures nécessaires à son exécution, dans les
conditions et d’après les règles prévues par le décret du
20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies. Il
soumet au ministre tous projets de travaux, contrats, concessions
et entreprises de toute nature, qui peuvent engager
les ressources budgétaires au delà de l’exercice courant.
Telles sont les attributions du gouverneur général de
Madagascar résultant des principaux actes organiques
de la colonie.
Autres pouvoirs. — Bien que les actes institutifs du
gouvernement général de Madagascar soient restés
muets en ce qui concerne les pouvoirs de ce haut fonctionnaire,
relativement à la législation coloniale, on doit'
considérer qu’il est investi, à cet égard, des mêmes prérogatives
que ses collègues de nos autres possessions.
En d’autres termes, c’est à lui qu’appartient la mission
de promulguer lés lois et règlements intéressant la colonie.
Ces promulgations de lois ou de décrets ne peuvent
être faites qu’en exécution d’un ordre du gouvernement
métropolitain ou d’une injonction formelle du législateur,
sauf en ce qui concerne les « matières spéciales
qui rentrent dans les attributions du gouverneur général
». Pour ces dernières, le gouverneur général peut,
sans en avoir reçu l’ordre de l’autorité supérieure, s’approprier
le texte métropolitain et le faire sien dans la
limite de ses pouvoirs (:). Ses arrêtés, en matière d’administration
et de police, conformément à laloi-du 8 janvier
1877 au décret du 6 mars suivant, peuvent être
sanctionnés par des peines allant jusqu’à quinze jours de
prison et 100 fr. d’amende. L’arrêté doit, toutefois, être
converti en décret dans un délai de six mois (2), lorsque
les pénalités excèdent celles de droit commun en matière
de contravention de simple police (3).
1. Voir D i s l è r e , Législation coloniale, f. Ier, p. 268.
a. Le décret du 5 mars 1877 fixe le délqi à quatre mois, mais ce délai a
été porté à six mois par décret du 20 septembre suivant pour Nosy-Be, qui
fait partie aujourd’hui du gouvernement général. C’est ce délai de six mois
qui, par suite, est applicable à Madagascar, comme il l’est pour l’Indo-Chine
et pour Mayotte.
3. L’usage s’est établi, à Madagascar, de soumettre pour visa, avant signature,
au procureur général, chef du service judiciaire, les projets d’arrêté
prévoyant des pénalités . comme sanction à l’inobservation de leurs dispositions.
Cet usage, bien que rationnel, ne repose sur aucun texte le rendant
obligatoire.