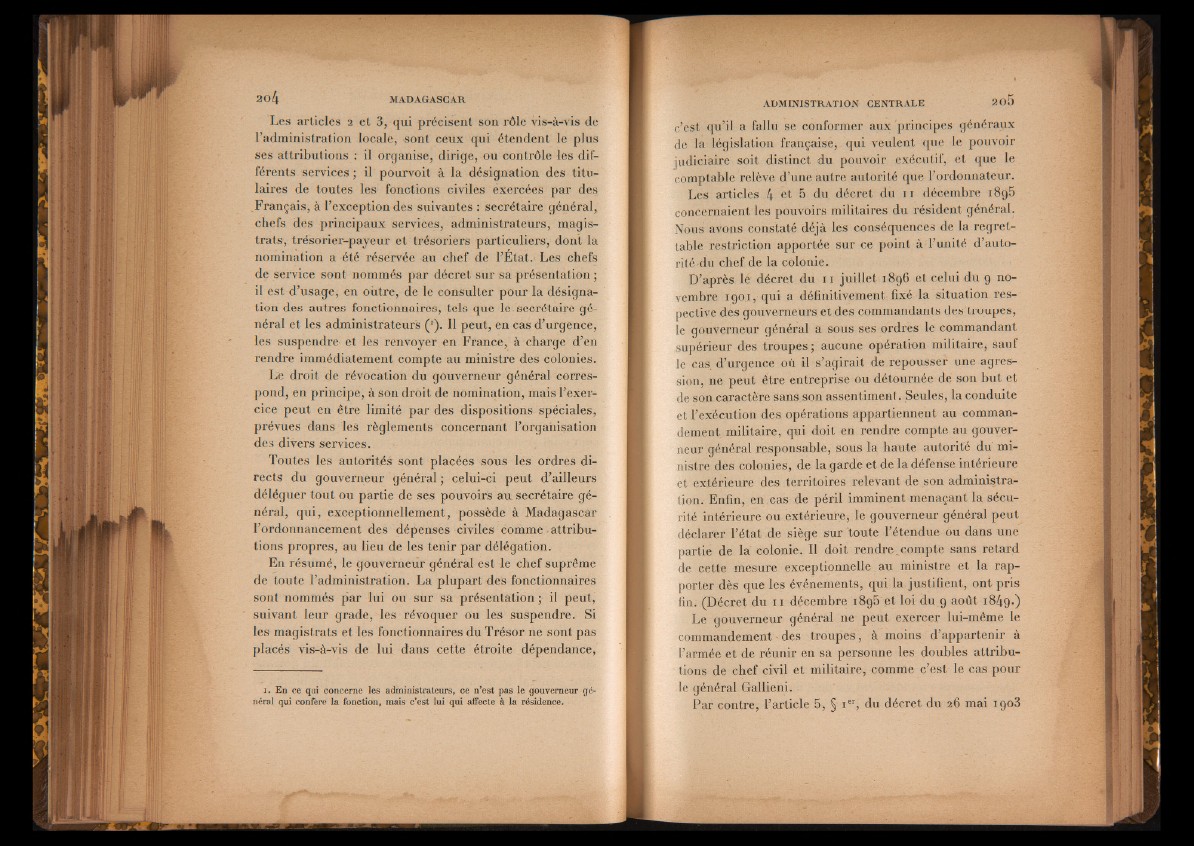
Les articles 2 et 3, qui précisent son rôle vis-à-vis de
l’administration locale, sont ceux qui étendent le plus
ses attributions : il organise, dirige, ou contrôle les différents
services ; il pourvoit à la désignation des titulaires
de toutes les fonctions civiles exercées par des
Français, à l’exception des suivantes : secrétaire général,
chefs des principaux services, administrateurs, magistrats,
trésorier-payeur et trésoriers particuliers, dont la
nomination a été réservée au chef de l’Etat. Les chefs
de service sont nommés par décret sur sa présentation ;
il est d’usage, en outre, de le consulter pour la désignation
des autres fonctionnaires, tels que le secrétaire général
et les administrateurs (*). Il peut, en cas d’urgence,
les suspendre et les renvoyer en France, à charge d’en
rendre immédiatement compte au ministre des colonies.
Le droit de révocation du gouverneur général correspond,
en principe, à son droit de nomination, mais l’exercice
peut en être limité par des dispositions spéciales,
prévues dans les règlements concernant l’organisation
des divers services.
Toutes les autorités sont placées sous les ordres directs
du gouverneur général ; celui-ci peut d’ailleurs
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au secrétaire général,
qui, exceptionnellement, possède à Madagascar
l’ordonnancement des dépenses civiles comme - attributions
propres, au lieu de les tenir par délégation.
En résumé, le gouverneur général est le chef suprême
de toute l’administration. La plupart des fonctionnaires
sont nommés par lui ou sur sa présentation ; il peut,
suivant leur grade, les révoquer ou les suspendre. Si
les magistrats et les fonctionnaires du Trésor ne sont pas
placés vis-à-vis de lui dans cette étroite dépendance,
1. En ce qui concerne les administrateurs, ce n’est pas le gouverneur général
qui confère la fonction, mais c’est lui qui affecte à la résidence.
c’est qu’il a fallu se conformer aux principes généraux
de la législation française, qui veulent que le pouvoir
judiciaire soit distinct du pouvoir exécutif, et que le
comptable relève d’une autre autorité que l’ordonnateur.
Les articles 4 et 5 du décret du 11 décembre i 8g5
concernaient les pouvoirs militaires du résident général.
Nous avons constaté déjà les conséquences de la regrettable
restriction apportée sur ce point à l’unité d’autorité
du chef de la colonie.
D’après lé décret du 11 juillet 1896 et celui du 9 novembre
1901, qui a définitivement fixé la situation respective
des gouverneurs et des commandants des troupes,
le gouverneur général a sous ses ordres le commandant
supérieur des troupes ; aucune opération militaire* sauf
le cas. d’urgence où il s’agirait de repousser une agression,
11e peut être entreprise ou détournée de son but et
de son caractère sans son assentiment. Seules, la conduite
et l’exécution des opérations appartiennent au commandement
militaire, qui doit en rendre compte au gouverneur
général responsable, sous la haute autorité du ministre
des colonies, de la garde et de la défense intérieure
et extérieure des territoires relevant de son administration.
Enfin, en cas de péril imminent menaçant la sécurité
intérieure ou extérieure, le gouverneur général peut
déclarer l’état de siège sur toute l’étendue ou dans une
partie de la colonie. Il doit rendre.compte sans retard
de cette mesure exceptionnelle au ministre et la rapporter
dès que les événements, qui la justifient, ont pris
fin. (Décret du 11 décembre 1895 et loi du 9 août 1849-)
Le gouverneur général ne peut exercer lui-même le
commandement - des troupes, à moins d’appartenir à
l’armée et de réunir en sa personne les doubles attributions
de chef civil et militaire, comme c’est le cas pour
le général Gallieni.
Par contre, l’article 5, § Ier, du décret du 26 mai 1903