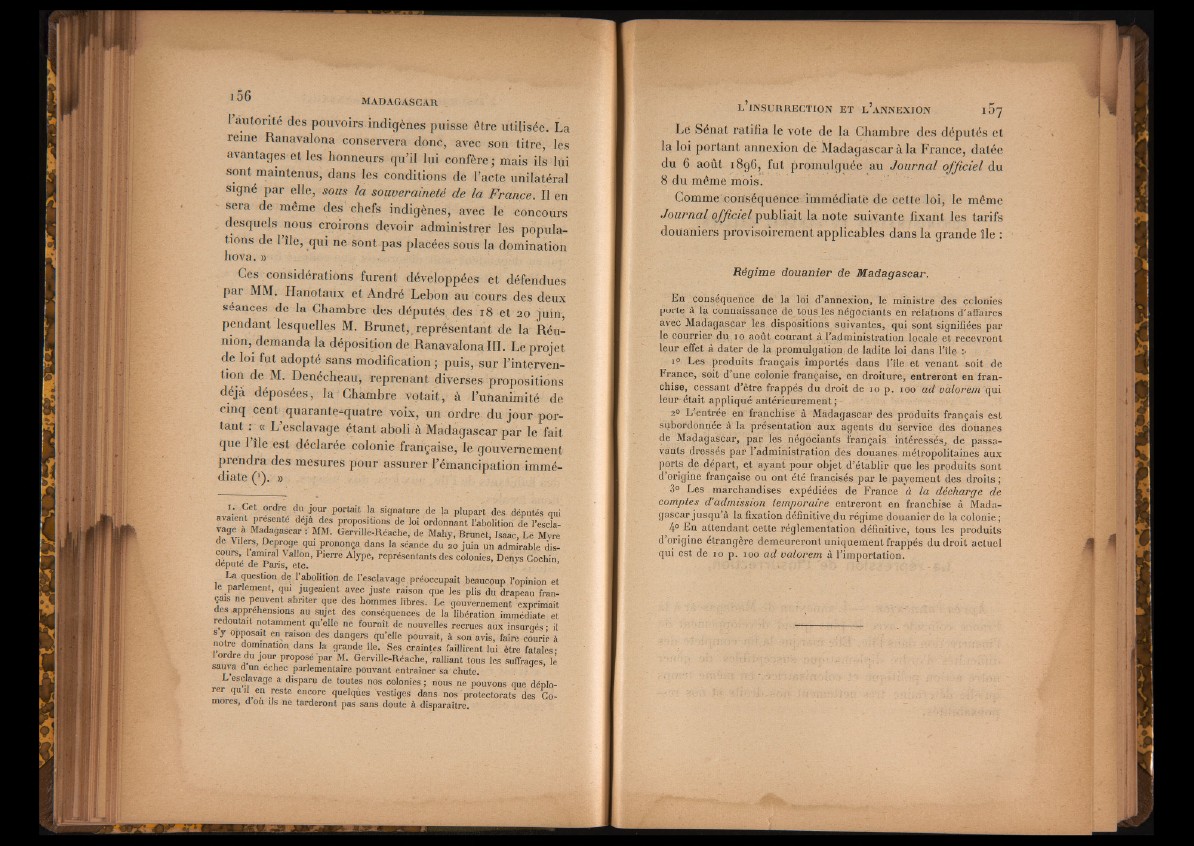
1 autorité des pouvoirs indigènes puisse être utilisée. La
reine Ranavalona conservera donc, avec son titre, les
avantages et les honneurs qu’il lui confère; mais ils lui
sont maintenus, dans les conditions de l’acte unilatéral
signé par elle, sous la souveraineté de la France. Il en
- sera de même des chefs indigènes, avec le concours
desquels nous croirons devoir administrer les populations
de I île, qui ne sont pas placées sous la domination
hova. »
Ces considérations furent développées et défendues
par MM. Hanotaux et André Lebon au cours des deux
séances de la Chambre des députés, des 18 et 20 juin,
pendant lesquelles M. Brunet,. représentant de la Réunion,
demanda la déposition de Ranavalona III. Le projet
de loi fut adopté sans modification ; puis, sur l’ intervention
de M. Denécheau, reprenant diverses propositions
déjà déposées, la Chambre votait, à l’ufianimité de
cinq cent quarante^-quatre voix, un ordre du jour portant
: « L esclavage étant aboli à Madagascar par le fait
que 1 île est déclarée colonie française, le gouvernement
prendra des mesures pour assurer l’émancipation immédiate
(?). »
Û Cet ordre du jour portait la signature de Ja plupart des députés qui
avaient présente déjà des propositions de loi ordonnant l’abolition de l’escla-
vage^a Madagascar : MM. Gerville-Réache, de Mahy, Brunèt, Isàac, Lé Myre
de Vilers, Deproge qui prononça dans la séance du 20 juin un admirable discoins,
lamiral Vallon, Pierre Alype, représentants des colonies, Denys Cochin
député de Pans, etc. ’ . . ’
La question de l’abolition de l’esclavage, préoccupait beaucoup l’opinion et
le parlement, qm jugeaient avec juste raison que les plis du drapeau français
ne peuvent abnter que des hommes libres. Le gouvernement exprimait
des appréhensions au sujet des conséquences de la libération immédiate et
redoutait notamment qu’elle ne fournît de nouvelles recrues aux insurqés • il
s y opposait en raison des dangers qu’elle pouvait, à son avis, faire courir à
notre domination dans la grande île. Ses craintes faillirent lui être fatales-
ordre du jour proposé 'par M. Gerville-Réache, ralliant tous les suffrages, lé
sauva dun échec parlementaire pouvant entraîner sa chute.
L esclavage a disparu de toutes nos colonies ; nous ne pouvons que déplorer
quil en reste encore quelques vestiges dans nos protectorats des Comores,
d ou ils ne tarderont pas sans doute à disparaître.
Lé Sénat ratifia le vote de la Chambre des députés et
la loi portant annexion de Madagascar à la France, datée
du 6 août 1896, fut promulguée au Journal officiel du
8 du même mois.
Comme conséquence immédiate de cette loi, le même
Journal officiel publiait la note suivante fixant les tarifs
douaniers provisoirement applicables dans la grande île :
Régime douanier de Madagascar.
E n , conséquence de la loi d’ annexion, le ministre des colonies
porte à la connaissance de tous les négociants en relations d’affaires
avec Madagascar les dispositions suivantes, qui sont signifiées par
le courrier du 10 août courant à l’administration locale et recevront
leur effet à dater de la promulgation, de ladite loi dans l’île :•
i° Les produits français importés dans l’île et venant soit de
h rance, soit d une colonie française, en droiture, entreront en franchise,
cessant d’être frappés du droit de 10 p. 100 ad valorem qui
leur- était appliqué antérieurement ;
2° L’entrée en franchise à Madagascar des produits français est
subordonnée à la présentation aux agents du service des douanes
de Madagascar, par. les négociants français, intéressés,, de passavants
dressés par l’administration des douanes métropolitaines aux
ports dé départ, et ayant pour objet d’établir que les produits sont
d origine française ou ont été francisés par le payement des droits ;
3° Les marchandises expédiées de France à la décharge de
comptes d’admission temporaire entreront en franchise à Madagascar
jusqu’à la fixation définitive du régime douanier de la colonie ;
4° En attendant cette réglementation définitive, tous les produits
d’origine étrangère demeureront uniquement frappés du droit actuel
qui est de 10 p. 100 ad valorem à l ’importation.