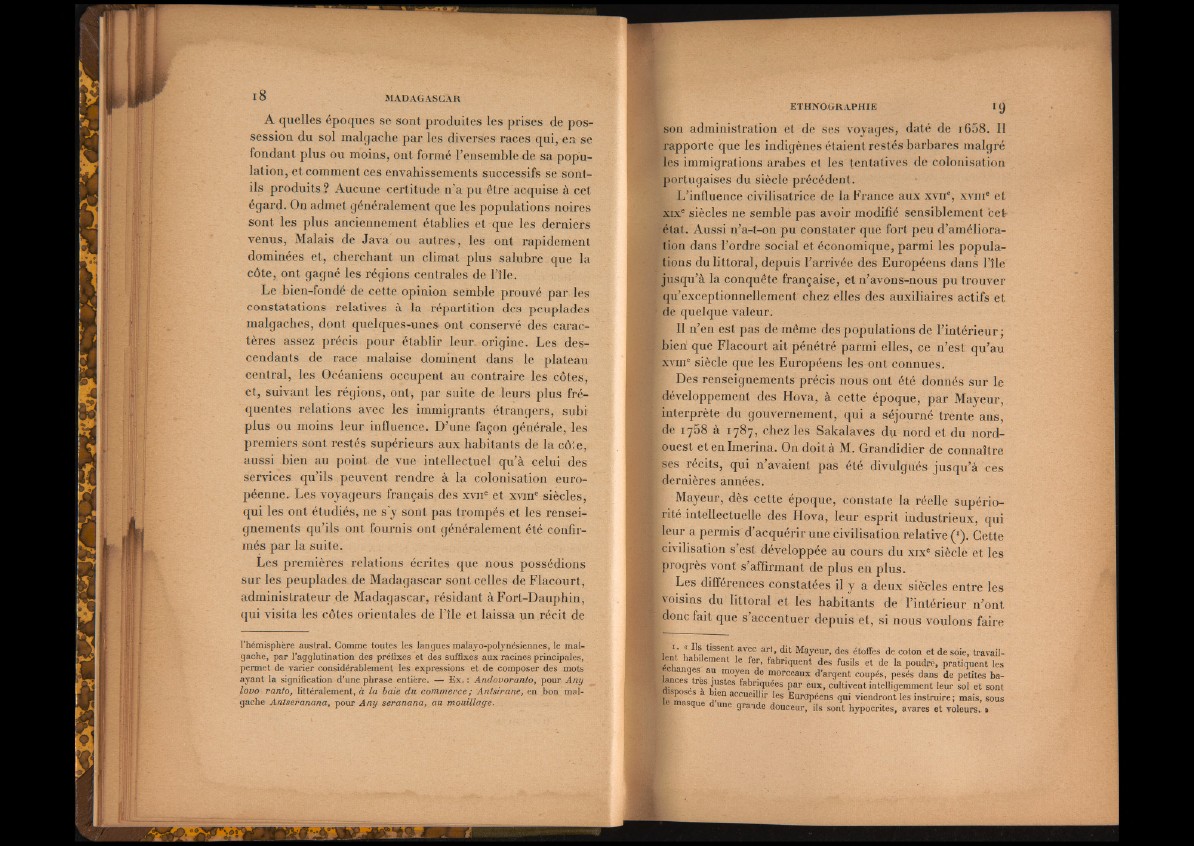
A quelles époques se sont produites les prises de possession
du sol malgache par les diverses races qui, en se
fondant plus ou moins, ont formé l’ensemble de sa population,
et comment ces envahissements successifs se sont-
ils produits ? Aucune certitude n’a pu être acquise à cet
égard. Ou admet généralement que les populations noires
sont les plus anciennement établies et que les derniers
venus, Malais de Java ou autres, les ont rapidement
dominées et, cherchant un climat plus salubre que la
côte, ont gagné les régions centrales de l’île.
Le bien-fondé de cette opinion semble prouvé par les
constatations relatives à la répartition des peuplades
malgaches, dont quelques-unes ont conservé des caractères
assez précis pour établir leur origine. Les descendants
de race malaise dominent dans le plateau
central, les Océaniens occupent au contraire les côtes,
et, suivant les régions, ont, par suite de leurs plus fréquentes
relations avec les immigrants étrangers, subi
plus ou moins leur influence. D’une façon générale, les
premiers sont restés supérieurs aux habitants de la côte,
aussi bien au point de vue intellectuel qu’à celui des
services qu’ils peuvent rendre à la colonisation européenne.
Les voyageurs français des xvne et xvme siècles,
qui les ont étudiés, ne s’y sont pas trompés et les renseignements
qu’ils ont fournis ont généralement été confirmés
par la suite.
Les premières relations écrites que nous possédions
sur les peuplades de Madagascar sont celles de Flacourt,
administrateur de Madagascar, résidant à Fort-Dauphin,
qui visita les côtes orientales de l’île et laissa un récit de
l’hémisphère austral. Gomme toutes les langues malayo-polynésiennes, le malgache,
par l’agglutination des préfixes et des suffixes aux racines principales,
permet de varier considérablement les expressions et de composer des mots
ayant la signification d’une phrase entière. — Ex. : Andovoranto, pour Any
lovo ranto, littéralement, à la baie du commerce ; Antsirane, en bon malgache
Antseranana, pour Any seranana, au mouillage.
e t h n o g r a p h i e 19
son administration et de ses voyages, daté de i 658. Il
rapporte que les indigènes étaient restés barbares malgré
les immigrations arabes et les tentatives de colonisation
portugaises du siècle précédent.
L’influence civilisatrice de la France aux xvne, xvni* et
xixe siècles ne semble pas avoir modifié sensiblement fcefr
état. Aussi n’a-t-on pu constater que fort peu d’amélioration
dans l’ordre social et économique, parmi les populations
du littoral, depuis l’arrivée des Européens dans l’île
jusqu’à la conquête française, et n’avons-nous pu trouver
qu’exceptionnellement chez elles des auxiliaires actifs et
de quelque valeur.
Il n’en est pas de même des populations de l’intérieur;
bien que Flacourt ait pénétré parmi elles, ce n’est qu’au
xvme siècle que les Européens les ont connues.
Des renseignements précis nous ont été donnés sur le
développement des Hova, à cette époque, par Mayeur,
interprète du gouvernement, qui a séjourné trente ans,
de 1758 à 1787, chez les Sakalaves du nord et du nord-
ouest et en Imerina. On doit à M. Grandidier de connaître
ses récits, qui n avaient pas été divulgués jusqu’à ces
dernières années.
Mayeur, dès cette époque, constate la réelle supériorité
intellectuelle des Hova, leur esprit industrieux, qui
leur a permis'd’acquérir une civilisation relative (l). Cette
civilisation s’est développée au cours du xixe siècle et les
progrès vont s’affirmant de plus en plus,
j. Les différences constatées il y a deux siècles entre les
voisins du littoral et les habitants de l’intérieur n’ont
jjdonc fait que s’accentuer depuis et, si nous voulons faire
I k 1. t’SSent avec art> dit Mayeur, des étoffes de coton et de soie, travail-
en a ement le fer, fabriquent des fusils et de la poudre, pratiquent les
ec langes au moyen de morceaux d’argent coupés, pesés dans de petites ba-
ances res justes fabriquées par eux, cultivent intelligemment leur sol et sont
isposes îen accueillir les Européens qui viendront les instruire ; mais, sous
»m a sq u e une grande douceur, ils sont hypocrites, avares et voleurs. »