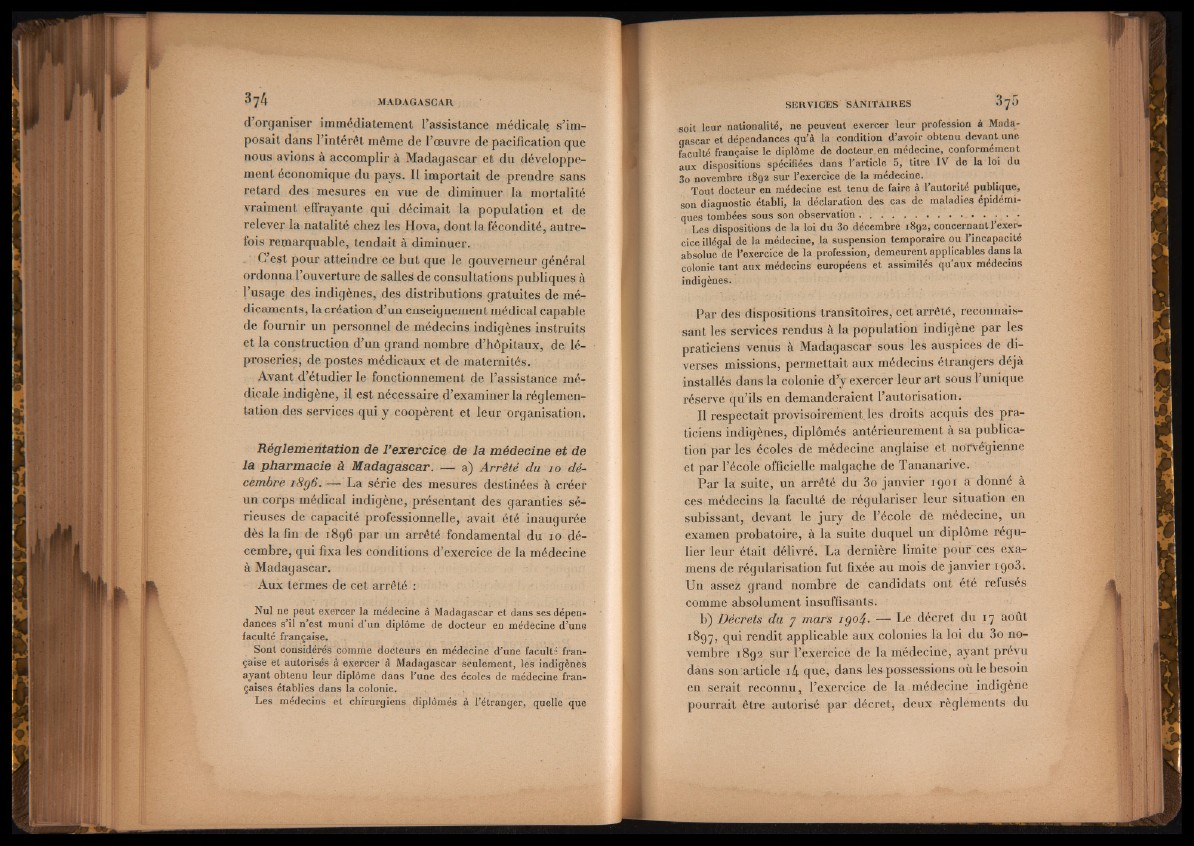
d’organiser immédiatement l’assistance médicale s’imposait
dans l’intérêt même de l’oeuvre de pacification que
nous avions à accomplir à Madagascar et du développement
économique du pays. II importait de prendre sans
retard des mesures en vue de diminuer la mortalité
vraiment effrayante qui décimait la population et de
relever la natalité chez les Hova, dont la fécondité, autrefois
remarquable, tendait à diminuer.
C’est pour atteindre ce but que le gouverneur général
ordonna l’ouverture de salles de consultations publiques à
l’usage des indigènes, des distributions gratuites de médicaments,
la création d’un enseignement médical capable
de fournir un personnel de médecins indigènes instruits
et la construction d’un grand nombre d’hôpitaux, de léproseries,
de postes médicaux et de maternités.
Avant d’étudier le fonctionnement de l’assistance médicale
indigène, il est nécessaire d’examiner la réglementation
des services qui y coopèrent et leur organisation.
Réglementation de l ’exercice de la médecine et de
la p h a rm a c ie à M ada gascar . — a) Arrêté du 10 décembre
i 8g6. — La série des mesures destinées à créer
un corps médical indigène, présentant des garanties sérieuses
de capacité professionnelle, avait été inaugurée
dès la fin de 1896 par un arrêté fondamental du 10 décembre,
qui fixa les conditions d’exercice de la médecine
à Madagascar.
Aux termes de cet arrêté :
Nul ne peut exercer la médecine à Madagascar et dans ses dépendances
s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine d’une
faculté française.
Sont considérés Comme docteurs en médecine d’une faculté française
et autorisés à exercer à Madagascar seulement, les indigènes
ayant obtenu leur diplôme dans l’une des écoles de médecine françaises
établies dans la colonie.
Les médecins et chirurgiens diplômés à l’étranger, quelle que
soit leur nationalité, ne peuvent exercer leur profession à Madagascar
et dépendances qu’à la condition d’avoir obtenu devant une
faculté française le diplôme de docteur,en médecine, conformément
aux dispositions spécifiées dans l’article 5, titre IV de la loi du
3o novembre 1892 sur l’exercice de la médecine.
Tout docteur en médecine est tenu de faire à l’autorité publique,
son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques
tombées sous son observation. . . . . . . . .
Les dispositions de la loi du 3o décembre 1892, concernant l’exercice
illégal de la médecine, la suspension temporaire ou l’incapacité
absolue de l’exercice de la profession, demeurent applicables dans la
colonie tant aux médecins européens et assimilés qu’aux médecins
indigènes.
Par des dispositions transitoires, cet arrêté, reconnaissant
les services rendus à la population indigène par les
praticiens venus à Madagascar sous les auspices de diverses
missions, permettait aux médecins étrangers déjà
installés dans la colonie d’y exercer leur art sous l’unique
réserve qu’ils en demanderaient l’autorisation.
Il respectait provisoirement les droits acquis des praticiens
indigènes, diplômés antérieurement à sa publication
par les écoles de médecine anglaise et norvégienne
et par l’école officielle malgache de Tananarive.
Par la suite, un arrêté du 3o janvier 1901 a donné à
ces médecins la faculté de régulariser leur situation en
subissant, devant le jury de l’école de médecine, un
examen probatoire, à la suite duquel un diplôme régulier
leur était délivré. La dernière limite pour ces examens
de régularisation fut fixée au mois de janvier igo3.
Un assez grand nombre de candidats ont été refusés
comme absolument insuffisants.
b) Décrets du 7 mars igo4. — Le décret du 17 août
1897, qui rendit applicable aux colonies la loi du 3o novembre
1892 sur l’exercice de la médecine, ayant prévu
dans son article i4 que, dans les possessions où le besoin
en serait reconnu, l’exercice de la.médecine indigène
pourrait être autorisé par décret, deux règlements du