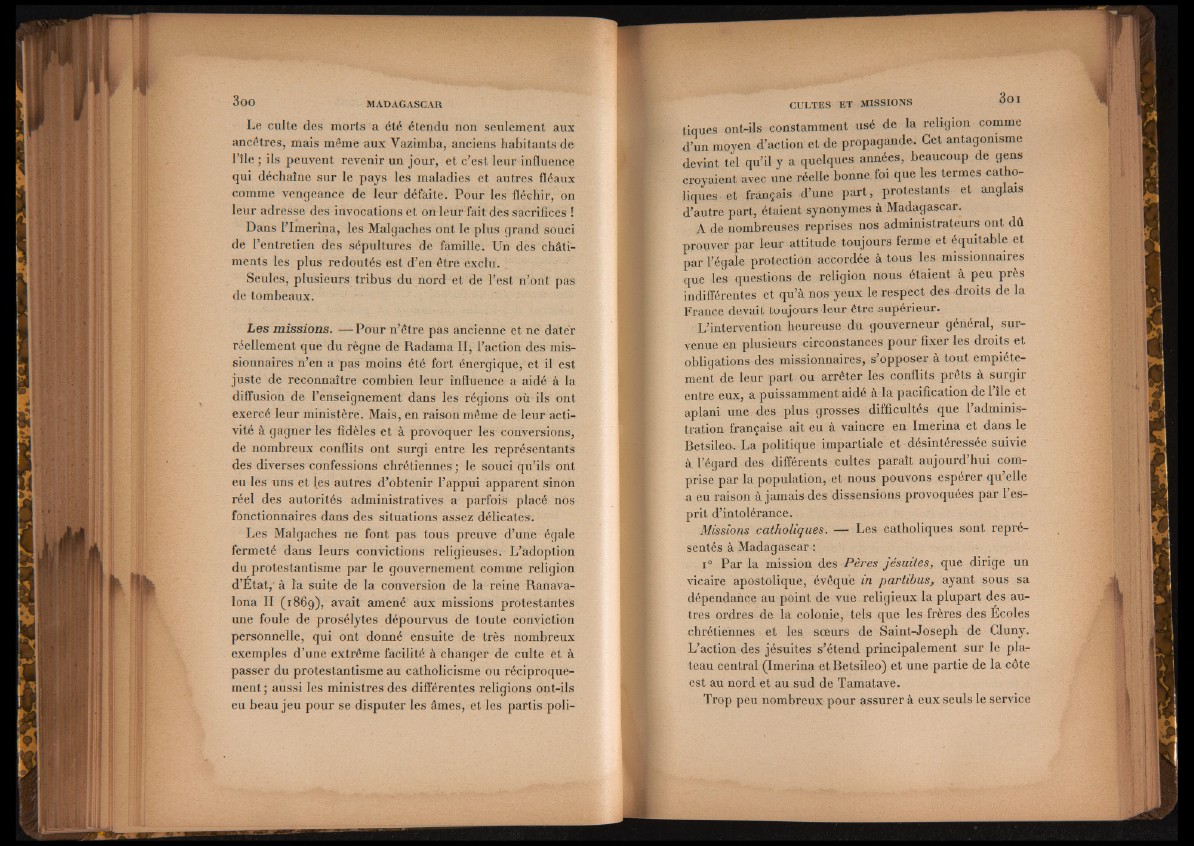
Le culte des morts a été étendu non seulement aux
ancêtres, mais même aux Vazimba, anciens habitants de
l’île ; ils peuvent revenir un jour, et c’est leur influence
qui déchaîne sur le pays les maladies et autres fléaux
comme vengeance de leur défaite. Pour les fléchir, on
leur adresse des invocations et oh leur fait dès sacrifices !
Dans l’ Imerîna, les Malgaches ont le plus grand souci
de l’entretien des sépultures de famille: Un des châtiments
les plus redoutés est d’en être exclu.
Seules, plusieurs tribus du nord et de l’est n’ont pas
de tombeaux.
L e s missions. — Pour n’être pas ancienne et ne dater
réellement que du règne de Radama II, l’action des missionnaires
h’en a pas moins été fort énergique, et il est
juste de reconnaître combien leur influence a aidé à la
diffusion de l’enseignement dans les régions où ils ont
exercé leur ministère. Mais, en raison même de leur activité
à gagner les fidèles et à provoquer les conversions,
de nombreux conflits ont surgi entre les représentants
des diverses confessions chrétiennes; le souci qu’ils ont
eu les uns et les autres d’obtenir l’appui apparent sinon
réel des autorités administratives a parfois placé nos
fonctionnaires dans des situations assez délicates.
Les Malgaches ne font pas tous preuve d’une égale
fermeté dans leurs convictions religieuses. L’adoption
du protestantisme par le gouvernement comme religion
d’Etat, à la suite de la conversion de la reine Ranava-
lona II (1869), avait amené aux missions protestantes
une foule de prosélytes dépourvus de toute conviction
personnelle, qui ont donné ensuite de très nombreux
exemples d’une extrême facilité à changer de culte et à
passer du protestantisme au catholicisme ou réciproquement
; aussi les ministres des différentes religions ont-ils
eu beau jeu pour se disputer les âmes, et les partis politiques
ont-ils constamment usé de la religion comme
d’un moyen d’action et de propagande. Cet antagonisme
devint tel qu’il y a quelques années, beaucoup de gens
croyaient avec une réelle bonne foi que les termes catholiques
et français d’une part, protestants et anglais
d’autre part, étaient synonymes à Madagascar.
A de nombreuses reprises nos administrateurs ont dû
prouver par leur attitude toujours ferme et équitable et
par l’égale protection accordée à tous les missionnaires
que les questions de religion nous étaient à peu près
indifférentes et qu’à nos yeux le respect des droits de la
France devait toujours leur être supérieur.
L’intervention heureuse du gouverneur général, survenue
en plusieurs circonstances pour fixer les droits et
obligations des missionnaires, s’opposer à tout empiétement
de leur part ou arrêter les conflits prêts à surgir
entre eux, a puissamment aidé à la pacification de l’île et
aplani une des plus grosses difficultés que l’administration
française ait eu à vaincre en Imerina et dans le
Betsileo. La politique impartiale et désintéressée suivie
à l’égard des différents cultes paraît aujourd’hui comprise
par la population, et nous pouvons espérer qu’elle
a eu raison à jamais des dissensions provoquées par l’esprit
d’intolérance.
Missions catholiques. —- Les catholiques sont représentés
à Madagascar :
i° Par la mission des Pères jésuites, que dirige un
vicaire apostolique, évêque in partibus, ayant sous sa
dépendance au point de vue religieux la plupart des autres
ordres de la colonie, tels que les frères des Écoles
chrétiennes et les soeurs de Saint-Joseph de Cluny.
L’action des jésuites s’étend principalement sur le plateau
central (Imerina et Betsileo) et une partie de la côte
est au nord et au sud de Tamatave.
Trop peu nombreux pour assurer à eux seuls le service