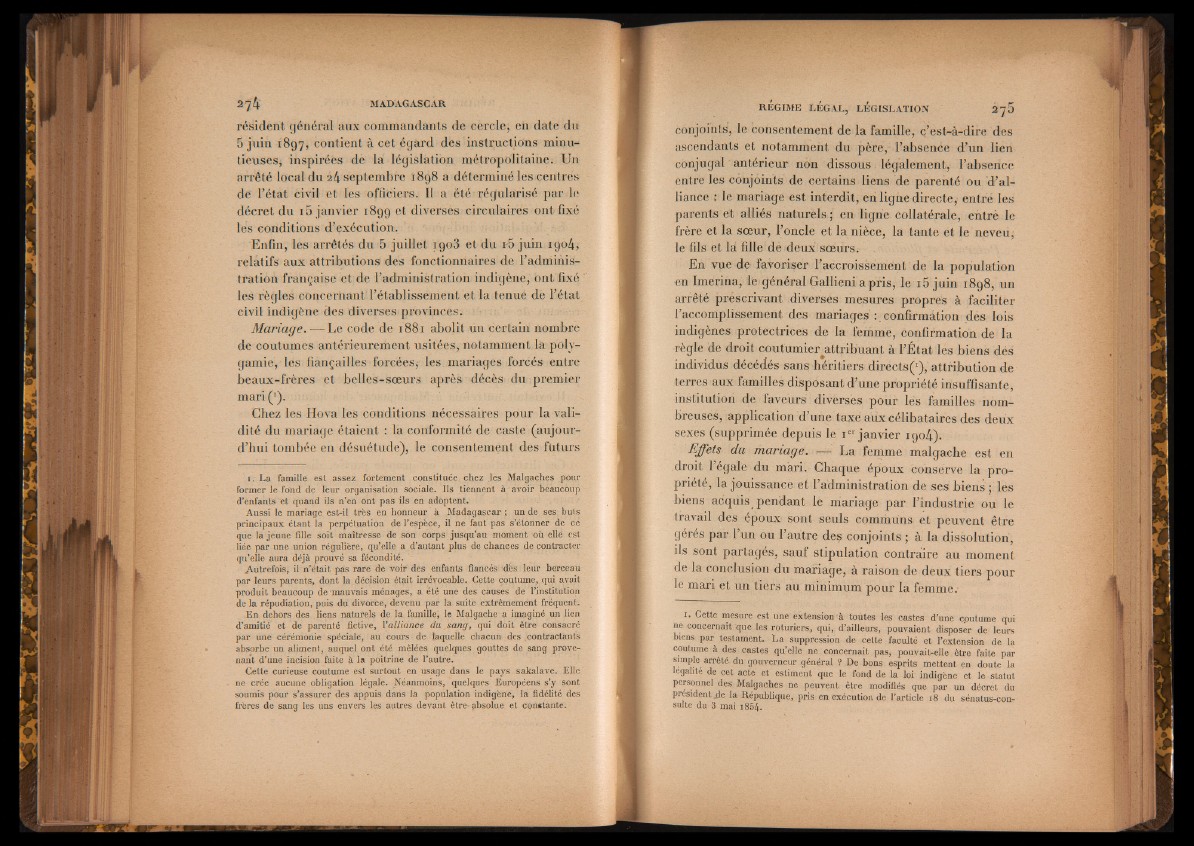
résidènt général aux commandants de cercle, eii date du
5 juin 1897, contient à cet égard des instructions minutieuses,
inspirées dé la législation métropolitainet Un
arrêté local du 24 septembre 1898 a déterminé les centres
de' l’état civil et les officiers. Il a été régularisé par le
décret du i 5 janvier 1899 et diverses circulaires ont fixé
les conditions d’exécution.
Enfin, les arrêtés du 5 juillet 1903 et du i 5 juin igo4*
relatifs aux attributions des fonctionnaires de l’administration
française et de l’administration indigène, ont fixé
les règles concernant l’établissement et la tenue de l’état
civil indigène des diverses provinces.
Mariage. — Le code de 1881 abolit un certain nombre
de coutumes antérieurement usitées, notamment là polygamie,
les fiançailles forcées, les mariages forcés entre
beaux-frères et belles-soeurs après décès du premier
mari (').
Chez les Hova les conditions nécessaires pour la validité
du mariage étaient : la conformité de caste (aujourd’hui
tombée en désuétude), le consentement des futurs
1. La famille est assez fortement constituée chez les Malgaches pour
former le fond de leur organisation sociale. Ils tiennent à avoir beaucoup
d’enfants et quand ils n’en ont pas ils en adoptent.
Aussi le mariage, est-il très en honneur à Madagascar ; un de ses buts
principaux étant la perpétuation de l’espèce, il ne faut pas s’étonner de ce
que la jeune fille soit maîtresse de son corps jusqu’au moment où elle est
liée par une union régulière, qu’elle a d’autant plus de chances de contracter
qu’elle aura déjà prouvé sa fécondité.
.Autrefois, il n’était pas rare de voir des enfants fiancés-dès leur berceau
par leurs parents, dont la décision était irrévocable. Cette coutume, qui avait
produit beaucoup de mauvais ménages, a été une des causes de l’institution
de la répudiation, puis du divorce, devenu par la suite extrêmement fréquent.
En dehors des liens naturels de la famille, le Malgache a imaginé un lien
d’amitié et de parenté fictive, l’alliance du sang, qui doit être consacré
par une cérémonie spéciale, au cours de laquelle chacun des contractants
absorbe un aliment, auquel ont été mêlées quelques gouttes de sang provenant
d’une incision faite à la poitrine de l’autre.
Cette curieuse coutume est surtout en usage dans le pays sakalave. Elle
ne crée aucune obligation légale. Néanmoins, quelques Européens s’y sont
soumis pour s’assurer des appuis dans la population indigène, là fidélité des
frères de sang les uns envers les autres devant être-absolue et constante.
conjoints, le consentement de la famille, c’est-à-dire des
ascendants et notamment du père, l’absence d’un lien
conjugal antérieur non dissous légalement, l’absence
entre les conjoints de certains liens de parenté ou d’alliance
: le mariage est interdit, en ligne directe, entré les
parents et alliés naturels ; en ligne collatérale, entré le
frère et la soeur, l’oncle et la nièce, la tante et le neveu,
le fils et là fille de deux soeurs¿
En vue de favoriser l’accroissement de la population
en Imerina, le général Gallieni a pris, le i 5 juin 1898, un
arrêté prescrivant diverses mesures propres à faciliter
l’accomplissement des mariages : confirmation dés lois
indigènes protectrices de la femme, confirmation de la
règle de droit coutumierattribuant à l’État les biens des
individus décédés sans héritiers directs Q , attribution de
terres aux familles disposant d’une propriété insuffisante,
institution de faveurs diverses pour lés familles nombreuses,
application d’une taxe aux célibataires des deux
sexes (supprimée depuis le I er janvier 1904).
Effets du mariage. — La femme malgache est en
droit l’égale du mari. Chaque époux conserve la propriété,
la jouissance et l’administration de ses biens (le s
biens acquis pendant le mariage par l’industrie ou le
travail des époux sont seuls communs et peuvent être
gérés par l’un ou l’autre de¡=¡ conjoints ; à la dissolution,
ils sont partagés, sauf stipulation contraire au moment
de la conclusion du mariage, à raison de deux tiers pour
le mari et un tiérs au minimum pour la femme.
1. Cette mesure est une extension à toutes les castes d’une eputume qui
ne concernait que les roturiers, qui, d’ailleurs, pouvaient disposer de leurs
biens par testament. L a suppression de celte faculté et l’extension de la
coutume à^ des castes qu’elle ne concernait pas, pouvait-elle être faite par
simple arrêté du gouverneur général ? De bons esprits mettent en doute la
legabté de cet acte et estiment que le fond de la loi indigène et le statut
personnel des Malgaches ne peuvent être modifiés que par un décret du
président jle la République, pris en exécution de l’article 18 du sénatus-con-
sulte du 3 mai 1804.