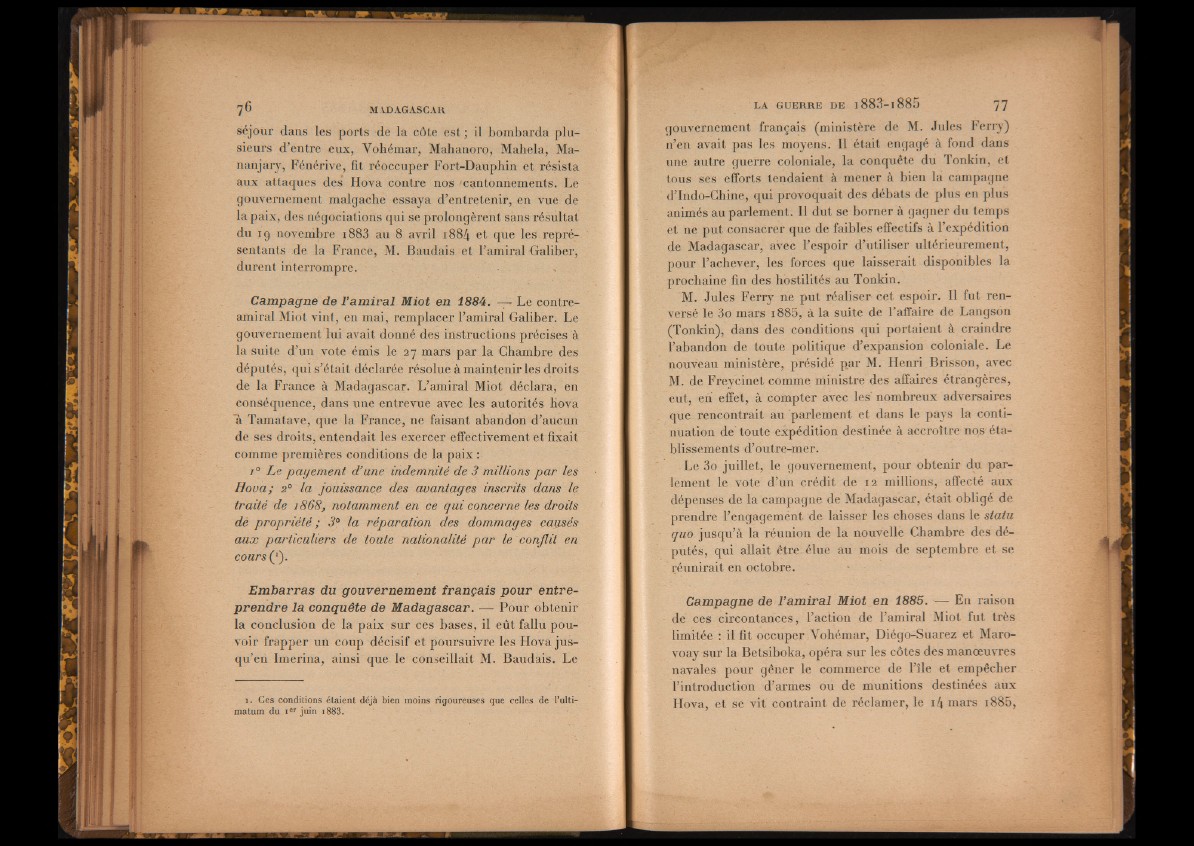
séjour dans les ports de la côte est ; il bombarda plusieurs
d’entre eux, Vohémar, Mahanoro, Mahela, Ma-
nanjary, Fénérive, fit réoccuper Fort-Dauphin et résista
aux attaques des’ Hova contre nos 'cantonnements. Le
gouvernement malgache essaya d’entretenir, en vue de
la paix, des négociations qui se prolongèrent sans résultat
du 19 novembre i 883 au 8 avril 1884 et que les représentants
de la France, M. Baudais et l’amiral Galiber,
durent interrompre. -
Campagne de l ’amiral Miot en 1884. — Le contre-
amiral Miot vint, en mai, remplacer l’amiral Galiber. Le
gouvernement lui avait donné des instructions précises à
la suite d’un vote émis le 27 mars par la Chambre des
députés, qui s’était déclarée résolue à maintenir les droits
de la France à Madagascar. L’amiral Miot déclara, en
conséquence, dans une entrevue avec les autorités hova
"à Tamatave, que la France, ne faisant abandon d’aucun
de ses droits, entendait les exercer effectivement et fixait
comme premières conditions de la paix :
i° Le payement d’une indemnité de 3 millions par les
Hova; 2° la jouissance des avantages inscrits dans le
traité de 1868, notamment en ce qui concerne les droits
dé propriété ; 3° la réparation des dommages causés
aux particuliers de toute nationalité par le conjlit en
cours (').
Embarras du gouvernement français pour entreprendre
la conquête de Madagascar. — Pour obtenir
la conclusion de la paix sur ces bases, il eût fallu pouvoir
frapper un coup décisif et poursuivre les Hova jusqu’en
Imerina, ainsi que le conseillait M. Baudais. Le
1. Ces conditions étaient déjà bien moins rigoureuses que celles de l’ultimatum
du i er juin i 883.
gouvernement français (ministère de M. Jules Feriy)
n’en avait pas les moyens. Il était engagé à fond dans
une autre guerre coloniale, la conquête du Tonkin, et
tous ses efforts tendaient à mener à bien la campagne
d’Indo-Chine, qui provoquait des débats de plus en plus
animés au parlement. 11 dut se borner à gagner du temps
et ne put consacrer que de faibles effectifs à l’expédition
de Madagascar, avec l’espoir d’utiliser ultérieurement,
pour l’achever, les forces que laisserait disponibles la
prochaine fin des hostilités au Tonkin.
M. Jules Ferry ne put réaliser cet espoir. Il fut renversé
le 3o mars i 885, à la suite de l’affaire de Langson
(Tonkin), dans des conditions qui portaient à craindre
l’abandon de toute politique d’expansion coloniale. Le
nouveau ministère, présidé par M. Henri Brisson, avec
M. de Freycinet comme ministre des affaires étrangères,
eut, en effet, à compter avec les nombreux adversaires
que rencontrait au parlement et dans le pays la continuation
de toute expédition destinée à accroître nos établissements
d’outre-mer.
Le 3o juillet, le gouvernement, pour obtenir du parlement
le vote d’un crédit de 12 millions, affecté aux
dépenses de la campagne de Madagascar, était obligé de
prendre l’engagement de laisser les choses dans le statu
quo jusqu’à la réunion de la nouvelle Chambre des députés,
qui allait être élue au mois de septembre et se
réunirait en octobre.
Campagne de l ’amiral Miot en 1885. — En raison
de ces circontances, l’action de l’amiral Miot fut très
limitée : il fit occuper Vohémar, Diégo-Suarez et Maro-
voay sur la Betsiboka, opéra sur les côtes des manoeuvres
navales pour gêner le commerce de l’île et empêcher
l’introduction d’armes ou de munitions destinées aux
Hova, et se vit contraint de réclamer, le i 4 mars i 885,