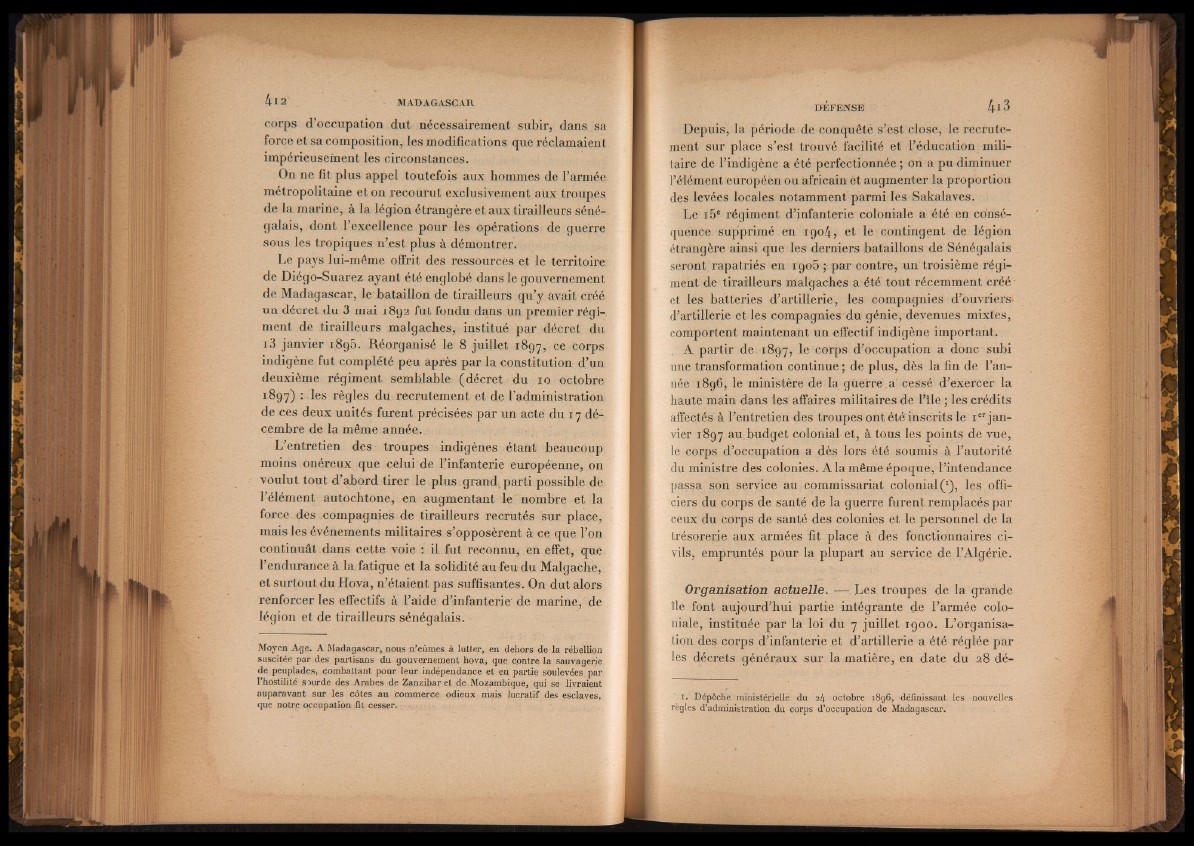
corps d’occupation dut nécessairement subir, dans sa
force et sa composition, les modifications que réclamaient
impérieusement les circonstances.
On ne fit plus appel toutefois aux hommes de l’armée
métropolitaine et on recourut exclusivement aux troupes
de la marine, à la légion étrangère et aux tirailleurs sénégalais,
dont l’excellence pour les opérations de guerre
sous les tropiques n’est plus à démontrer.
Le pays lui-même offrit des ressources et le territoire
de Diégo-Suarez ayant été englobé dans le gouvernement
de Madagascar, le bataillon de tirailleurs qu’y avait créé
un décret du 3 mai 1892 fut fondu dans un premier régiment
de tirailleurs malgaches, institué par décret du
i 3 janvier 1895. Réorganisé le 8 juillet 1897, ce corps
indigène fut complété peu après pa rla constitution d’un
deuxième régiment semblable (décret du 10 octobre
1897) : les règles du recrutement et de l'administration
de ces deux unités furent précisées par un acte du 17 décembre
de la même année.
L’entretien des troupes indigènes étant beaucoup
moins onéreux que celui de l’infanterie européenne, on
voulut tout d’abord tirer le plus grand parti possible de
l’élément autochtone, en augmentant le nombre et la
force des compagnies de tirailleurs recrutés sur place,
mais les événements militaires s’opposèrent à ce que l’on
continuât dans cette voie : il fut reconnu, en effet, que.
l’endurance à la fatigue et la solidité au feu du Malgache,
et surtout du Hova, n’étaient pas suffisantes. On dut alors
renforcer les effectifs à l’aide d’infanterie' de marine, de
légion et de tirailleurs sénégalais.
Moyen Age. A Madagascar, nous n’eûmes à lutter, en dehors de la rébellion
suscitée par des partisans du gouvernement hova, que cpntre la sauvagerie
de peuplades, combattant pour leur indépendance et en. partie soulevées par
l’hostilité sourde des Arabes de Zanzibar et de Mozambique, qui se livraient
auparavant sur les côtes au commerce odieux mais lucratif des esclaves,
que no.lre occupation fit cesser.
Depuis, la période de conquête s’est close, le recrutement
sur place s’est trouvé facilité et l’éducation militaire
de l’indigène a été perfectionnée ; on a pu diminuer
l’élément européen ou africain et augmenter la proportion
des levées locales notamment parmi les Sakalaves.
Le i 5e régiment d’infanterie coloniale a été en conséquence
supprimé en 1904, et le contingent de légion
étrangère ainsi que les derniers bataillons de Sénégalais
seront rapatriés en 1905 ; par contre, un troisième régiment
de tirailleurs nlalgaches a été tout récemment créé
et les batteries d’artillerie, les compagnies d’ouvriers-
d’artillerie et les compagnies du génie, devenues mixtes,
comportent maintenant un effectif indigène important.
A partir de 1897, le corps d’occupation a donc subi
une transformation continue ; de plus, dès la fin de l’année
1896, le ministère de la guerre,a' cessé d’exercer la
haute main dans les affaires militaires de l’île ; les crédits
affectés à l’entretien des troupes ont été inscrits le I er janvier
1897 au.budget colonial et, à tous les points de vue,
le corps d’occupation a dès lors été soumis à l’autorité
du ministre des colonies. A la même époque, l’intendance
passa son service au commissariat colonial^), les officiers
du corps de santé de la guerre furent remplacés par
ceux du corps de santé des colonies et le personnel de la
trésorerie aux armées fit place à des fonctionnaires civils,
empruntés pour la plupart au service de l’Algérie.
Organisation actuelle. — Les troupes de la grande
île font aujourd’hui partie intégrante de l’armée coloniale,
instituée par la loi du 7 juillet 1900. L’organisation
des corps d’infanterie et d’artillerie a été réglée par
les décrets généraux sur la matière, en date du 28 déi.
Dépêche ministérielle du 24 octobre 1896, définissant les nouvelles
regies d’administration du corps d’occupation de Madagascar.