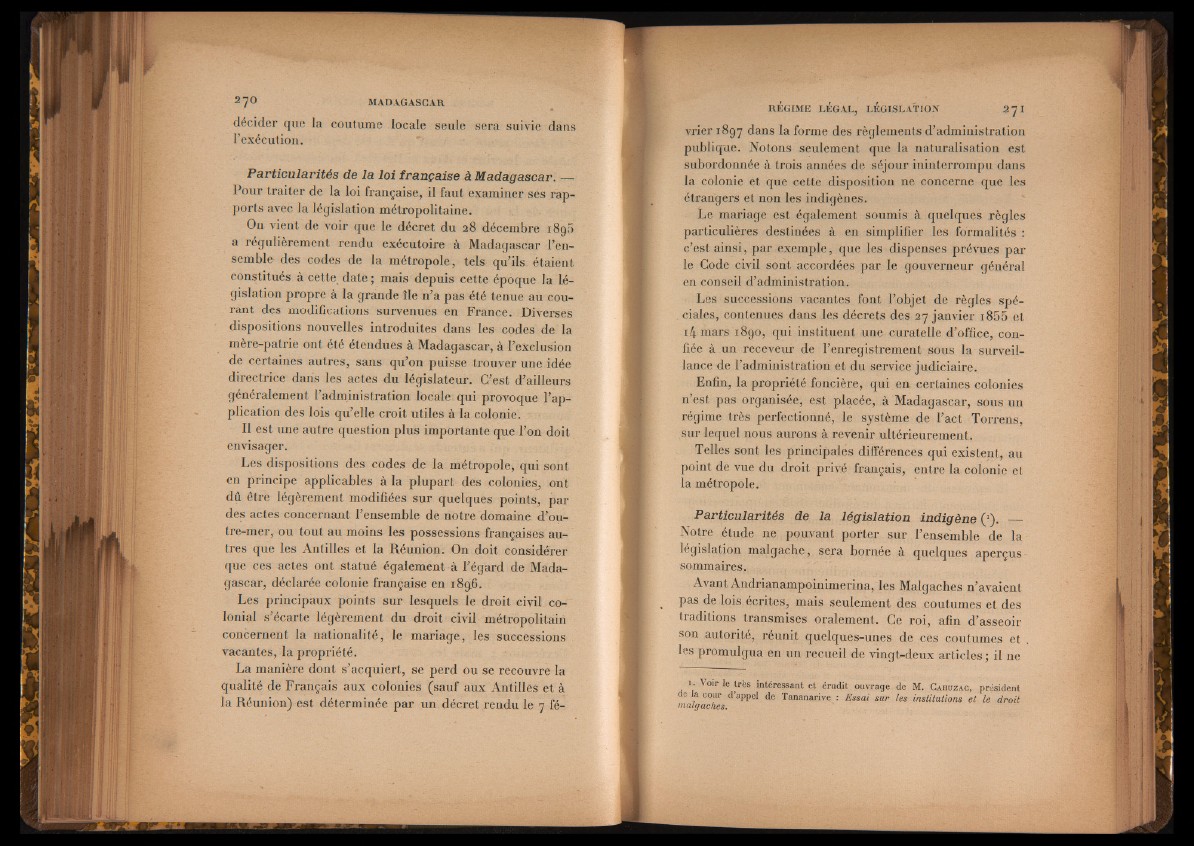
décider que la coutume locale seule sera suivie dans
l’exécution.
P a r t icu la r ité s de la lo i fran ça ise à Madagascar. —
Pour traiter de la loi française, il faut examiner ses rapports
avec la législation métropolitaine.
On vient de voir que le décret du 28 décembre 1896
a régulièrement rendu exécutoire à Madagascar l’ensemble
des codes de la métropole, tels qu’ils étaient
constitués à cette date ; mais depuis cette époque la législation
propre à la grande île n’a pas été tenue au courant
des modifications survenues en France. Diverses
dispositions nouvelles introduites dans les codes de la
mère-patrie ont été étendues à Madagascar, à l’exclusion
de certaines autres, sans qu’on puisse trouver une idée
directrice dans les actes du législateur. C’est d’ailleurs
généralement l’administration locale qui provoque l’application
des lois qu’elle croit utiles à la colonie.
Il est une autre question plus importante que l’on doit
envisager.
Les dispositions des codes de la métropole, qui sont
en principe applicables à la plupart des colonies^ ont
dû être légèrement modifiées sur quelques points, par
des actes concernant l’ensemble de notre domaine d’ou-
tre-mer, ou tout au moins les possessions françaises autres
que les Antilles et la Réunion. On doit considérer
que ces actes ont statué également à l’égard de Madagascar,
déclarée colonie française en i8g6.
Les principaux points sur lesquels le droit civil colonial
s’écarte légèrement du droit civil métropolitain
concernent la nationalité, le mariage, les successions
vacantes, la propriété.
La manière dont s’acquiert, se perd ou se recouvre la
qualité de Français aux colonies (sauf aux Antilles et à
la Réunion) est déterminée par un décret rendu le 7 février
1897 dans la forme des règlements d’administration
publique. Notons seulement que la naturalisation est
subordonnée à trois années de séjour ininterrompu dans
la colonie et que cette disposition ne concerne que les
étrangers et non les indigènes.
Le mariage est également soumis à quelques règles
particulières destinées à en simplifier les formalités :
c’est ainsi, par exemple, que les dispenses prévues par
le Gode civil sont accordées par le gouverneur général
en conseil d’administration.
Les successions vacantes font l’objet de règles spéciales,
contenues dans les décrets des 27 janvier i 855 et
i4 mars 1890, qui instituent une curatelle d’office, confiée
à un receveur de l’enregistrement sous la surveillance
de l’administration et du service judiciaire.
Enfin, la propriété foncière, qui en certaines colonies
n’est, pas organisée, est placée, à Madagascar, sous un
régime très perfectionné, le système de Fact Torrens,
sur lequel nous aurons à revenir ultérieurement.
Telles sont les principales différences qui existent, au
point de vue du droit privé français, entre la colonie et
la métropole.
P a rticularités de la législation indigène ('). _
Notre étude ne pouvant porter sur l’ensemble de la
législation malgache, sera bornée à quelques aperçus
sommaires.
Avant Andrianampoinimerina, les Malgaches n’avaient
pas de lois écrites, mais seulement des coutumes et des
traditions transmises oralement. Ce roi, afin d’asseoir
son autorité, réunit quelques-unes de ces coutumes et
les promulgua en un recueil de vingt-deux articles; il ne
I . Voir le très intéressant et érudit ouvrage de M. C a h u z a c , président
de la cour d’appel de Tananarive : Essai sur les institutions et le droit
malgaches.