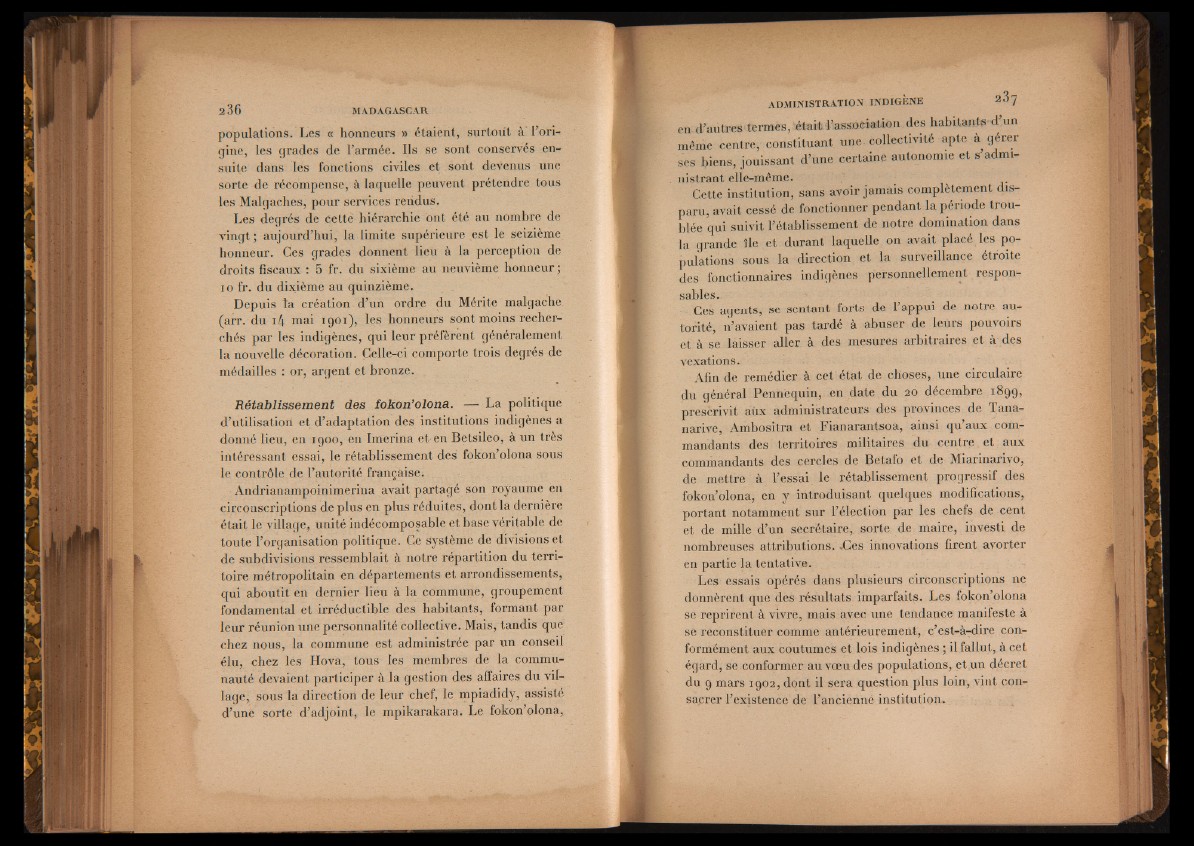
populations. Les « honneurs » étaient, surtout à l’origine,
les grades de l’armée. Ils se sont conservés ensuite
dans les fonctions civiles et sont devenus une
sorte de récompense, à laquelle peuvent prétendre tous
les Malgaches, pour services rendus.
Les degrés de cette hiérarchie ont été au nombre de
vingt; aujourd’hui, la limite supérieure est le seizième
honneur. Ces grades donnent lieu à la perception de
droits fiscaux : 5 fr. du sixième au neuvième honneur ;
io fr. du dixième au quinzième.
Depuis ta création d’un ordre du Mérite malgache
(arr. du i4 mai 1901), les honneurs sont moins recherchés
par les indigènes, qui leur préfèrent généralement
la nouvelle décoration. Celle-ci comporte trois degrés de
médailles : or, argent et bronze. .
Rétablissement des fokon’olona. — La politique
d’utilisation et d’adaptation des institutions indigènes a
donné lieu, en 1900, en Imerina et en Betsileo, à un très
intéressant essai, le rétablissement des fokon’olona sous
le contrôle de l’autorité française;
Andrianampoinimerina avait partagé son royaume en
circonscriptions de plus en plus réduites, dont la dernière
était le village, unité indécomposable et base véritable de
toute l’organisation politique. Ce système de divisions et
de subdivisions ressemblait à notre répartition du territoire
métropolitain en départements et arrondissements,
qui aboutit en dernier lieu à la commune, groupement
fondamental et irréductible des habitants, formant par
leur réunion une personnalité collective. Mais, tandis que
chez nous, la commune est administrée par un conseil
élu, chez les Hova, tous les membres de la communauté
devaient participer à la gestion des affaires du village,
sous la direction de leur chef, le mpiadidy, assisté
d’une sorte d’adjoint, le mpikarakara. Le fokon’olona,
en d’autres termes, était l’association des habitante d’un
même centre, constituant une collectivité apte à gérer
ses biens, jouissant d’une certaine autonomie et s administrant
elle-même. .
Cette institution, sans avoir jamais complètement disparu,
avait cessé de fonctionner pendant la période troublée
qui suivit l’établissement de notre domination dans
la grande île et durant laquelle on avait placé les populations
sous la direction et la surveillance étroite
des fonctionnaires indigènes personnellement responsables.
Ces agents, se sentant forts de l’appui de notre autorité,
n’avaient pas tardé à abuser de leurs pouvoirs
et à se laisser aller à des mesures arbitraires et à des
vexations.
Afin de remédier à cet état de choses, une circulaire
du général Pennequin, en date du 20 décembre 1899,
prescrivit aux administrateurs des provinces de Tananarive,
Ambositra et Fianarantsoa, ainsi qu’aux commandants
des territoires militaires du centre et aux
commandants des cercles de Betafo et de Miarinarivo,
de mettre à l’essai le rétablissement progressif des
fokon’olona, en y introduisant quelques modifications,
portant notamment sur l’élection par les chefs de cent
et de mille d’un secrétaire, sorte de maire, investi de
nombreuses attributions. .Ces innovations firent avorter
en partie la tentative.
Les essais opérés dans plusieurs circonscriptions ne
donnèrent que des résultats imparfaits. Les fokon’olona
se reprirent à vivre, mais avec une tendance manifeste à
se reconstituer comme antérieurement, c’est-à-dire conformément
aux coutumes et lois indigènes ; il fallut, à cet
égard, se conformer au voeu des populations, et un décret
du 9 mars 1902, dont il sera question plus loin, vint consacrer
l’existence de l’ancienne institution.