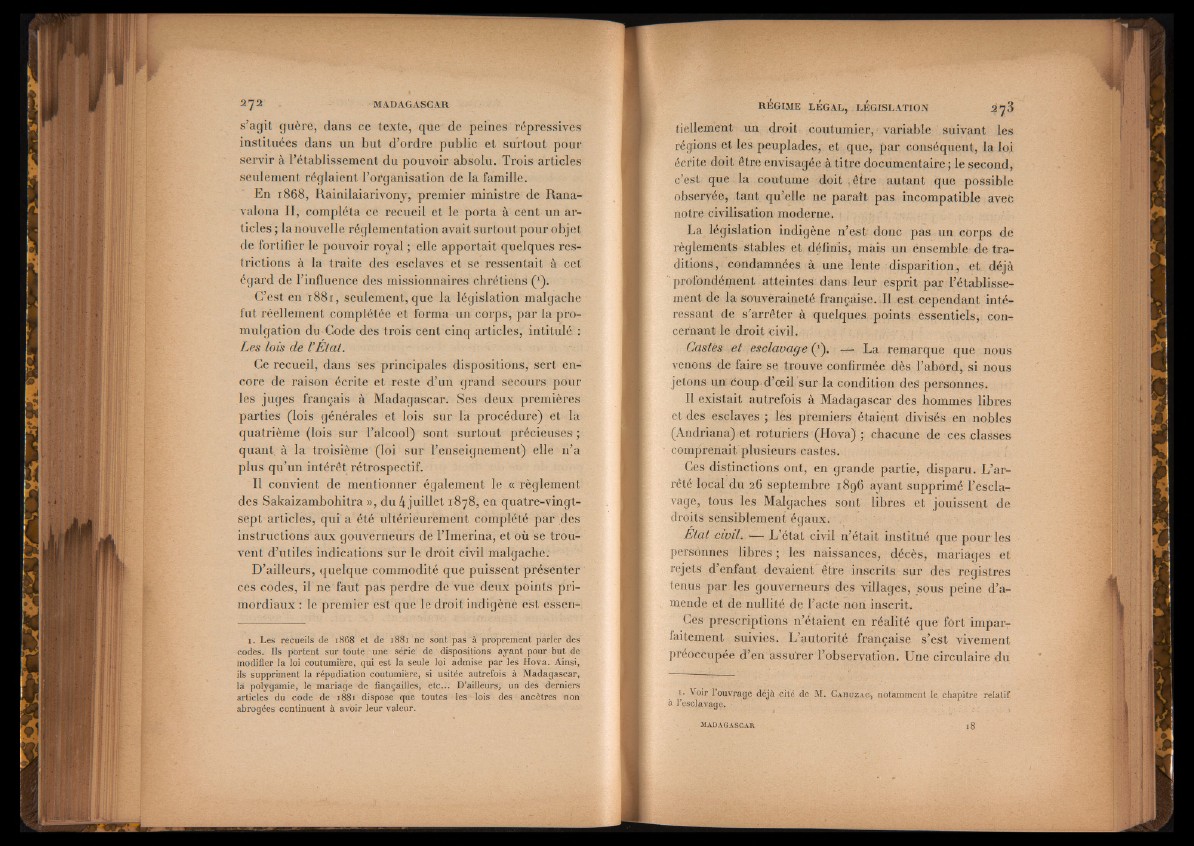
s’agit guère, dans ce texte, que de peines répressives
instituées dans un but d’ordre public et surtout pour
servir à l’établissement du pouvoir absolu. Trois articles
seulement réglaient l’organisation de la famille.
En 1868, Rainilaiarivony, premier ministre de Rana-
valona II, compléta ce recueil et le porta à cent un articles
; la nouvelle réglementation avait surtout pour objet
de fortifier le pouvoir royal ; elle apportait quelques restrictions
à la traite des esclaves et se ressentait à cet
égard de l’influence des missionnaires chrétiens (*).
C’est en 1881, seulement, que la législation malgache
fut réellement complétée et forma un corps, par la promulgation
du Code des trois cent cinq articles, intitulé :
Les lois de l’Etat.
Ce recueil, dans ses principales dispositions, sert encore
de raison écrite et reste d’un grand secours pour
les juges français à Madagascar. Ses deux premières
parties (lois générales et lois sur la procédure) et la
quatrième (lois sur l’alcool) sont surtout précieuses;
quant, à la troisième (loi sur l’enseignement) elle n’a
plus qu’un intérêt rétrospectif.
Il convient de mentionner également le « règlement
des Sakaizambobitra », du 4 juillet 1878, en quatre-vingt-
sëpt articles, q u ia été ultérieurement complété par des
instructions aux gouverneurs de lTmerina, et où se trouvent
d’utiles indications sur le droit civil malgache:
D’ailleurs, quelque commodité que puissent présenter
ces codes, il ne faut pas perdre de vue deux points primordiaux
: le premier est que le droit indigène est essen-
H Les recueils de 1868 et de 1881 ne sont pas à proprement parler des
codes. Us portent sur toute une série de dispositions ayant pour but de
modifier la loi coutumière, qui est la seule loi admise par les Hova. Ainsi,
ils suppriment la répudiation coutumière, si usitée autrefois à Madagascar,
la polygamie, le mariage de fiançailles, etc... D’ailleurs, un des derniers
articles du code de 3881 dispose que toutes les lois des ancêtres non
abrogées continuent à avoir leur valeur.
bellement un droit coutumier, variable suivant les
régions et les peuplades, et que, par conséquent, la loi
écrite doit être envisagée à titre documentaire ; le second,
c’est que la coutume doit .être autant que possible
observée, tant qu’elle ne paraît pas incompatible avec
notre civilisation moderne.
La législation indigène n’est donc pas un corps de
règlements stables et définis, mais un énsemble de traditions
, condamnées à une lente disparition, et déjà
profondément atteintes dans leur esprit par l’établissement
de la souvèraineté française. Il est cependant intéressant
de s’arrêter à quelques points essentiels, concernant
le droit civil.
Castes et esclavage (J). —- La remarque que nous
venons de faire se trouve confirmée dès l’abórd, si nous
jetons un Coup-d’oeil sur la condition des personnes.
Il existait autrefois à Madagascar des hommes libres
et des esclaves ; les premiers étaient divisés en nobles
(Andriana) et roturiers (Hova) ; chacune de ces classes
comprenait plusieurs castes.
Ces distinctions ont, en grande partie, disparu. L’arrêté
local du 26 septembre 1896 ayant supprimé l’esclavage,
tous les Malgaches sont libres et jouissent de
droits sensiblement égaux. .
Etat civil. »— L ’état civil n’était institué que pour les
personnes libres ; les naissances, décès, mariages et
rejets d’enfant devaient être inscrits sur des registres
tenus par les gouverneurs des villages, sous peine d’amende
et de nullité de l’acte non inscrit.
Ces prescriptions n’étaient en réalité que fort imparfaitement
suivies. L’autorité française s’est vivement
préoccupée d’en assurer l’observation. Une circulaire du
1. Voir l’ouvrage déjà cité de M. C a h u z a c , notamment le chapitre relatif
à l’esclavage. •