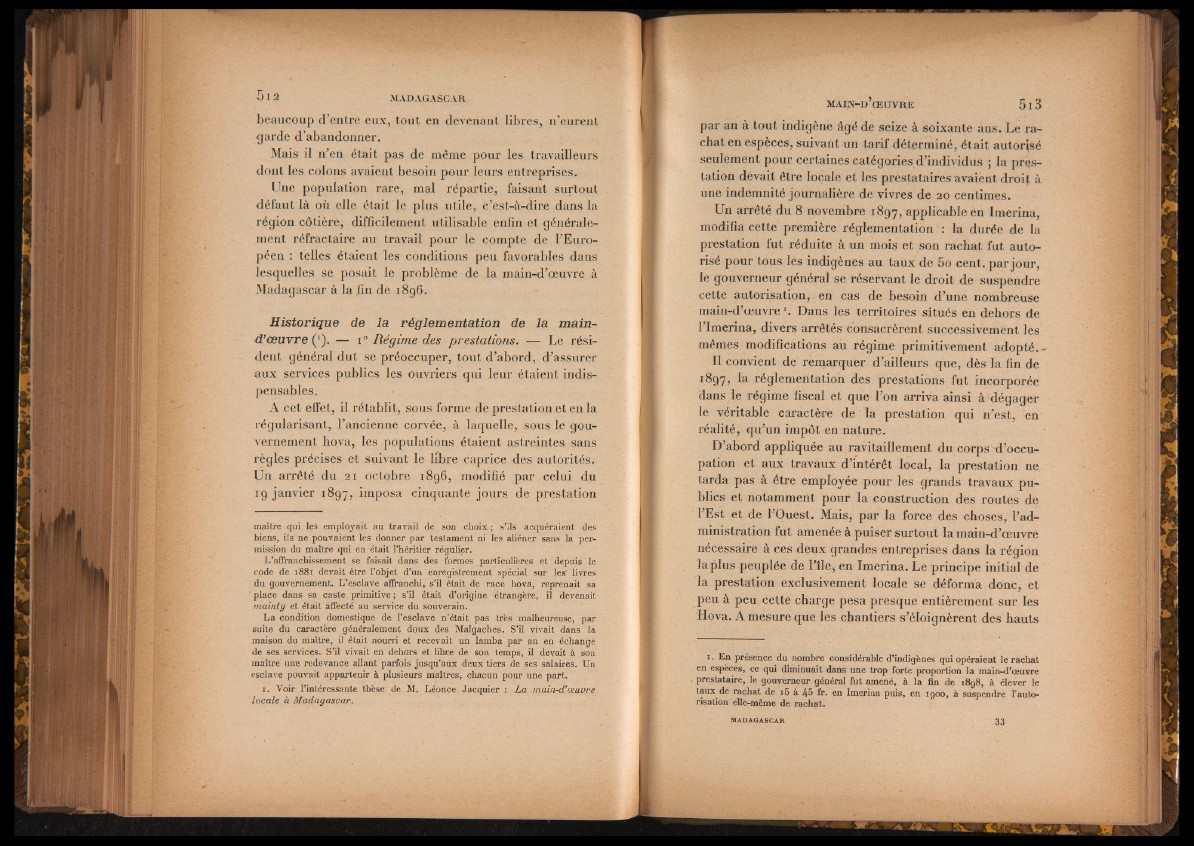
beaucoup d’entre eux, tout en devenant libres, n’eurent
garde d’abandonner.
Mais il n’en était pas de même pour les travailleurs
dont les colons avaient besoin pour leurs entreprises.
Une population rare, mal répartie, faisant surtout
défaut là où elle était le plus utile, c’est-à-dire dans la
région côtière, difficilement utilisable enfin et généralement
réfrac taire au travail pour le compte de l’Européen
: telles étaient les conditions peu favorables dans
lesquelles se posait le problème de la main-d’oeuvre à
Madagascar à la fin de 1896.
Historique de la réglementation de la main-
d ’oeuvre ('). — \° Régime des prestations. — Le résident
général dut se préoccuper, tout d’abord, d’assurer
aux services publics les ouvriers qui leur étaient indispensables.
A cet effet, il rétablit, sous forme de prestation et en la
régularisant, l’ancienne corvée, à laquelle, sous le gouvernement
hova, les populations étaient astreintes sans
règles précises et suivant le libre caprice des autorités.
Un arrêté du 21 octobre 1896, modifié par celui du
19 janvier 1897, imposa cinquante jours de prestation
maître qui les employait au travail de son choix; s’ils acquéraient des
biens, ils ne pouvaient les donner par testament ni les aliéner sans la permission
du maître qui en était l’héritier régulier.
L’affranchissement se faisait dans des formes particulières et depuis le
code de 1881 devait être l’objet d’un enregistrement spécial sur les" livres
du gouvernement. L’esclave affranchi, s’il était de race hova, reprenait sa
' place dans sa caste primitive ; s’il était d’origine étrangère, il devenait
mainty et était affecté au service du souverain.
La condition domestique de l’esclave n’était pas très malheureuse, par
suite du caractère généralement doux des Malgaches. S’il vivait dans la
maison du maître, il était nourri et recevait un lamba par an en échange
de ses services. S’il vivait en dehors et libre de son temps, il devait à son
maître une redevance allant parfois jusqu’aux deux tiers de ses salaires. Un
esclave pouvait appartenir à plusieurs maîtres, chacun pour une part.
1. Voir l’intéressante thèse de M. Léonce Jacquier : La main-d’oeuvre
locale à Madagascar.
par an à tout indigène âgé de seize à soixante ans. Le rachat
en espèces, suivant un tarif déterminé, était autorisé
seulement pour certaines catégories d’individus ; la prestation
devait être locale et les prestataires avaient droit à
une indemnité journalière de vivres de 20 centimes.
Un arrêté du 8 novembre 1897, applicable en Imerina,
modifia cette première réglementation : la durée de la
prestation fut réduite à un mois et son rachat fut autorisé
pour tous les indigènes au taux de 5o cent, par jour,
le gouverneur général se réservant le droit de suspendre
cette autorisation, en cas de besoin d’une nombreuse
main-d’oeuvreJ. Dans les territoires situés en dehors de
l’Imerina, divers arrêtés consacrèrent successivement les
mêmes modifications au régime primitivement adopté.-
Il convient de remarquer d’ailleurs que, dès la fin de
1897, la réglementation des prestations fut incorporée
dans le régime fiscal et que l’on arriva ainsi à dégager
le véritable caractère de la prestation qui n’est, en
réalité, qu’un impôt en nature.
D’abord appliquée au ravitaillement du corps d ’occupation
et aux travaux d’intérêt local, la prestation ne
tarda pas à être employée pour les grands travaux publics
et notamment pour la construction des routes de
l’Est et de l’Ouest. Mais, par la force des choses, l’administration
fut amenée à puiser surtout la main-d’oeuvre
nécessaire à ces deux grandes entreprises dans la région
laplus peuplée de l’île, en Imerina. Le principe initial de
la prestation exclusivement locale se déforma donc, et
peu à peu cette charge pesa presque entièrement sur les
Hova. A mesure que les chantiers s’éloignèrent des hauts
i . En présence du nombre considérable d’indigènes qui opéraient le rachat
en espèces, ce qui diminuait dans une trop forte proportion la main-d’oeuvre
prestataire, le gouverneur général fut amené, à la fin de 1898, à élever le
taux de rachat de i5 à l\5 fr. en Imerina puis, en 1900, à suspendre l'autorisation
elle-même de rachat.