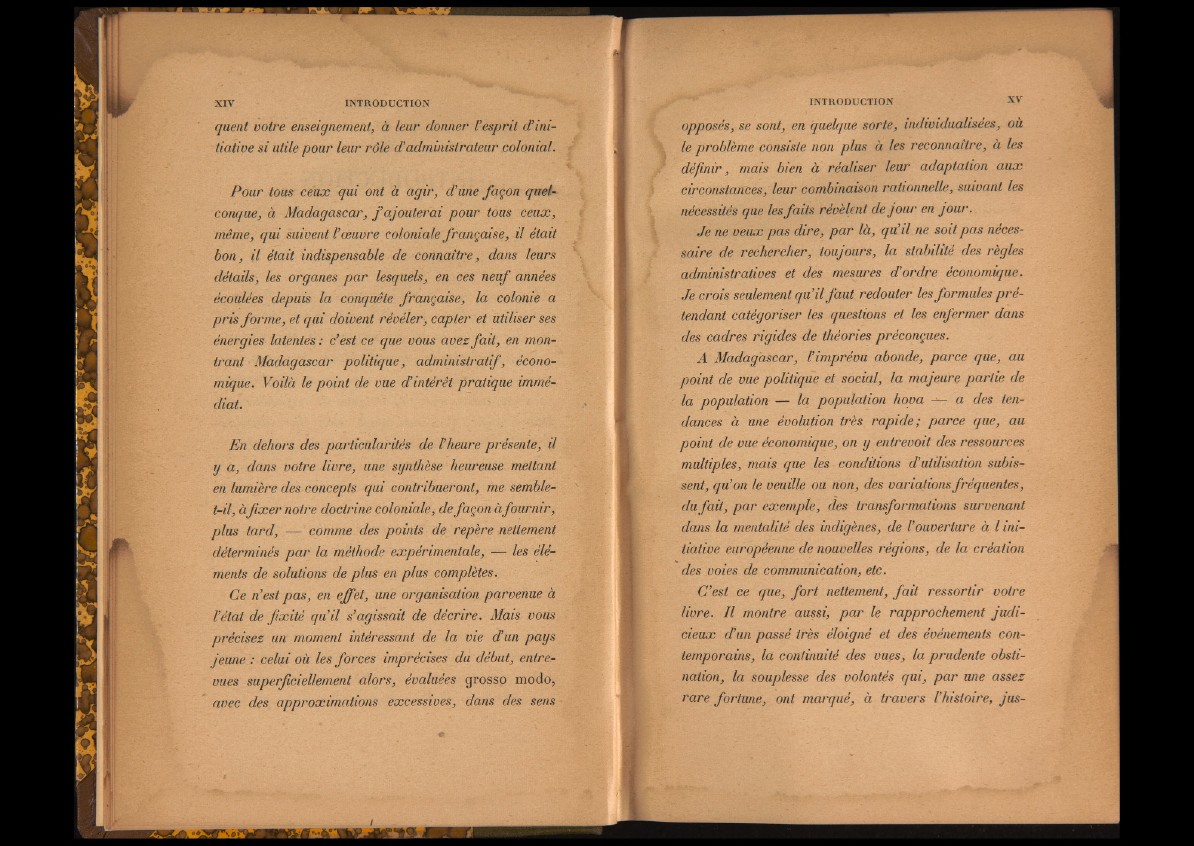
quent votre enseignement, à leur donner l’esprit d’ initiative
s i utile pour leur rôle d’administrateur colonial.
Pour tous ceux qui ont à agir, d’une façon quelconque,
à Madagascar, j ’ajouterai pour tous ceux,
même, qui suivent l’oeuvre coloniale française, il était
bon, il était indispensable de connaître, dans leurs
détails, les organes p a r lesquels, en ces neuf années
écoulées depuis la conquête française, la colonie a
pris forme, et qui doivent révéler, capter et utiliser ses
énergies latentes : c’ est ce que vous avez fa it, en montrant
Madagascar politique, administratif, économique.
Voilà le point de vue d’ intérêt pratique immédiat.
En dehors des particularités de l’heure présente, il
y a, dans votre livre, une synthèse heureuse mettant
en lumière des concepts qui contribueront, me semble-
t-il, à fix e r notre doctrine coloniale, de façon à fournir,
plus tard, — comme des points de repère nettement
déterminés p a r la méthode expérimentale, — les éléments
de solutions de plus en plus complètes.
Ce n’est pas, en effet, une organisation parvenue à
l’état de fix ité qu’il s’agissait de décrire. Mais vous
précisez un moment intéressant de la vie d’un pays
jeune : celui où les forces imprécises du début, entrer
vues superficiellement alors, évaluées grosso modo,
avec des approximations excessives, dans des sens
opposés, se sont, en quelque sorte, individualisées, où
le problème consiste non plus à les reconnaître, à les
définir, mais bien à réaliser leur adaptation a u x
circonstances, leur combinaison rationnelle, suivant les
nécessités que les fa its révèlent de jo u r en jo u r .
Je ne veux pas dire, par là, qu’ il ne soit pas nécessaire
de rechercher, toujours, la stabilité des règles
administratives et des mesures d ’ordre économique.
Je crois seulement qu’il fa u t redouter les formules p rétendant
catégoriser les questions et les enfermer dans
des cadres rigides de théories préconçues.
A Madagascar, l’ imprévu abonde, parce que, au
point de vue politique et social, la majeure partie de
la population — la population hova — a des tendances
à une évolution très rapide; parce que, au
point de vue économique, on y entrevoit des ressources
multiples, mais que les conditions d ’utilisation subissent,
qu’on le veuille ou non, des variations fréquentes,
du fait, par exempte, des transformations survenant
dans la mentalité des indigènes, de l’ouverture à l initiative
européenne de nouvelles régions, de la création
des voies de communication, etc.
C ’est ce que, fo r t nettement, fa i t ressortir votre
livre. I l montre aussi, p ar le rapprochement ju d icieux
d’un passé très éloigné et des événements contemporains,
la continuité des vues, la prudente obstination,
la souplesse des volontés qui, par une assez
rare fortune, ont marqué, à travers l ’histoire, ju s -