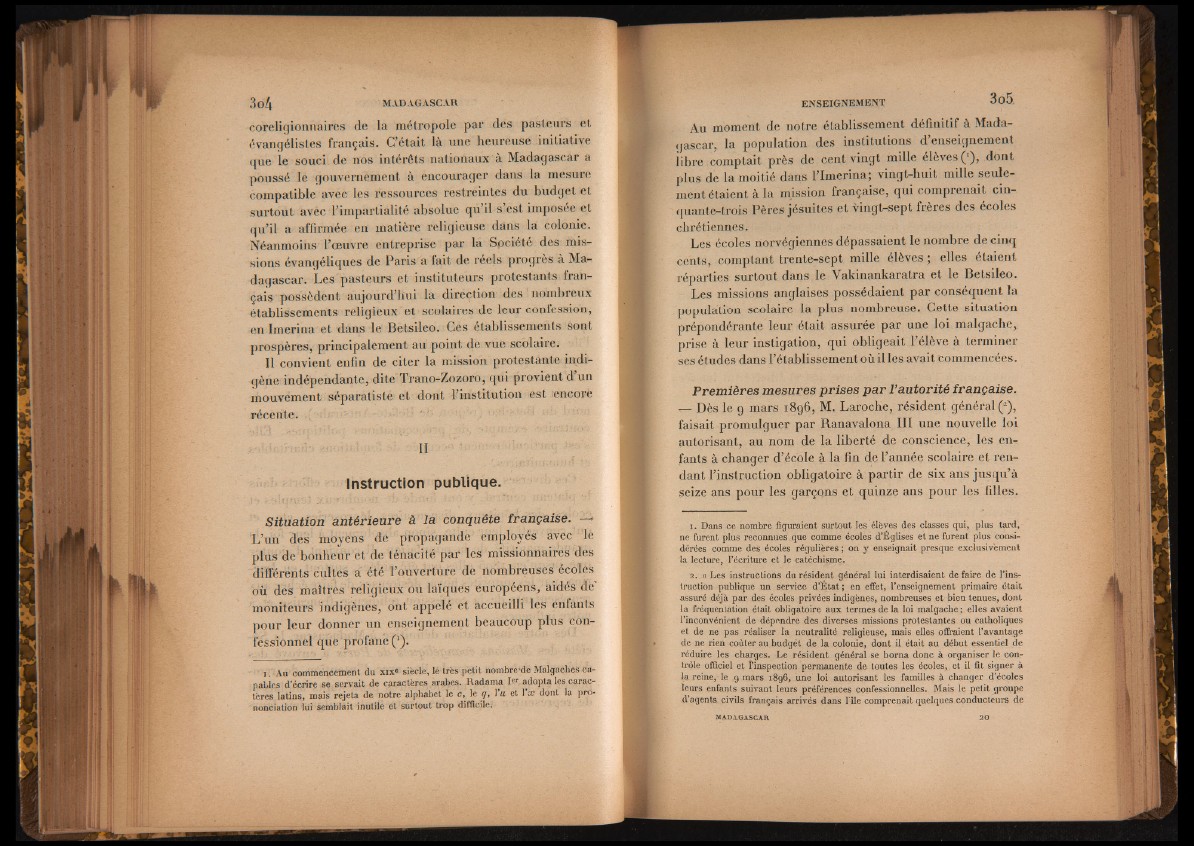
coreligionnaires de la métropole par des pasteurs et
évangélistes français. C’était là une heureuse initiative
que le souci de nos intérêts nationaux à Madagascar a
poussé le gouvernement à encourager dans la mesure
compatible avec les ressources restreintes du budget et
surtout avec l’impartialité absolue qu’il s’est imposée et
qu’il a affirmée en matière religieuse dans là colonie.
Néanmoins l’oeuvre entreprise par la Spciéte des missions
évangéliques de Paris a fait de réels progrès à Madagascar.
Les pasteurs et instituteurs protestants français
possèdent aujourd’hui la direction des nombreux
établissements religieux et scolaires de leur confession,
en Imerina et dans le Betsileo. Ces établissements sont
prospères, principalement au point de vue scolaire.
Il convient enfin de citer la mission protestante indigène
indépendante, dite Trano-Zozoro, qui provient d un
mouvement séparatiste et dont l’institution est encore
récente.
II
Instruction publique.
Situation antérieure à la conquête française.
L’un des moyens de propagande employés avec lë
plus de bonheur et de ténacité par les missionnaires des
différents cultes a été l ’ouverture de nombreuses ecoles
ou des maîtres religieux ou laïques européens, aidés de
moniteurs indigènes, ont appelé et accueilli les enfants
pour leur donner un enseignement beaucoup plus confessionnel
que profane (!).
i . Au commencement du xixe siècle, le très petit nombre-de Malgaches capables
d’écrire se servait de caractères arabes. Radama Ier adopta les caractères
latins, mais rejeta de notre alphabet le c, le q, Vu et Vx dont la prononciation
ltii semblait inutile et surtout trop difficilei
Au moment de notre établissement définitif à Madagascar,
la population des institutions d’enseignement
libre comptait près de cent vingt mille élèves (*), dont
plus de la moitié dans l’ Imerina; vingt-huit mille seulement
étaient à la mission française, qui comprenait cinquante
trois Pères jésuites et vingt-sept frères des écoles
chrétiennes.
Les écoles norvégiennes dépassaient le nombre de cinq
cents, comptant trente-sept mille élèves ; elles étaient
réparties surtout dans le Yakinankaratra et le Betsileo.
Les missions anglaises possédaient par conséquent la
population scolaire la plus nombreuse. Cette situation
prépondérante leur était assurée par une loi malgache,
prise à leur instigation, qui obligeait l’élève à terminer
ses études dans l’établissement où il les avait commencées.
P rem iè re s mesures p r ise s p a r l ’autorité française.
— Dès le 9 mars 1896, M, Laroche, résident général (2),
faisait promulguer par Ranavalona III une nouvelle loi
autorisant, au nom de la liberté de conscience, les enfants
à changer d’école à la fin de l’année scolaire et rendant
l’instruction obligatoire à partir de six ans jusqu’ à
seize ans pour les garçons et quinze ans pour les filles.
1. Dans ce nombre figuraient surtout les élèves des classes qui, plus tard,
ne furent plus reconnues que comme écoles d’Eglises et ne furent plus considérées
comme des écoles régulières ; on y enseignait presque exclusivement
la lecture, l’écriture et le catéchisme.
2. « Les instructions du résident général lui interdisaient défaire de l’instruction
publique un service d’Etat ; en effet, l’enseignement primaire était
assuré déjà par des écoles privées indigènes, nombreuses et bien tenues, dont
la fréquentation était obligatoire aux termes de la loi malgache; elles avaient
l’inconvénient de dépendre des diverses missions protestantes ou catholiques
et de ne pas réaliser la neutralité religieuse, mais elles offraient l’avantage
de ne rien coûter au budget de la colonie, dont il était au début essentiel de
réduire les charges. Le résident général se borna donc à organiser le contrôle
officiel et l’inspection permanente de toutes les écoles, et il fit signer à
la reine, le .9 mars 1896, une loi autorisant les familles à changer d’écoles
leurs enfants suivant leurs préférences confessionnelles. Mais le petit groupe
d’agents civils français arrivés dans l'île comprenait quelques conducteurs de