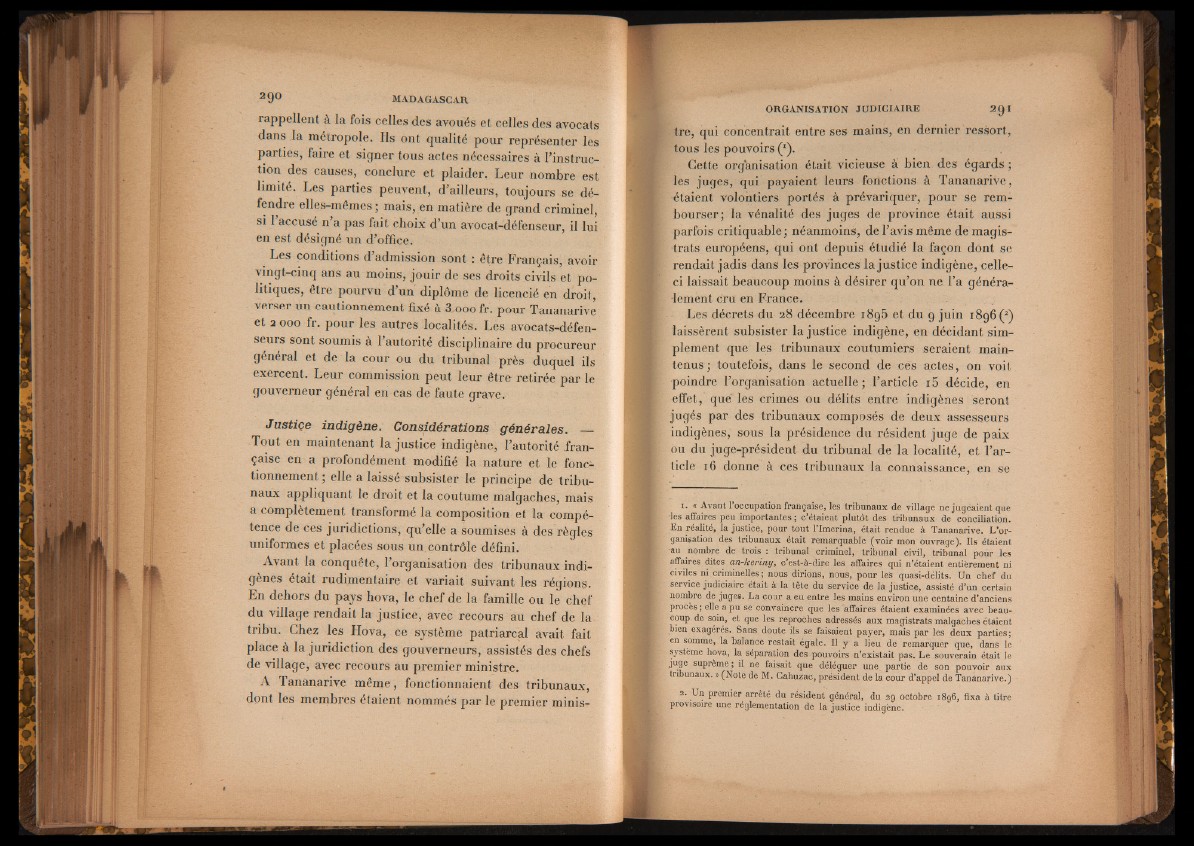
rappellent à la fois celles des avoués et celles des avocats
dans la métropole. Ils ont qualité pour représenter les
parties, faire et signer tous actes nécessaires à l’instruction
des causes, conclure et plaider. Leur nombre est
limité. Les parties peuvent, d’ailleurs, toujours se défendre
elles-mêmes; mais, en matière de grand criminel,
si 1 accusé n a pas fait choix d’un avocat-défenseur, il lui
en est désigné un d’office.
Les conditions d’admission sont : être Français, avoir
vingt-cinq ans au moins, jouir de ses droits civils et politiques,
être pourvu d’un diplôme de licencié en droit,
verser un cautionnement fixé à 3 ooo fr. pour Tananarive
et a ooo fr. pour les autres localités. Les avocats-défen-
seurs sont soumis a 1 autorité disciplinaire du procureur
général et de la cour ou du tribunal près duquel ils
exercent. Leur commission peut leur être retirée par le
gouverneur général en cas de faute grave.
Justiçe indigène. Considérations générales. _
Tout en maintenant la justice indigène, l’autorité française
en a profondément modifié la nature et le fonctionnement
; elle a laissé subsister le principe de tribunaux
appliquant le droit et la coutume malgaches, mais
a complètement transformé la composition et la compétence
de ces juridictions, qu’elle a soumises à des règles
uniformes et placées sous un contrôle défini.
Avant la conquête, l’organisation des tribunaux indigènes
était rudimentaire et variait suivant les régions.
En dehors du pays hova, le chef de la famille ou le chef
du village rendait la justice, avec recours au chef de la
tribu. Chez les Hova, ce système patriarcal avait fait
place à la juridiction des gouverneurs, assistés des chefs
de village, avec recours au premier ministre.
A Tananarive même, fonctionnaient des tribunaux,
dont les membres étaient nommés par le premier ministre,
qui concentrait entre ses mains, en dernier ressort,
tous les pouvoirs (').
Cette organisation était vicieuse â bien des égards ;
les juges, qui payaient leurs fonctions à Tananarive,
étaient volontiers portés à prévariquer, pour se rembourser;
la vénalité des juges de province était aussi
parfois critiquable; néanmoins, de l’avis même de magistrats
européens, qui ont depuis étudié la façon dont se
rendait jadis dans les provinces la justice indigène, celle-
ci laissait beaucoup moins à désirer qu’on ne l’a généralement
cru en France.
Les décrets du 28 décembre 1895 et du 9 juin 1896 (2)
laissèrent subsister la justice indigène, en décidant simplement
que les tribunaux coutumiers seraient maintenus;
toutefois, dans le second de ces actes, on voit
•poindre l’organisation actuelle; l’article i5 décide, en
effet, que' les crimes ou délits entre indigènes seront
jugés par des tribunaux composés de deux assesseurs
indigènes, sous la présidence du résident juge de paix
ou du juge-président du tribunal de la localité, et l ’article
16 donne à ces tribunaux la connaissance, en se
1. « Avant l’occupation française, les tribunaux de village ne jugeaient que
•les affaires peu importantes ; c’étaient plutôt des tribunaux de conciliation.
En réalité, la justice, pour tout l’Imerina, était rendue à Tananarive, L’organisation
des tribunaux était remarquable (voir mon ouvrage). Ils étaient
au nombre de trois : tribunal criminel, tribunal civil, tribunal pour les
affaires dites an-keriny, c’est-à-dire les affaires qui n’étaient entièrement ni
civiles ni criminelles; nous dirions, nous, pour les quasi-délits. Un chef du
service judiciaire était à la tête du service de la justice, assisté d’un certain
nombre de juges. La cour a eu entre les mains environ une centaine d’anciens
procès ; elle a pu se convaincre que les affaires étaient examinées avec beaucoup
de soin, et que les reproches adressés aux magistrats malgaches étaient
bien exagérés. Sans doute ils se faisaient payer, mais par les deux parties;
en somme, la balance restait égale. Il y a lieu de remarquer que, dans le
système hova, la séparation des pouvoirs n’existait pas. Le souverain était le
juge suprême ; il ne faisait que déléguer une partie de son pouvoir aux
tribunaux. » (Note de M. Cahuzac, président de la cour d’appel de Tananarive.)
2. Un premier arrêté du résident général, du 29 octobre 1896, fixa à titre
provisoire une réglementation de la justice indigène.