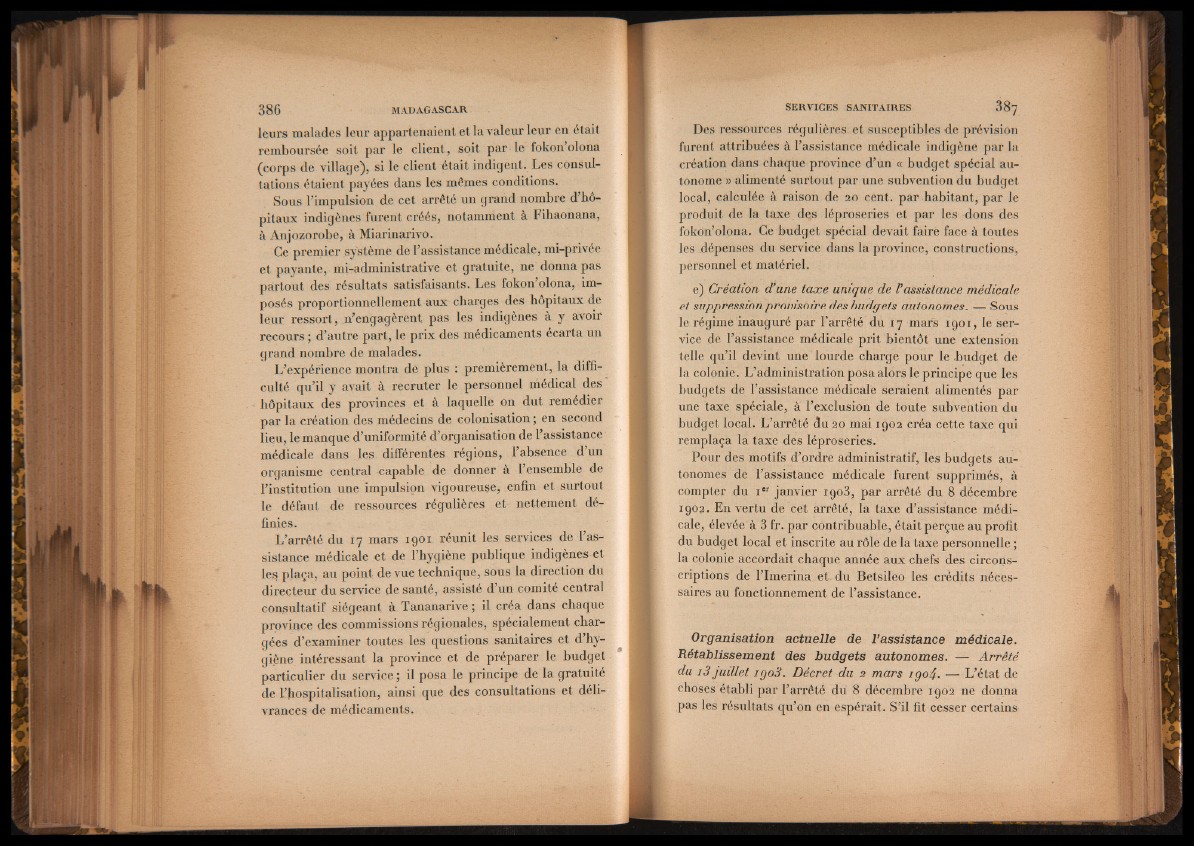
leurs malades leur appartenaient et la valeur leur en était
remboursée soit par le client, soit par le fokon’olona
(corps de village), si le client était indigent. Les consultations
étaient payées dans les mêmes conditions.
Sous l’impulsion de cet arrêté un grand nombre d hôpitaux
indigènes furent créés, notamment à Fihaonana,
àAnjozorobe, à Miarinarivo.
Ce premier système de l’assistance médicale, mi-privée
et payante, mi-administrative et gratuite, ne donna pas
partout des résultats satisfaisants. Les fokon’olona, imposés
proportionnellement aux charges des hôpitaux de
leur ressort, .n’engagèrent pas les indigènes à y avoir
recours ; d’autre part, le prix des médicaments écarta un
grand nombre de malades.
L’expérience montra de plus : premièrement, la difficulté
qu’il y avait à recruter le personnel médical des
hôpitaux des provinces et à laquelle on dut remédier
par la création des médecins de colonisation; en second
lieu, le manque d’uniformité d’organisation de l’assistance
médicale dans les différentes régions, l’absence d’un
organisme central capable de donner à l’ensemble de
l’institution une impulsion vigoureuse, enfin et surtout
le défaut de ressources régulières et nettement définies.
L’arrêté du 17 mars 1901 réunit les services de l’assistance
médicale et de l’hygiène publique indigènes et
les plaça, au point de vue technique, sous la direction du
directeur du service de santé, assisté d’un comité central
consultatif siégeant, à Tananarive ; il créa dans chaque
province des commissions régionales, spécialement chargées
d’examiner toutes les questions sanitaires et d’hygiène
intéressant la province et de préparer le budget
particulier du service ; il posa le principe de la gratuité
de L’hospitalisation, ainsi que des consultations et délivrances
de médicaments.
Des ressources régulières et susceptibles de prévision
furent attribuées à l’assistance médicale indigène par la
création dans chaque province d’un « budget spécial autonome
» alimenté surtout par une subvention du budget
local, calculée à raison de 20 cent, par habitant, par le
produit de la taxe des léproseries et par les dons des
fokon’olona. Ce budget spécial devait faire face à toutes
les dépenses du service dans la province, constructions,
personnel et matériel.
e) Création d’une taxe unique de Vassistance médicale
et suppression provisoire des budgets autonomes. — Sous
le régime inauguré par l’arrêté du 17 mars 1901, le service
de l’assistance médicale prit bientôt une extension
telle qu’il devint une ' lourde charge pour le budget de
la colonie. L’administration posa alors le principe que les
budgets de l’assistance médicale seraient alimentés par
une taxe spéciale, à l’exclusion de toute subvention du
budget local. L’arrêté 3u 20 mai 1902 créa cette taxe qui
remplaça la taxe des léproseries.
Pour des motifs d’ordre administratif, les budgets autonomes
de l’assistance médicale furent supprimés, à
compter du i er janvier rgo3, par arrêté du 8 décembre
1903. En vertu de cet arrêté, la taxe d’assistance médicale,
élevée à 3 fr. par contribuable, était perçue au profit
du budget local et inscrite au rôle de là taxe personnelle ;
la colonie accordait chaque année aux chefs des circonscriptions
de l’Imerina et du Betsileo les crédits nécessaires
au fonctionnement de l’assistance.
Organisation actuelle de l ’assistance médicale.
Rétablissement des budgets autonomes. — Arrêté
du i 3 juület igo3 . Décret du 2 mars igo4 . — L’état de
choses établi par l’arrêté du 8 décembre 1902 ne donna
pas les résultats qu’on en espérait. S’il fit cesser certains