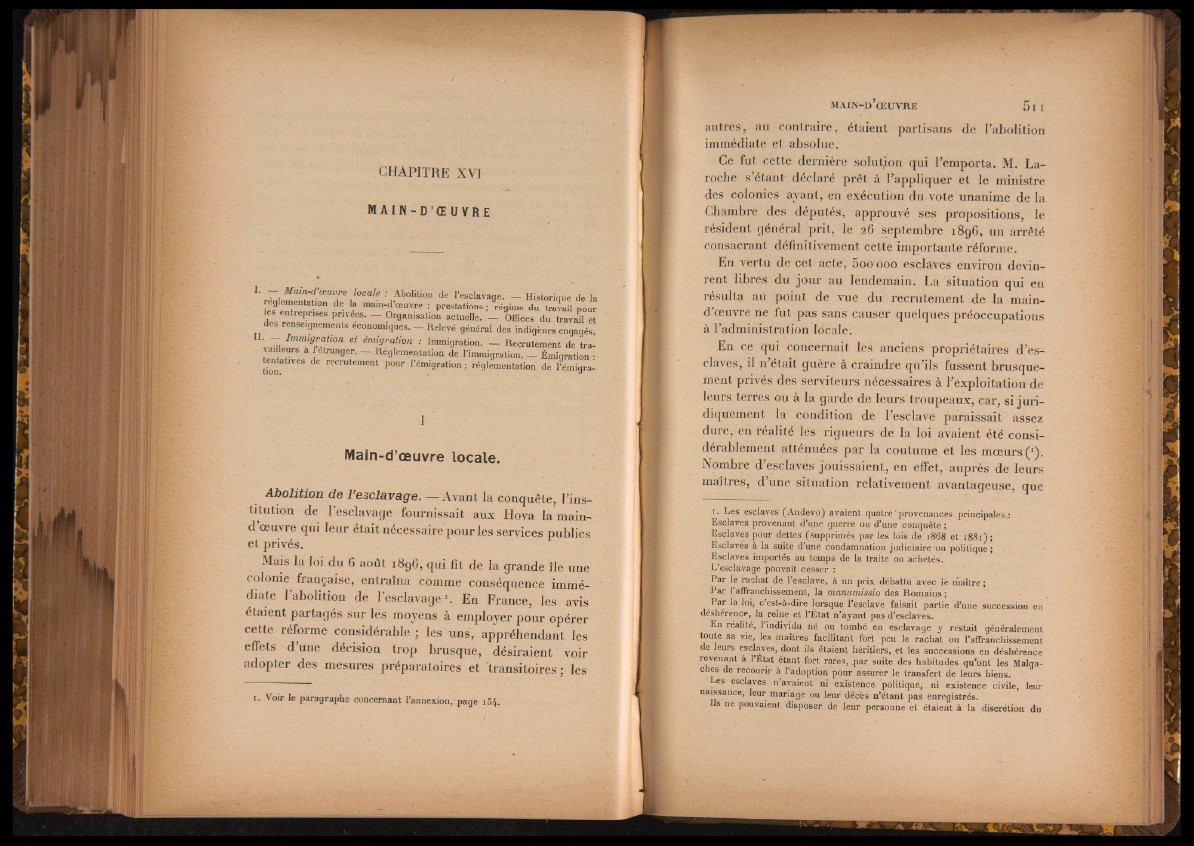
CHAPITRE XVI
MA I N - D ’OEUVRE
I. —] Main-d'oeuvre locale: Abolition de l'esclavage. — Historicme de la
!es3 e T ntatl0n ■ 18 maiI1-d’oeuvre : Prestations ; régime du travail pour
les entreprises privées. — Organisation actuelle. — Offices du travail et
des renseignements économiques. _ Relevé général des indigènes engagés.
H. - Immigration et émigration : Immigration. _ Recrutement de travailleurs
al.étranger. — Réglementation de l’immigration. — Émiqration :
tien recru,ement pour Emigration ; réglementation de l’émigra-
I
Main-d’oeuvre locale.
Abolition de l ’esclavage. — Avant la conquête, l’institution
de l’esclavage fournissait aùx Hova la main-
d’oeuvre qui leur était nécessaire pour les services publics
et privés.
Mais la loi du 6 août 1896, qui fit de la grande île une
colonie française, entraîna comme conséquence immédiate
l’abolition de l ’esclavage V En France, les avis
étaient partagés sur lés moyens à employer pour opérer
cette réforme considérable ; les uns, appréhendant les
effets d une décision trop brusque, désiraient voir
adopter des mesures préparatoires et transitoires ; les
1. Voir le paragraphe concernant l’annexion, page i54.
autres, au contraire, étaient partisans de l’abolition
immédiate et absolue.
Ce fut cette dernière solution qui l’emporta. M. Laroche
s étant déclaré prêt à l’appliquer et le ministre
des colonies ayant, en exécution du vote unanime de la
Chambre des députés, approuvé ses propositions, le
résident général prit, le 26 septembre 1896, un arrêté
consacrant définitivement cette importante réforme.
En vertu de cet acte, 5oo 000 esclaves environ devinrent
libres du jour au lendemain. La situation qui eu
résulta au point de vue du recrutement de la main-
d’oeuvre ne fut pas sans causer quelques préoccupations
à l’administration locale.
En ce qui concernait les anciens propriétaires d’esclaves,
il n’était guère à craindre qu’ils fussent brusquement
privés des serviteurs nécessaires à l’exploitation de
leurs terres ou à la garde de leurs troupeaux, car, si juridiquement
la condition de l’esclave paraissait assez
dure, en réalité les rigueurs de la loi avaient été considérablement
atténuées par la coutume et les moeurs(').
Nombre d’esclaves jouissaient, en effet, auprès de leurs
maîtres, d’une situation relativement avantageuse, que
1. Les esclaves (AndevoJ avaient quatre provenances principales,:
Esclaves provenant d’une guerre ou d’une conquête ;
Esclaves pour dettes (supprimés par les lois de 1868 et 1881) ;
Esclaves à la suite d’une condamnation judiciaire ou politique;
Esclaves importés au temps de la traite ou achetés.
L’esclavage pouvait cesser :
Par le rachat de l’esclave, à un prix débattu avec le maître ;
Par (’affranchissement, la manumissio des Romains ;
Par la loi, c’est-à-dire lorsque l’esclave faisait partie d’une succession en
déshérence, la reine et l’État n’ayant pas d’esclaves.
En réalité, 1 individu né pu tombé en esclavage y restait généralement
toute sa vie, les maîtres facilitant fort peu le rachat ou l’affranchissement
de leurs esclaves, dont ils étaient héritiers, et les successions en déshérence
revenant à l’Etat étant fort rares, .par suite des habitudes qu’ont les Malgaches
de recourir à l’adoption pour assurer le transfert de leurs biens.
Les esclaves n’avaient ni existence politique, ni existence civile, leur
naissance, leur mariage ou leur décès n’étant pas enregistrés.
ls ne pouvaient disposer de leur personne et étaient à la discrétion du