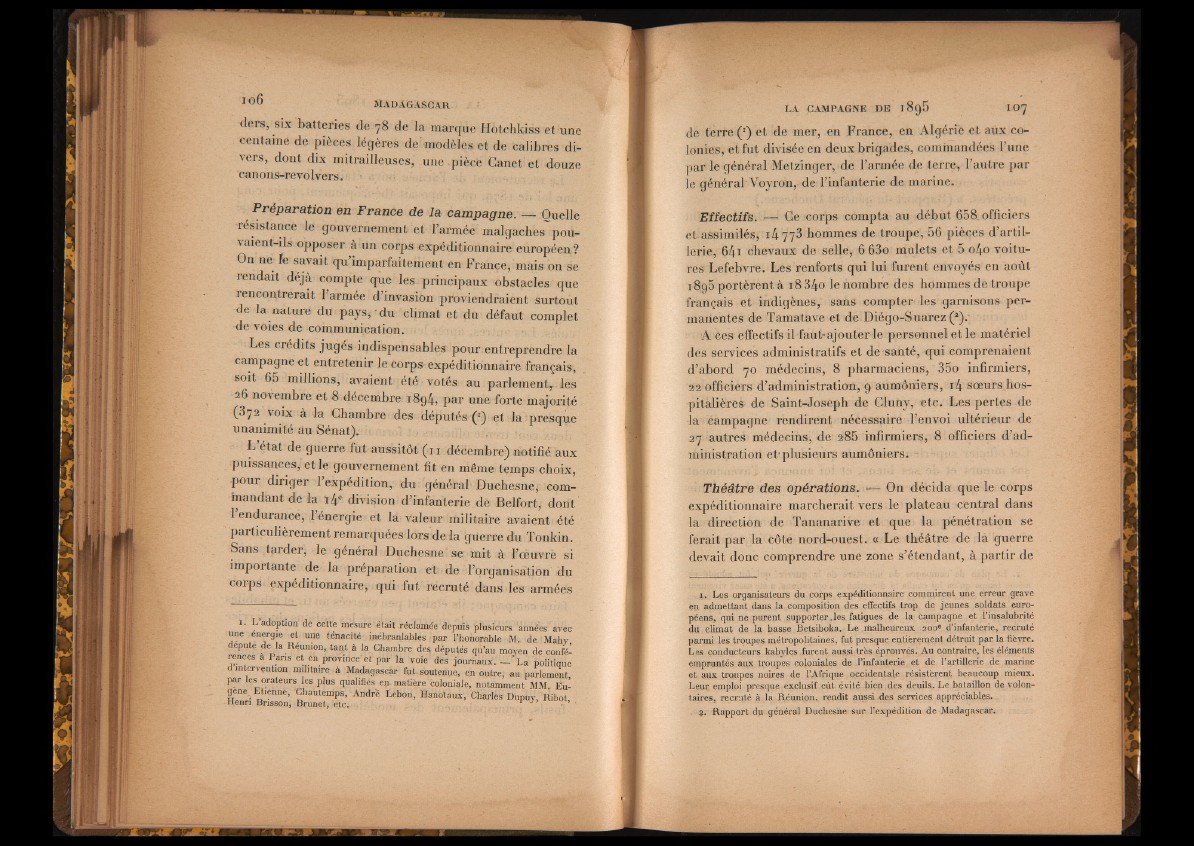
ders, s ix batteries de 78 de la marque Hotchkiss et une
centaine de pièces légères de'modèles et de calibres divers,
dont dix mitrailleuses; une pièce Canet et douze
canons-revolvers. •
Préparation en France de la campagne. — Quelle
résistance le gouvernement et l’armée malgaches^ pouvaient
ils opposer à un corps expéditionnaire européen?
On ne Je savait qu’imparfaitement en France, mais on se
rendait déjà compte que les principaux obstacles que
rencontrerait l’armée d’invasion proviendraient surtout
de la nature du pays, du climat et du défaut complet
de voies de communication.
Les crédits jugés indispensables pour entreprendre la
campagne et entretenir le corps expéditionnaire français,
soit 65 millions, avaient été votés au parlement, les
26 novembre et 8 décembre 1 8 9 4 , par une forte majorité
(372 voix à la Chambre des députés Q) et la - presque
unanimité au Sénat).
L’état de guerre fut aussitôt (1 x décembre) notifié aux
puissances, et le gouvernement fit en même temps choix,
pour diriger 1 expédition, du général Duchesnej commandant
de la ï 4* division d’infanterie dé Belfort, dont
1 endurance, 1 énergie et la valeur militaire avaient été
particulièrement remarquées lors de là guerre du Tonkin.
Sans tarder, le général Duchesne se mit à l’oeuvre si
importante de la préparation et de l’organisation du
corps expéditionnaire, qui fut recruté dans les armées
1. L ’adoption de cette mesure était réclamée depuis plusieurs années-'avec
une energie et une ténacité inébranlables par l’honorable M. de Mahv
député de la Réunion, tant à la Chambre des députés qu’au moyen de conférences
à Pans et en province'et par la voie des journaux. — ' La politique
d intervention militaire à Madagascar fut soutenue, e.n outre, au parlement
par les orateurs les plus qualifiés en. matière coloniale, notamment MM. Eugène,
Etienne, Chautemps, André Lebon, Hanotaux, Charles Dupuv Ribot
Henri Brisson, Brunet, etc. . ’
de terre (') et de mer, en France, en Algérie et aux colonies,
et fut divisée en deux brigades, commandées l’une
par le général Metzinger, de l’armée de terre, l’autre par
le général’Voyron, de l’infanterie de marine.
Effectifs. — Ce corps compta au début 658, officiers
et assimilés, i 4 7?3 hommes de troupe, 56 pièces d’artillerie,
64i chevaux de selle, 6 63o mulets et 5 o4o voitures
Lefebvre. Les renforts qui lui furent envoyés en août
1895 portèrent à i 834o le nombre des hommes de troupe
français et indigènes, sans compter les garnisons permanentes
de Tamatave et de Diëgo-Suarez (2).
A ces effectifs il faut-ajouter le personnel et le matériel
des services administratifs et de santé, qui comprenaient
d’abord 70 médecins, 8 pharmaciens, 35o infirmiers,
22 officiers d’administration, 9 aumôniers, 14 soeurs hospitalières
de Saint-Joseph de Gluny, etc. Les pertes de
la campagne rendirent nécessaire l’envoi ultérieur de
27 autres médecins, de 286 infirmiers, 8 officiers d’administration
et’plusieurs aumôniers.
Théâtre des opérations. On décida que le corps
expéditionnaire marcherait vers le plateau central dans
la direction de Tananarive et que la pénétration se
ferait par la côte nord-ouest. « Le théâtre de la guerre
devait donc comprendre une zone s’étendant, à partir de
i . Les organisateurs du corps expéditionnaire commirent une erreur grave
en admettant dans la composition des effectifs trop, de jeunes soldats européens,
qui ne purent supporter*les fatigues de la campagne et l’insalubrité
du climat de la basse Betsiboka. Le riialbeureux 200e d’infanterie, recruté
parmi les troupes métropolitaines, fut presque entièrement détruit par la fièvre.
Les conducteurs kabyles furent aus^i-très éprouvés. Au contraire, les éléments
empruntés aux troupes coloniales de l’infanterie et de l’artillerie de marine
et 31UX troupes noires de l’Afrique occidentale résistèrent beaucoup mieux.
Leur, emploi presque exclusif eût évité bien ,des deuils. Le bataillon de volontaires,
recruté à la Réunion, rendit aussi des services, appréciables.
. ?. Rapport du général Duchesne sur l’expédition de Madagascar.