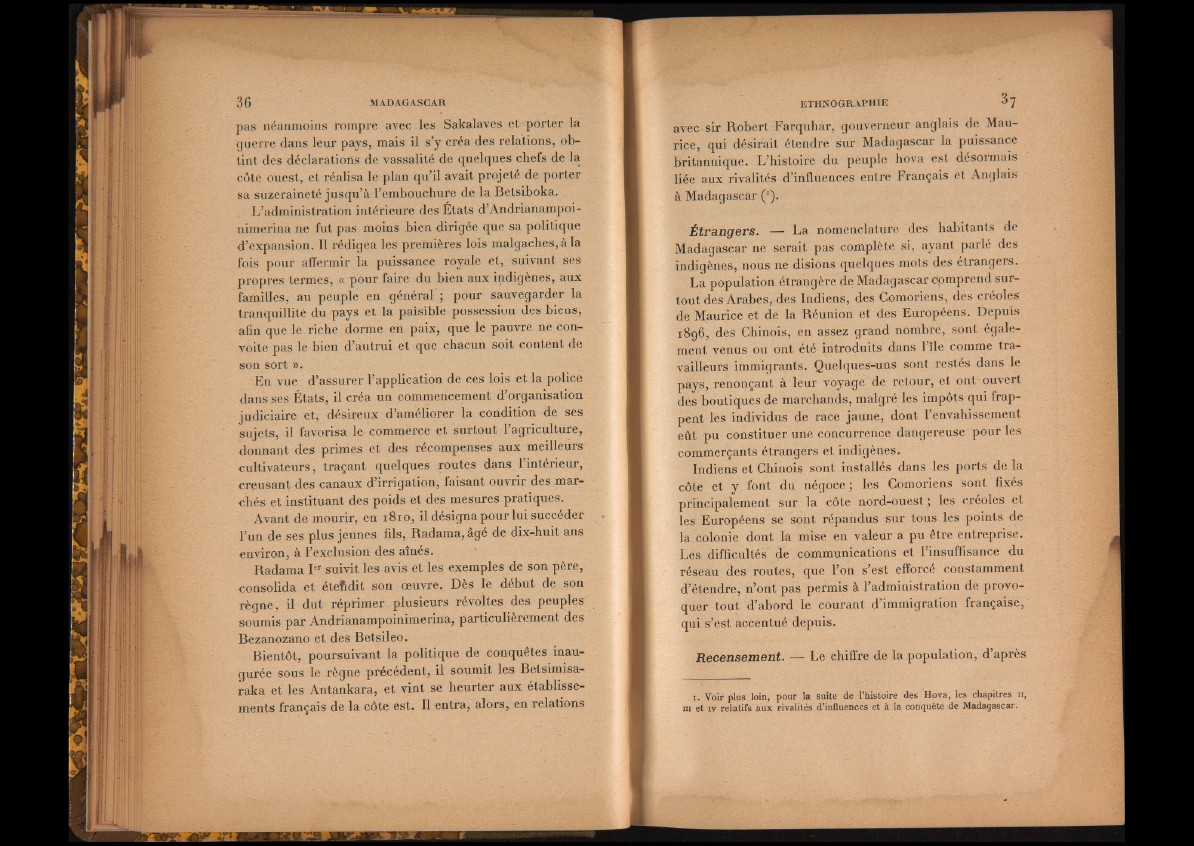
pas néanmoins rompre avec les Sakalaves et porter la
guerre dans leur pays, mais il s’y créa des relations, obtint
des déclarations de vassalité de quelques chefs de la
côte ouest, et réalisa le plan qu’il avait projeté de porter
sa suzeraineté jusqu’à l’embouchure de la Betsiboka.
L’administration intérieure des États d’Andrianampoi-
nimerina ne fut pas moins bien dirigée que sa politique
d’expansion. Il rédigea les premières lois malgaches, à la
fois pour affermir la puissance royale et, suivant ses
propres termes, « pour faire du bien aux indigènes, aux
familles, au peuple en général'; pour sauvegarder la
tranquillité du pays et la paisible possession des biens,
afin que le riche dorme en paix, que le pauvre ne convoite
pas le bien d’autrui et que chacun soit content de
son sort ».
En vue d’assurer l’application de ces lois et la police
dans ses États, il créa un commencement d’organisation
judiciaire et, désireux d’améliorer la condition de ses
sujets, il favorisa le commerce et surtout l’agriculture,
donnant des primes et des récompenses aux meilleurs
cultivateurs, traçant quelques routes dans 1 intérieur,
creusant des canaux d’irrigation, faisant ouvrir des marchés
et instituant des poids et des mesures pratiques.
Avant de mourir, en 1810, il désigna pour lui succéder
l’un de ses plus jeunes fils, Radama, âgé de dix-huit ans
environ, à l’exclusion des aînés.
Radama Ier suivit les avis et les exemples de son père,
consolida et éteftdit son oeuvre. Dès le début de son
règne, il dut réprimer plusieurs révoltes des peuples
soumis par Andrianampoinimerina, particulièrement des
Bezanozano et des Betsileo.
Bientôt, poursuivant la politique de conquêtes inaugurée
sous le règne précédent, il soumit les Betsimisa-
raka et les Antankara, et vint se heurter aux établissements
français de la côte est. Il entra, alors, en relations
avec-sir Robert Farquhàr, gouverneur anglais de Maurice,
qui désirait étendre sur Madagascar la puissance
britannique. L’histoire du peuple hova est désormais
liée aux rivalités d’influences entre Français et Anglais
à Madagascar (*).
Étrangers. — La nomenclature des habitants de
Madagascar ne serait pas complète si, ayant parlé des
indigènes, nous ne disions quelques mots des étrangers.
La population étrangère de Madagascar comprend surtout
des Arabes, des Indiens, des Comoriens, des créoles
de Maurice et de la Réunion et des Européens. Depuis
1896, des Chinois, en assez grand nombre, sont également
venus ou ont été introduits dans l’île comme travailleurs
immigrants. Quelques-uns sont restés dans le
pays, renonçant à leur voyage de retour, et ont ouvert
des boutiques de marchands, malgré les impôts qui frappent
les individus de race jaune, dont l’envahissement
eût pu constituer une concurrence dangereuse pour les
commerçants étrangers et indigènes.
Indiens et Chinois sont installés dans les ports de la
côte et y font du négoce; les Comoriens sont fixés
principalement sur la côte nord-ouest ; les créoles et
les Européens se sont répandus sur tous les points de
la colonie dont la mise en valeur a pu être entreprise.
Les difficultés de communications et l’insuffisance du
réseau des routes, que l’on s’est efforcé constamment
d’étendre, n’ont pas permis à l’administration de provoquer
tout d’abord le courant d’immigration française,
qui s’est accentué depuis.
Recensement. — Le chiffre de la population, d’après
1. Voir plus loin, pour la suite de l’histoire des Hova, les chapitres u,
m et iv relatifs aux rivalités d’influences et à la conquête de Madagascar.