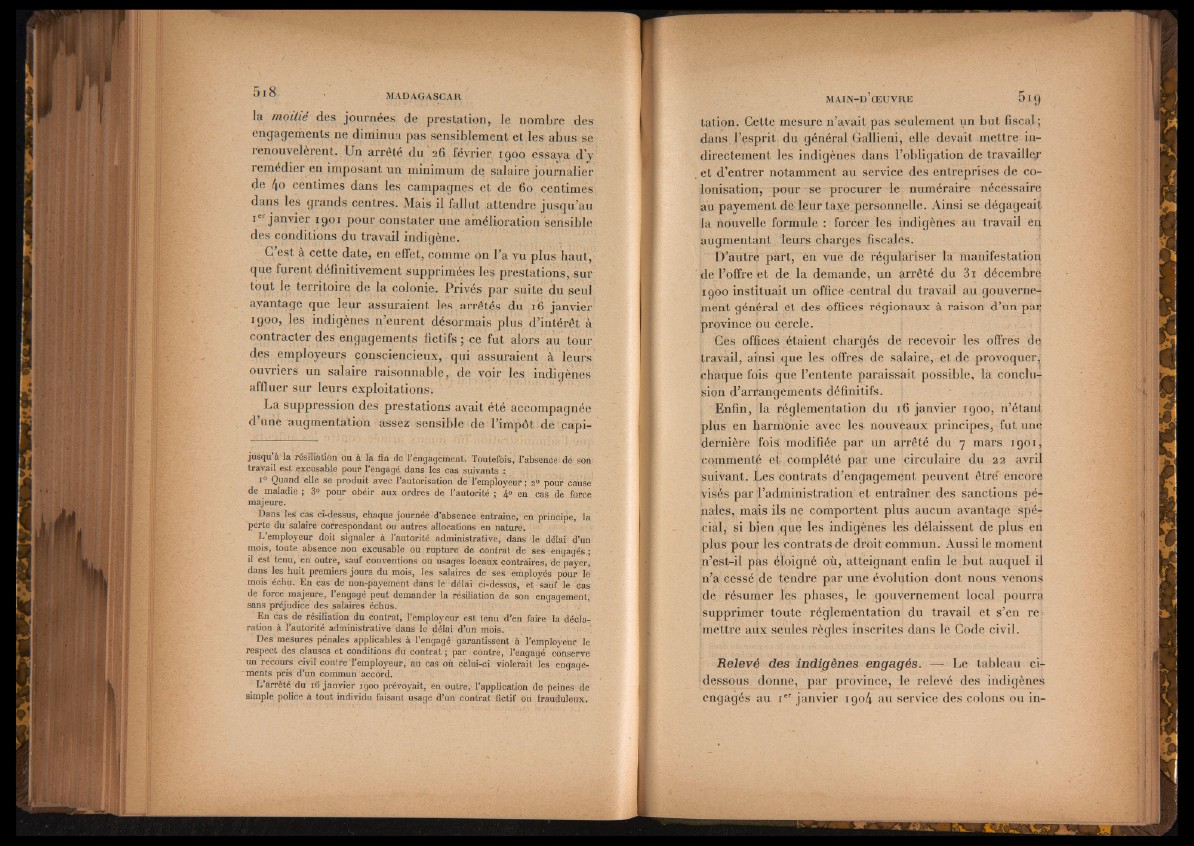
la moitié des journées de prestation, le nombre des
engagements ne diminua pas sensiblement et les abus se
renouvelèrent. Un arrêté du 26 février 1900 essaya d’y
remédier en imposant un minimum de salaire journalier
de 4° centimes dans les campagnes et de 60 centimes
dans les grands centres. Mais il fallut attendre jusqu’au
I er janvier 1901 pour constater une amélioration sensible
des conditions du travail indigène.
C’est à cette date, en effet, comme on l’a vu plus haut,
que furent définitivement supprimées les prestations, sur
tout le territoire de la colonie. Privés par suite du seul
ayantage que leur assuraient les arrêtés du 16 janvier
1900, les indigènes n’eurent désormais plus d’intérêt à
contracter des engagements fictifs; ce fut alors au tour
des employeurs consciencieux, qui assuraient à leurs
ouvriers un salaire raisonnable, de voir les indigènes
affluer sur leurs exploitations'.
La suppression des prestations avait été accompagnée
d’une augmentation assez sensible de l’impôt de capijusqu’à
la résiliation ou à la fin do l'engagement. Toutefois, l’absence' de son
travail est excusable pour L’engagé dans les cas suivants
i° Quand elle se produit avec l ’autorisation de l’employeur; 2° pour cause
de maladie ; 3» pour obéir aux ordres de l’autorité ; 4» en cas de force
majeure.
Dans les cas ci-dessus, chaque journée d’absence entraîne, en principe, la
perte du salaire correspondant ou autres allocations en nature.
L ’employeur doit signaler à l’autorité administrative, dans le délai d’un
mois, toute absence non excusable ou rupture de contrat de ses engagés,;
il est tenu, en outré, sauf conventions ou usages locaux contraires, de payer,
dans les huit premiers jours du mois, les salaires de ses employés pour le
mois échu. En cas de non-payement dans lé délai ci-dessus, et sauf le Cas
de force majeure, l’engagé peut demander la résiliation de son engagement,
sans préjudice des salaires échus.
En cas de résiliation du contrat, l’employeur est tenu d’en faire la déclaration
à l’autorité administrative dans le délai d’un mois.
Des mesures pénales applicables à l’engagé garantissent à l’employeur le
respect des clauses et conditions du contrat ; par contre, l’engagé conserve
un recours civil contre l’employeur, au cas où cëlui-ci violerait les engagements
pris d’un commun accord.
L arrêté du 16 janvier igoo prévoyait, en outre,- l’application de peines de
simple police à tout individu faisant usage d’un contrat fictif ou frauduleux.
tation. Cette mesure n’avait pas seulement un but fiscal ;
dans l’esprit du général Gallieni, elle devait mettre indirectement
les indigènes dans l’obligation de travaille^
et d’entrer notamment au service des entreprises de colonisation,
pour se procurer le numéraire nécessaire
au payement de leur taxe personnelle. Ainsi se dégageait
la nouvelle formule : forcer les indigènes au travail eij
augmentant leurs charges fiscales.
D’autre part, en vue de régulariser la manifestation
de l’offre et de la demande, un arrêté du 3i décembre
1900 instituait un office -central du travail au gouverne-i
ment général et des offices régionaux à raison d’un pai;
province ou cercle.
Ces offices étaient chargés de recevoir les offres de
travail, ainsi que les offres de salaire, et de provoquer,
chaque fois que l’entente paraissait possible, la conclu-r
sion d’arrangements définitifs.
Enfin, la réglementation du 16 janvier 1900, n’étant
plus en harmonie avec les nouveaux principes, fut une
dernière fois modifiée par un arrêté- du 7 mars 1901,
commenté ei complété par une circulaire du 22 avril
suivant. Les contrats d’engagement peuvent être' encore
visés par l’administration et entraîner des sanctions pénales,
mais ils ne comportent plus aucun avantage spécial,
si bien que les indigènes les délaissent de plus en
plus pour les contrats de droit commun. Aussi le moment
n’est-il pas éloigné où, atteignant enfin le but auquel il
n’a cessé de tendre par une évolution dont nous venons
de résumer les phases, le gouvernement local pourra
supprimer toute réglementation du travail et s’en rei
‘mettre aux seules règles inscrites dans le Code civil.
Relevé des indigènes engagés. —- Le tableau ci-
dessous donne, par province, le relevé des indigènes
engagés au I er janvier 1904 au service des colons ou in