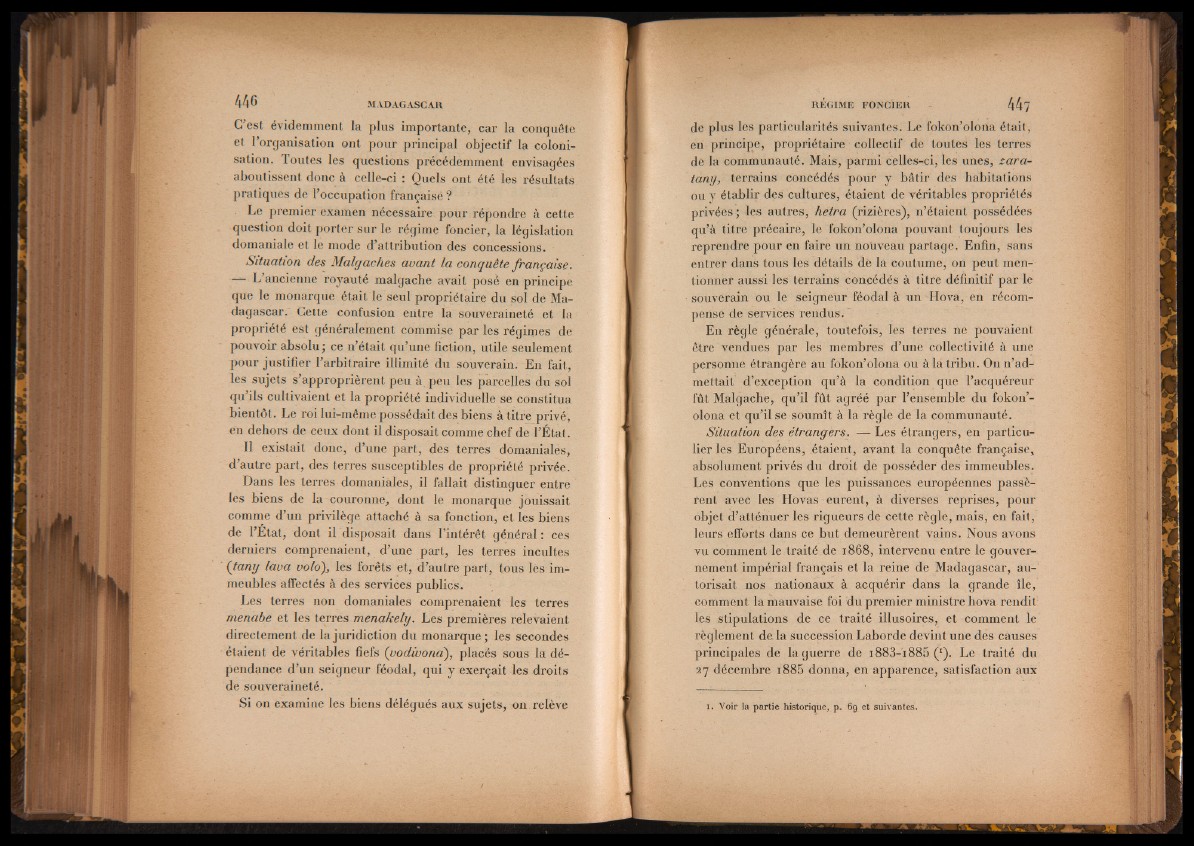
C’est évidemment la plus importante, car la conquête
et l’organisation ont pour principal objectif la colonisation.
Toutes les questions précédemment envisagées
aboutissent donc à celle-ci : Quels ont été les résultats
pratiques de l’occupation française ?
Le premier examen nécessaire pour répondre à cette
question doit porter sur le régime foncier, la législation
domaniale et le mode d’attribution des concessions.
Situation des Malgaches avant la conquête française.
— L’ancienne royauté malgache avait posé en principe
que le monarque était le seul propriétaire du sol de Madagascar.
Cette confusion entre la souveraineté et la
propriété est généralement commise par les régimes de
pouvoir absolu; ce n’était qu’une fiction, utile seulement
pour justifier l’arbitraire illimité du souverain. En fait,
les sujets s’approprièrent peu à peu les parcelles du sol
qu’ils cultivaient et la propriété individuelle se constitua
bientôt. Le roi lui-même possédait des biens à titre privé,
en dehors de ceux dont il disposait comme chef de l’État.
Il existait donc, d’une part, des terres domaniales,
d’autre part, des terres susceptibles de propriété privée.
Dans les terres domaniales, il fallait distinguer entre
les biens de la couronne, dont le monarque jouissait
comme d’un privilège attaché à sa fonction, et les biens
de l’État, dont il disposait dans l’intérêt général : ces
derniers comprenaient, d’une part, les terres incultes
(tany lava volo), les forêts et, d’autre part, tous les immeubles
affectés à des services publics.
Les terres non domaniales comprenaient les terres
menabe et les terres menakely. Les premières relevaient
directement de la juridiction du monarque; les secondes
étaient de véritables fiefs (vodivona), placés sous la dépendance
d’un seigneur féodal, qui y exerçait les droits
de souveraineté.
Si on examine les biens délégués aux sujets, on relève
de plus les particularités suivantes. Le fokon’olona était,
en principe, propriétaire collectif de toutes les terres
de la communauté. Mais, parmi celles-ci, les unes, zara-
tany, terrains concédés pour y bâtir des habitations
ou y établir des cultures, étaient de véritables propriétés
privées; les autres, hetra (rizières), n’étaient possédées
qu’à titre précaire, le fokon’olona pouvant toujours les
reprendre pour en faire un nouveau partage. Enfin, sans
entrer dans tous les détails de la coutume, on peut mentionner
aussi les terrains concédés à titre définitif par le
souverain ou le seigneur féodal à un Ho va, en récompense
de services rendus.
En règle générale, toutefois, les terres ne pouvaient
être vendues par les membres d’une collectivité à une
personne étrangère au fokon’olona ou à là tribu. On n’admettait
d’exception qu’à la condition que l’acquéreur
fût Malgache, qu’il fût agréé par l’ensemble du fokon’olona
et qu’il se soumît à la règle de la communauté.
Situation des étrangers. — Les étrangers, en particulier
les Européens, étaient, avant la conquête française,
absolument privés du droit de posséder des immeubles.
Les conventions que les puissances européennes passèrent
avec les Hovas eurent, à diverses reprises, pour
objet d’atténuer les rigueurs de cette règle, mais, en fait,
leurs efforts dans ce but demeurèrent vains. Nous avons
vu comment le traité de 1868, intervenu entre le gouvernement
impérial français et la reine de Madagascar, autorisait
nos nationaux à acquérir dans la grande île,
comment la mauvaise foi du premier ministre hova rendit
les stipulations de ce traité illusoires, et comment le
règlement de la succession Laborde devint une dès causes
principales de la guerre de 1883-1885 (*). Le traité du
27 décembre i 885 donna, en apparence, satisfaction aux
1. Voir la partie historique, p. 69 et suivantes.