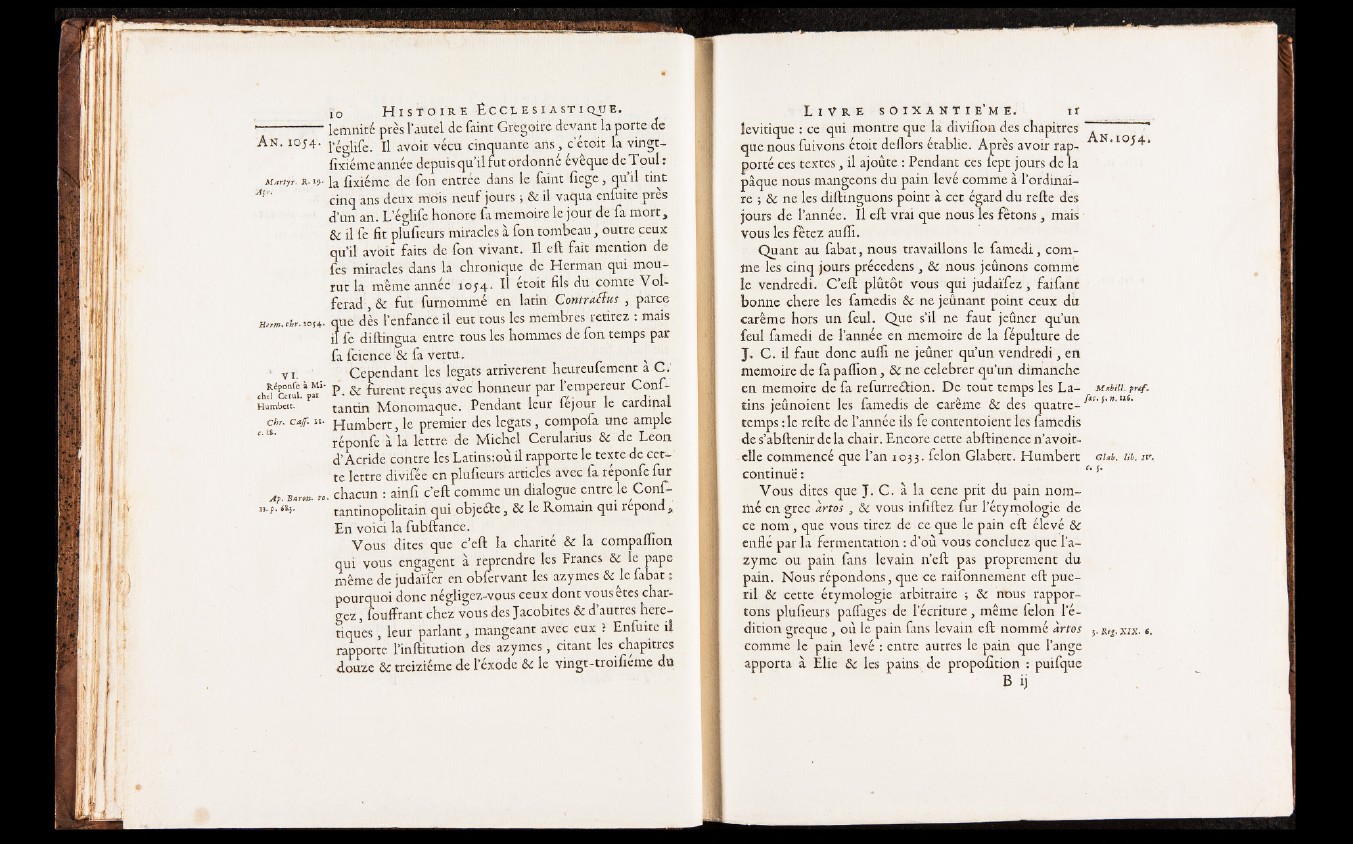
A n . 1054.
M a r ty r . R- i ? -
Jipr.
Herrn* chr. 1054.
V ï . v
Réponfe à Mic
h e l C e r u l . p a t
H u m b e r t .
Chr. Cajf. U-
c. M
A p . Baron- to
i l . p. 6%$.
| | H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
lemnicé près l’autel de faint Grégoire devant la porte de
l’églife. Il avoit vécu cinquante ans, c etoit la vingt-
fixiéme année depuis qu il fut ordonne eveque de Tout r
la fixiéme de fon entrée dans le faint iiege, qu’il tint
cinq ans deux mois neuf jours ; 8c il vaqua eniuite près
d’un an. L’églife honore fa mémoire le jour de fa mort,
& il iè fit plufieurs miracles à fon tombeau, outre ceux
qu’il avoit faits de fon vivant. Il eft fait mention de
fes miracles dans la chronique de Herman qui mourut
la même année 1054. Il étoit fils du comte Vol-
fe rad, & fut furnommé en latin Contr&cl'us , parce
que dès l’enfance il eut tous les membres retirez . mais
il fe diftinuua entre tous les hommes de fon temps par
fa fcience & fa vertu. v
Cependant les légats arrivèrent heureufement a C .
P. 8c forent reçus avec honneur par 1 empereur Conf-
tantin Monomaquè. Pendant leur iejour le cardinal
Humbert, le premier des légats, compofa une ample
réponfe à la lettre de Michel Cerularius 8c de Léon
d’Acride contre les Latins:ou il rapporte le. texte de cette
lettre divifée en plufieurs articles avec fa reponfe fur
chacun : ainfî c’eft comme un dialogue entre le Conf-
tantinopolitain qui obje&e, 8c le Romain qui repond*
En voici la fubftance.
Vous dites que c’eft la charité & la compaffion
qui vous engagent à reprendre les Francs 8c le pape
même de judaïfer en obiervant les azymes & Je fabat :
pourquoi donc négligez-vous ceux dont vous êtes chargez
, fouffrant chez vous des Jacobites & d autres hérétiques
, leur parlantg mangeant avec eux ? Enfuite il
rapporte l’inftitution des azymes, citant les chapitres
douze 8c treizième de l’éxode 8c le vingt-troifieme du
L i v r e s o i x a n t i e ’ m e . f i
levitique : ce qui montre que la divifioa des chapitres . ~ ’
que nous fuivons étoit deflors établie. Après avoir rap- • IOJ4 >
porté ces textes, il ajoute : Pendant ces fept jours de la
pâque nous mangeons du pain levé comme à l’ordinaire
; & ne les diftinguons point à cet égard du refte des
jours de l’année. Il eft vrai que nous les fêtons, mais -
vous les fêtez auffi.
Quant au fabat, nous travaillons le famedi, comme
les cinq jours précedens, 8c nous jeûnons comme
le vendredi. C ’eft plûtôt vous qui judaïfez, faifant
bonne chere les famedis 8c ne jeûnant point ceux du
carême hors un feul. Que s’il ne faut jeûner qu’un
feul famedi de l’année en mémoire de la fépulture de
J. C . il faut donc auifi ne jeûner qu’un vendredi, en
mémoire de fa palfion, 8c ne celebrer qu’un dimanche
en mémoire de fa refurre&ion. De tout temps les La- m m i . pnf.
tins jeûnoient les famedis de carême 8c des quatre- ni~
temps : le refte de l’année ils fe contentoient les famedis
de s’abftenir de la chair. Encore cette abftinence n’avoit-
clle commencé que l’an 1033. félon Glabert. Humbert c m . ut. iv.
continue : c‘ *'
Vous dites que J. C . à la cene prit du pain nommé
en grec àrtos , 8c vous infiftez for l’étymologie de
ce n om , que vous tirez de ce que le pain eft élevé 8c
enflé par la fermentation : d’oû vous concluez que l’azyme
ou pain fans levain n’eft pas proprement du
pain. Nous répondons, que ce raifonnement eft puéril
& cette étymologie arbitraire ; 8c nous rapportons
plufieurs paifages de l’écriture, même lelon l’édition
greque, où le pain fans levain eft nommé àrtos 3. Rti. xix. t.
comme le pain levé : entre autres le pain que l’ange
apporta à Elie 8c les pains de propofîtion : puifque
B ij