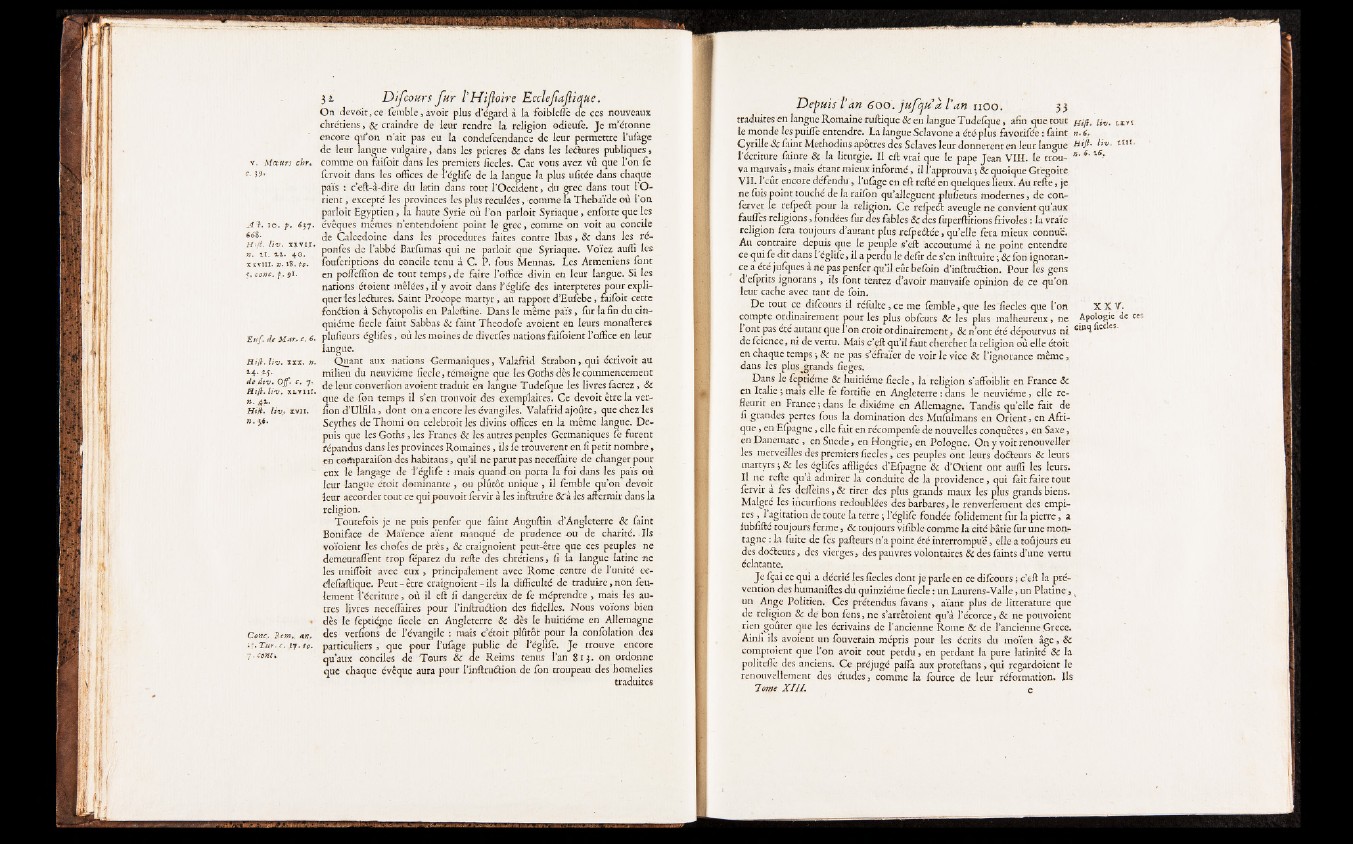
v. Moeurs chr.
c.
A ' ï . 10 . p . 6 3 7 .
éoSHiM
liv . x x v i r .
». t i . î i . 40.
x x v i i i . » . 1 8 . to.
f, conc. p. 91.
Euf. de Mar.-c. 6.
Hifi. liv . x x x . ».
14. *5.
de dtv. Ojf. c. 7.
Htfi. liv . X L V I I I .
». 42..
Ht fi. liv . x v il.
».
C0»r. Stf«.. «»>
i*. T«r. f. 17. to.
7. ¿■flTZÎi
On devoir, ce 'femble, avoir plus d’égard à la foiblefle de ces nouveaux
chrétiens, & craindre de leur rendre la religion odieufè. Je m’étonne
encore qii’on n’ait pas eu la condefcendance de leur permettre l’ufage
de leur langue vulgaire, dans les prières & dans les leéfcures publiques,
comme on faifoit dans les premiers fiecles. Car vous avez vû que l ’on fe
fcrvoit dans les offices de îeglïfe de la langue la plus ufitée dans chaque
païs : c’éft-à-dire du latin dans tout l’Occident , du grec dans tout l’O rient,
excepté les provinces les plus reculées, comme la Thebaïde où l’on
parloit Egyptien , la haute Syrie où l’on parloit Syriaque, enforte que les
évêques mêmes n’entendoient point le grec, comme on voit au concile
de Calcédoine dans les procédures faites contre Ibas, & dans les ré-
ponfes de l’abbé Bariùmas qui ne parloit que Syriaque. Voïez auffi les
foufcriptions du concile tenu à C . P. fous Mennas. Les Arméniens font
en pofîeffion de tout temps, de faire l’office divin en leur langue. Si les
nations étoient mêlées, il y avoit dans l’églife des interptetes pour expliquer
les leétures. Saint Procope martyr, au rapportd’Eufebe, faifoit cette
fonction à Schytopolis en Paleftine. Dans le meme païs, fur la fin du cinquième
fiecle faint Sabbas 6c faint Theodofe avoient en leurs monafteres
plufieurs églifes, où les moines de divcrfes nations faifoient l’office en leur
langue.
Quant aux -nations Germaniques, Valafrid Strabon,.qui écrivoit au
milieu du neuvième fiecle, témoigne que les Çoths dès le commencement
de leur converfion avoient traduk en langue Tudefque les livres facrez, 6c
que de fon temps il s’en trouvoit des exemplaires. Ce devoit être la ver-
fion d’Ulfila, dont on a encore les évangiles. Valafrid ajoute, que chez les
Scythes de Thomi on celebroit les divins offices en la même langue. Depuis
que les Goths, les Francs & les autres peuples Germaniques fe furent
répandus dans les provinces Romaines, ils fe trouvèrent en fi petit nombre »
en cortiparaifon des habitans, qu’il ne parut pas necefïaire de changer pour
eux le langage de l ’églifè : mais quand on porta la foi dans les païs où
leur langue étoït dominante , ou plutôt unique , il femble qu’on devoit
leur accorder tout ce qui pouvoir fervir à les mftruire 6cà les affermir dans la
religion.
Toutefois je ne puis perifer que faint Auguftin d’Angleterre & faint
Boniface de Maïence aient manqué de prudence ou de charité. • Ils
voïoient les chofes de près, & craignoient peut-être que ces peuples ne
demeuraflent trop fépàrez du refte des chrétiens, fi la langue latine ne
les unifïbit avec eux , principalement avec Rome centre de l’unité ee-
CÎefiaftique. Peut - être craignoient - ils la difficulté de traduire, non feulement
l ’écriture, où il eft fi dangereux de fe méprendre, mais les autres
ljvres neceiïàires pour l’inftruction des fidelles. Nous voïons bien
dès le feptiéjne fiecle en Angleterre 6c dès le huitième en Allemagne
des verfions de Tévangile : mais c’étoit plûtôt pour la confolation des
particuliers , que pour l’ufàge public de l’églife. Je trouve encore
qu’aux conciles de Tours 6c de Reims tenus l’an 813. on ordonne
que chaque évêque aura pour l ’inftru&ion de fon troupeau des homelies
traduites
traduites en langue Romaine ruftique 6c en langue Tudefque, afin que tout Hifi, jm LXyî
le monde les puifîè entendre. La langue Sclavone a été plus fkvorifce : faint ». 6.
Cyrille & fàint Methodius apôtres des Sclaves leur donnèrent en leur langue Hifl- liv- tur‘
l ’écriture fainte 6c la liturgie. Il eft vrai que le pape Jean VIII. le trou- 6‘ l6-
va mauvais,.mais étant mieux informé, il l’approuva -, 6c quoique Grégoire
VII. l’eut encore défendu, Inflige en eft refté en quelques lieux. Au refte, je
ne fuis point touche de la raiion qu’alleguent plufieurs modernes, de confèrver
le refpeét pour la religion. Ce refpeét aveugle ne convient qu’aux
faufïes religions, fondées fur des fables 6c des fuperftitions frivoles : la vraie
religion fera toujours d’autant plus refpeétée, qu’elle fera mieux connue.
Au contraire depuis que le peuple s’eft accoutumé à ne point entendre
ce qui fe dit dans 1 eglile, il a perdu le defir de s’en inftruire *, 6c fori ignorance
a été jufques a ne pas penfer qu’il eût befoin d’inftruétion. Pour les gens
d efprits ignorans , ils font tentez d’avoir mauvaiie opinion de ce qu’on
leur cache avec tant de foin.
De tout ce difcours il réfiilte,ce me femble,que les'fiecles que l’on X X Y.
compte ordinairement pour les plus obfcurs 6c les plus malheureux, ne Apologie de ces
I ont pas été autant que l’on croit ordinairement, 6c n?ont été dépourvus ni ^cc es
de fcience, ni de vertu. Mais c’eft qu’il faut chercher la religion où elle étoit
en chaque temps \ 6c ne pas s’éfraïer de voir le vice 6c l’ignorance même,
dans les plus ^grands fieges.
Dans le feptiemc 6c huitième fiecle, la religion s’affoiblit en France 6c
en Italie j mais elle Ce fortifie en Angleterre : dans le neuvième, elle refleurit
en France •, dans le dixième en Allemagne. Tandis qu’elle fait de
fi grandes pertes fous la domination des Mufulmans en Orient, en Afrique
, en Efpagne, elle fait en récompenfe de nouvelles conquêtes, en Saxe,
en Danemarc, en Suede, en Hongrie, en Pologne. On y voit renouvellcr
les merveilles des premiers fiecles, ces peuples ont leurs do&eurs 6c leurs
martyrs -, 6c les églifes affligées d’Efpagne 6c d’Orient ont auffi les leurs.
II ne refte qu’à admirer la conduite de la providence, qui fait faire tout
fèrvir à fes deiïèins, 6c tirer des plus grands maux les plus grands biens.
Malgré les incurfions redoublées des barbares, le renverfement des empires
, 1 agitation de toute la terre j l’églife fondée folidement fur la pierre, a
fubfifté toujours ferme, & toujours vifible comme la cité bâtie fur une montagne
: la fuite de fes pafteurs n’a point été interrompue, elle a toujours eu
des do&eurs, des vierges, des pauvres volontaires 6c des faints d’une vertu
éclatante.
Je fçai ce qui a décrié les fiecles dont je parle en ce difcours ; c’eft la prévention
des humaniftes du quinzième fiecle : un Laurens-Valle, un Platine, v
un Ange Politien. Ces prétendus favans , aïant plus de littérature que
de religion 6c dé bon fens, ne s’arrêtoient qu’à l’écorce, 6c ne pouvoient
rien goûter que les écrivains de l'ancienne Rome 6c de l’ancienne .Grece.
Ainfi ils avoient un iouverain mépris pour les écrits du moïen âge, 6c
comptoient que l’on avoit tout perdu, en perdant la pure latinité 6c la
politeffe des anciens. Ce préjugé pafla aux proteftans, qui regardoient le
renouvellement des études, comme la iource de leur réformation. Ils
Tome X I IL e