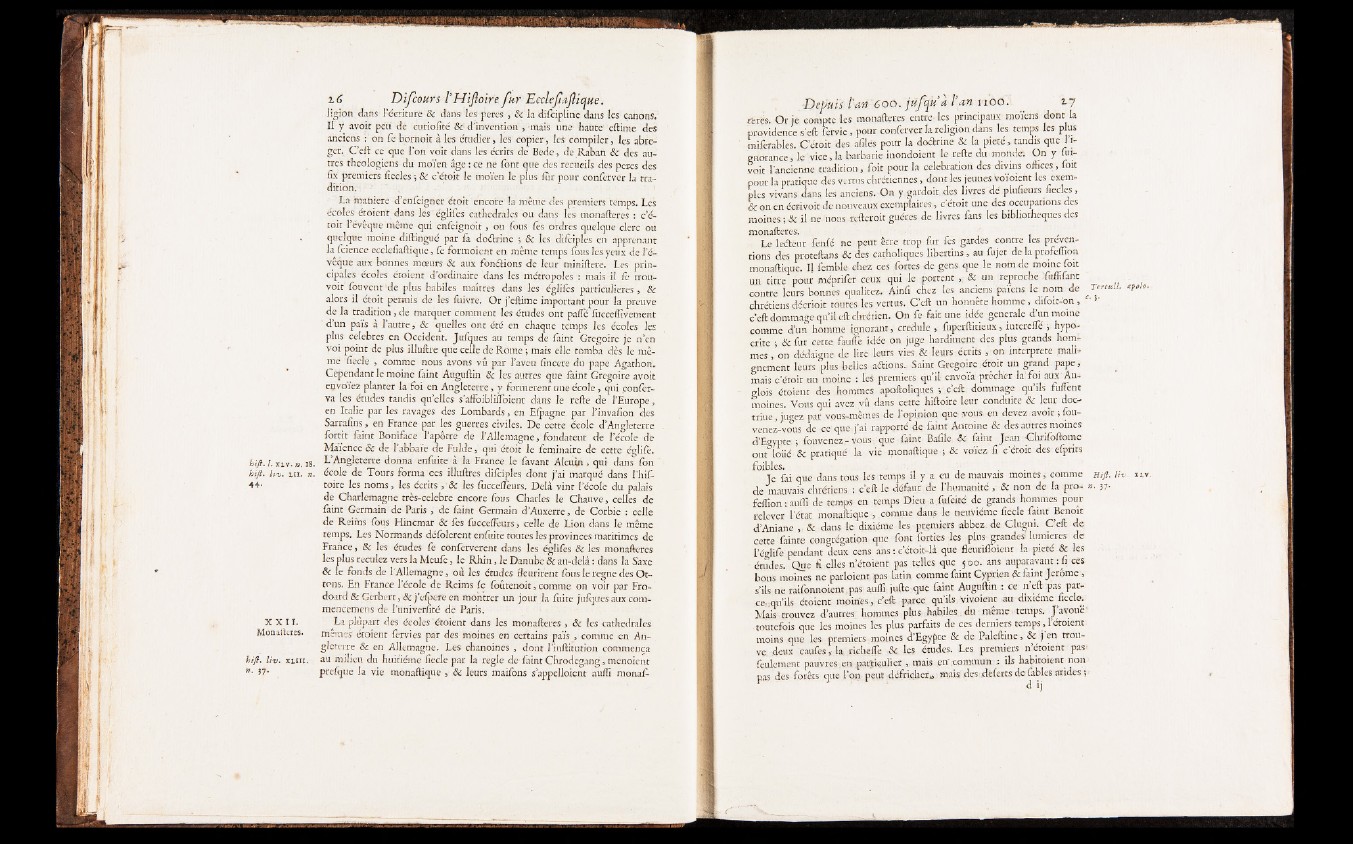
hift. I. XLV. ». 18.
hift. h v . LH. ».
44-
X X I I .
Monafteres.
hift. liv . XLIII.
». 57.
2.6 Difcours tHifloire fur Eeclejîafiime.
ligiôn dans l’éeriture & dàiis- les perèS y & ' la difeipline dans les canons.
Il y avoit peu dé 'curiofîté & rd’inventioii!> ;màis une; haute' eftime des
. anciens on fe bprtioit-à lés étudier, les copier, les'compiler, les abréger.
.Celt ce que l ’on voit dans les'écrits de Bede, de Raban & des autres
théologiens du moïeti âge : ce ne font que des recueils dés peres des
Sx premiers fiecles; & c’etoit le inoïen le plus lùr pour conforver la tradition.’
:'
' Ea inahieré-d’enfeignër étoit encoie la même des premiers' témps. Les
écoles ésoient dans les églifes cathédrales ou dans les monafteres : c’é-
toit rëvêque même qui enfeignoit, ou fous fes ordres quelque clerc oit
quelque moine diftingué par fa doârine ; & les difciples en apprenant
la fcience ecclelîaftique, fe formoient en même temps fous les yeux de 1 eê.
vèqtie aux bonnes moeurs & aux fondions de leur miniftere. Les principales
écoles étoient d’ordinaire dans lés métropoles : mais ii fo trou-
voit fouventde plus habiles maîtres dans les églifes particulierès, &
alors il étoit permis de les fuivre. Or j’eftiffie important pour la preuve
de la tradition, de marquer comment les études ont paffe fucceffivement
dun pais a l’autre, & quelles ont été en chaque temps les écoles les
plus célébrés, en Occident. Julques au temps de làint Grégoire je n’en
voi point de plus illttitre que celle de Rome ; mais elle tomba dès le même'lîecle
, comme nous avons vû par l’aveu lîncere du pape Agathori.
Cependant le moine laint Auguftin & les autres que faint Grégoire avoit.
eu voïcz planter la foi en Angleterre, y formèrent une école, qui ponfor-
va les études tandis qu’elles s’afFoibüffoient dans le relie de l’Europe,
en Italie par les ravages des Lombards, en Elpagne par l’inyafion des
Sarralïns, en France par les guerres civiles. De cette école d’Angleterre
fortit làint Boniface l’apotre de l’Allemagne, fondateur de l’école dé
Màiénce & de l’abbaie de Fulde, qui étoit le luminaire de cette églifo.
L’Angleterre donna enfuite à la France, le favant Alcuin, qui dans fon
école de Tours forma ces illüftres difciples dont j’ai marqué dans fhif-
toire les noms, les écrits“,' & les fucceflèurs. Delà vint l’écoîè du palais
de Çharlemagne très-celebre encore fous Charles le Chauve, celles de
faint Germain de Paris , de faint Germain d’Auxerre, de Corbie : celle
de Reims fous Hincmar & fes fuccelîèursp celle dé Lion dans le même
temps. Les Normands défolerent enfoite toutes les provinces maritimes de
France, & les études fe conlèrverent dans les églifes & les monafteres
les plus reculez vers la Meufe, le Rhin, le Danube & au-delà : dans la Saxe
& le fonds de l’Allemagne, ou les études fleurirent fous le regne des Ot-
tons. En France l’école de Reims le foûtenoit, comme on voit par Fro-
doard & Gerbert, & j’efperé en montrer un jour la foire jufques aux com-
mencemens de 1 univer/ité dé Paris.
La plupart des écoles "étoient dans les monafteres , & les'cathédrales
memes1 étoient forvies par des moines en certains pais , coitime en Angleterre
& en Allemagne. Les chanoines, dont l’inftitution commença
au milieu du huitième fiecle par la réglé de faint Chrodegang, menoient
prelque la vie monaftique , & leurs maifons s’appelloient auffi monaf-
-Depuis l'on 6 o o . jùfqu a tan r ioó. "e
térës. Or je eofopte. les monafteres, entre-les principaux moïens. dont la
providence s’eft forvie, pour conferverlareligion dans les. temps les plus
miierables. C ’etoit des aillés pour la docfcrifte & la piete, tandis que 1 1-
gridrapce, le'ivice, la barbarie inondoient le refte du -mondes On y fui-
yoit l’ancienne tradition,; fpit.pour la célébration des divins offices., fott
pour la pratique des vertus chrétiennes, dont Jés, jeunes Voïoient les exem-
pies vi vau s dans les anciens. On y gardoit, des livret dé pluiieurs iiecles,
& on en écrivoit de nouveaux exemplaires , c étoit une des occupations des
moines -, & il n e iious refteroit guéres de livres fans les bibliothèques des
monafteres. : . . Í. \ >
Le ledéur fenie ne peut être trop fur íes gardés contre les prevem
tions des proteftans & des catholiques libertins j au iu jet de la profciîion
monaftique. IJ fembleehez ces'fortes de gens,que le nomde moinefoit
un titre pour méprifer ceux qui le portent ,¿ ôc un reproche -faftifant .
contre leurs bonnes qualités Ainfi chez les anciens païens le nom de TermU, apio,
chrétiens décrioit toutes les vertus. C ’eft un honnete homme 5 diioit-on ,
c’eft dommage qu’il eft chrétien. On fe- fait une .idée generale d’un moine
CQmmé d’un homme ignorant , credule , liipcrftitienx, iutercfïé , hypocrite
-, & fut cette, faufïè idée on juge hardiment des plüs grands homi,
mes , on dédaigne, de Uïêffieuts vies, Se,leurs , éfcuits on; iitóprete-mali*
gnement leurs plus bélles-adions.; Saint Gregoireiéfoit un grand pape»
mais-c’étoit un moine : les premiers qu’iheiiyoïa prêchèr la, foi aux An*
g i o ì - étoient : des'hommes apoftolÎques v cleft, dommage qu’ils foilent
moines. Vous qui avez ,vû dans cette hiftoire leur conduite & leur doe-
triue, jugez par vous-mêmes de l ’opinion que- VU#- en devez cavoïr ; fou-
venez-yous de ce que j'ai rapporte de ftint Antoine & dès autres moines
d’Egypte, ; fouyenszr yoùsr, que foint- Bafile, Sc., faint Jean -Clirifoftome
ont loiié ôc pratiqué' la vie monaftique -; .& voie/, li c étoit des'eiprits ■
foibles. ■
je fai que dans tous lés ¡temps il y a, eu de mauvais - moines ; comme mft. li-v. x ir .
de mauvaisichrétiens, ; c’eft le défoui de 1-hnmanité.,- & non de la .pro* ». 37-
feflîon : auffi de temps en temps Dieu a fefeité de grands hommes pour
relever lé taf monaftique. , .comme dans le neuvième fiétle faint Benoît
d’Aniane ,, & dans lé dfoiémé ¡íes-premier «bbez. de. Giugni. C ’eft, de
cette fainte congrégation, que Tont forties les plUs-grandesî lumières de
l’églife pendant deux cens ahs -.-c’étoit-là que licurilToicnr la pieté. & les
études., Que fi elles n’étoient, pas telles, que 5.00. ans 'auparavant : ii ces
bons moines ne parloient, ¡pas latin, comme faiflt Cypirien Sc làint Jerômey
s’ils ne raifonnoient,pas' aulii jufte que faint Auglffiin ; ce neft .pas parce,
jqu’ils étoient moines-,; c’eft parce qu’ils,yivoienr >au dixième ^fiecl^,
Mais trouvez d’autres; hpmmes, pllts,-habiles, du même,-temps.-^* J'avoue'
• toutefois que les moines les plus parfaits de ces derniers temps,.1 étoient,
moins que les premiers moines d’Egypte & de. Paleftine , & j en trou*
ve. deux caufes,- la richeífo Sc les études. Les premiers 11 étoient pas-
feulement pauvres .en particulier , mais en commun ; ils babitoient non
pas des forêts que l’on peut défricher., mais des .dcftrts de firbics a'rides