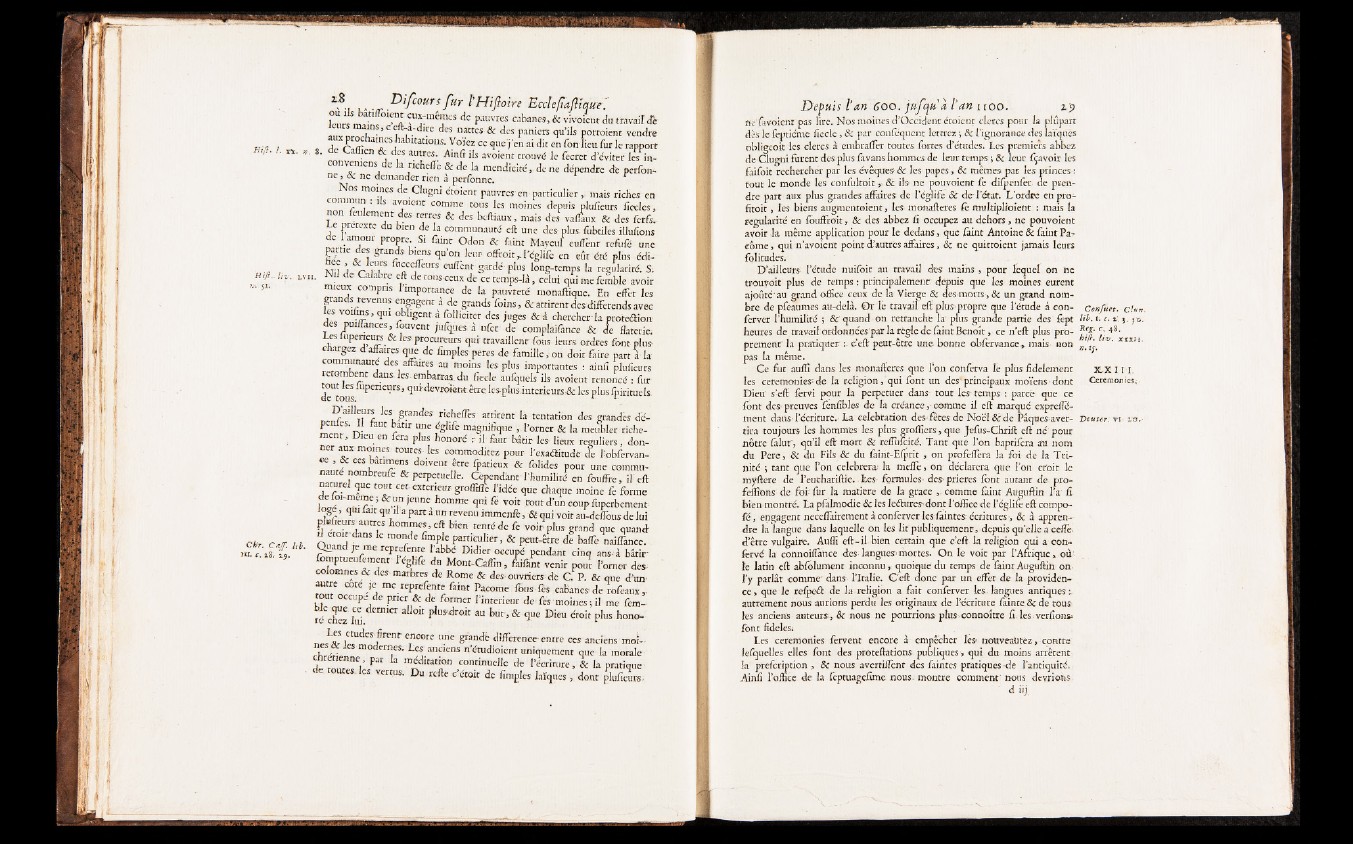
Bi{l. /. xx. n.
C h r . C a jf. h l .
K l . c . i 8. 3,5 ,
l- vr Plfcours f ur l'Hifloire EccleftafliquK
H | B eux-mêmes de pauvres cabanes, & yivoienc du travail de
aitY H i l Ü SC ü n [ C nattes- & des paniers qu’ils porroient vendre
auxprochamesliabttaaons. Voïez ce quejen ai dit en fon lieu fur le rapport
s. de Caffien & des autres. Ainfi ils avoient trouvé le fecret d’éviter les in-
convemens e la richeffê & de la mendicité, de ne dépendre cte perlón*
ne , & ne demander rien à peifonne.
Nos moines de Clugni étoient pauvres en particulier,. mais riches-en
commun : -ils avoient comme tous les moines depuis plusieurs fiecles,
non feulement des-terres & des beftiaux, mais des vaflLx & des ferfs..
e pretexte du bien de la communauté eft une des plus, fubtiles illufioris
de 1 amour propre. Si faint Odon & faint Mayeul eulTent réfufé-une
i Ü B Í I granr S ^ns quon lc™ °ftoit^l'églife en eût été plus H
M-, j, M m S “ ef aits euffent gardé plus long-remps la regulariré. S:
Nil de- Calabre eft de tous.ceux de ce remps-là, celui qui me femble avoir
mieux compris 1 importance de la pauvreté monaftique. En effer les
p n d s revenus enragent ¿ de grands foins, & attirent desdifferends avec
es voilins, qui obligent a folliciter des juges & à chercher la proreétion-
des puiflances, fouvenr juiques-à ufer de complaifance & de flaterie.
Les lupeneurs & les.procureurs qui travaillent fous leurs: ordres font plus
chargez daffaires que de limpies peres de famille,on doit faire part à la
communauté des affaires au moins les plus importantes : ainfi plufieurs
retombent dans les. embarras, du fiecle aufquels ils avoient renoncé : fur
derou* nCl-rS’ ftur ‘'hvroient. être lesphis-.interieurs,&.les plus fpirituek
ks^ grandes richeffes attirent la tentation des grandes dépendes.
II faut batir une églife magnifique „ l ’omer & la meubler richement,
Dieu en fera plus honoré r il four bâtir les lieux réguliers , donner
aux- manes: routes- les oemmoditez pour l'exa&itudè de Pobfervan-
*e f i “ S batimens do1Veut être fpatieux & folides pour une communauté
nombreufe & perpetuellë. Cèpendànr l’humilité en fouffre, i f eft
naturel que tout cet, exteneur grofliffe l’idée que chaque moine fe forme
de 101-meme ; & un jeune homme qui fe voit rout d’un coup fuperbement
ogé, qui fait qu il a part a.un revenu immenft, 8î qui voit au-deffousde lui
plufieurs autres hommes , eft bien tenté de fe voir plus grand que quand
d etoit-dans le monde /impie partiailier, & peut-être de baffemiffance
Quan je me reprefente l’abbé Didier occupé pendant cinq ans- à bârir
íomptueufement 1 cgtife du Mont-Caffin, fai/Snt venir pour l’orner des
colomnes & des marbres de Rome & des ouvriers'de G. P. & que d’un'
autre cote je me reprefente faint Pàcome fois-lès cabanes de rofeaux
tout occupe^ de prier & de former I’inrerieur de<fès moines-, il me fem-
ré chez hû plusdroit au but, & que Dieu étoit plus honor
e r Ü m I h encore «ne g«ndé différence-entre ces'anciens moines
«: les modernes. Les anciens n’étudioient uniquement que la morale
chrétienne, par la méditation continuelle de l’écriture, & la pratique
de toutesles vertus. Du reftè c’étoit de Amples laïques, dont plufieurs.
Depuis l'an 600. jufqua l’an 1100. 2.9
fie favoient pas lire. Nos moines d ’Occidentétoient clercs pour la plûpart
dès le feptiéme fiecle, & par conféquent lettrez ; & l’ignorance des iaïqûes
obligeoit les clercs à embraflèr toutes fortes d’études. Les premiers abbez
deClügni forent des plus là vans hommes de leur temps ;& leur fçavoir les
faifoit rechercher par les évêques & les papes, & mêmes par les princes-:
tout le monde les confulroit,. & ils ne pouvoient fe dilpenfer de prendre
part aux plus grandes affaires de l’églife & de- l ’état. L ’ordre en pro-
fitoic, les biens augmentoient, les monafteres fe multiplioient : mais la
régularité en fouffroit, & des abbez fi occupez au dehors, ne pouvoient
avoir la même application pour le dedans, que làint Antoine & làint Pa-
côme, qui n'avoient point a autres affaires, & ne quittoient jamais leurs
folitudes.
D’ailleurs; l ’étude nuifoit au travail des mains , pour lequef on ne
trouyoit plus de temps : principalement depuis que les momes eurent
ajoûté au grand office ceux de la Vierge & des morts , & un grand nombre
de pfèaümes aü-delà. Or'Ie travail eff'plus- propre que l'étude à- eon-
ferver l ’humilité ; 8c quand on retranche la plus grande partie des fept
heures de travail ordonnées par la régie de làint Benoît » ce n’eft plus proprement"
la pratiquer,' rieft peut-être une- bonne obfervance* mais, non
pas la même.
Ce fut auffi dans les monafteres que l ’on conforva Iè pliis fidelement
les cérémonies:de la religion, qui font un des*principaux moïensdont
Dieu’ s’efï fervi pour la perpétuer dans- tour les- temps : parce que ce
font des» preuves ftnfibles de la créance,-comme il eft marqué expreile-
ment dails-l’écriture. La célébration des* fêtes de Nqél&rde Pâqùes -aver-
rira toujours les hommes les phis greffiers, que jefus-Chrift eft né pour
nôtre falut', qu’il eft mort & reffufeité. Tant, que l’on baprifora au nom
du Pere, & du Fils & du fàirit-Efprit , on profeflêra la foi de la Trinité
; tant que l ’on célébrera-- la meffe, on' déclarera que l’on ctoir le
myftere de l ’euchariftie. Les formules- des» prières font autant de pro-
feffions de foi: fur la matière de la grâce „ comme faint Auguftin Pa fî
bien montré. La piàlmodie & les Ieâures»dont l ’office de Péglife eft compo-
f é , engagent neceflàirement à conferver les fàintes écritures -, & à apprendre
la langue dans laquelle on les lit publiquement*,,depuis qu'elle a cefïè-
d’être vulgaire. Auffi e ft- il bien certain que c’eft la religion qui a con-
fervé la connoiflànce des langues, mortes. On le voit pat l’A frique, où:
lé latin eft abfolument inconnu, quoique du temps de fainr Auguftin on
l ’y parlât comme" dans l’Italie. G’eft donc par un effet de la providence
, que le relpeéi: de la religion a fait conferver les, langues antiques 1
autrement nous aurions perdu les originaux de Pécriture fainte & de tous
les anciens auteur», & nous ne pourrions! plus connoître f ile s , ver fions,
font fidèles.
Les cérémonies fervent encore à empêcher les* nouveatirèz, contre
lèfquelles elles font des proteftâtions publiques, qui du moins arrêtent
la prefeription , & nous avertifîènr des faintes pratiques-de l’antiquité.,
Ainfi l’office de la feptuagefime nous, montre comment nous devrions
d iij
Confiiet. C lu n ,
l ih . ï; c . t-, j . j© ,
R eg. 4 8 .
h ifr . l i v . x x x i 1.
n.i?.
X ,X I I I.
Cérémonies;*
D tu te r ; v i- z'g *-