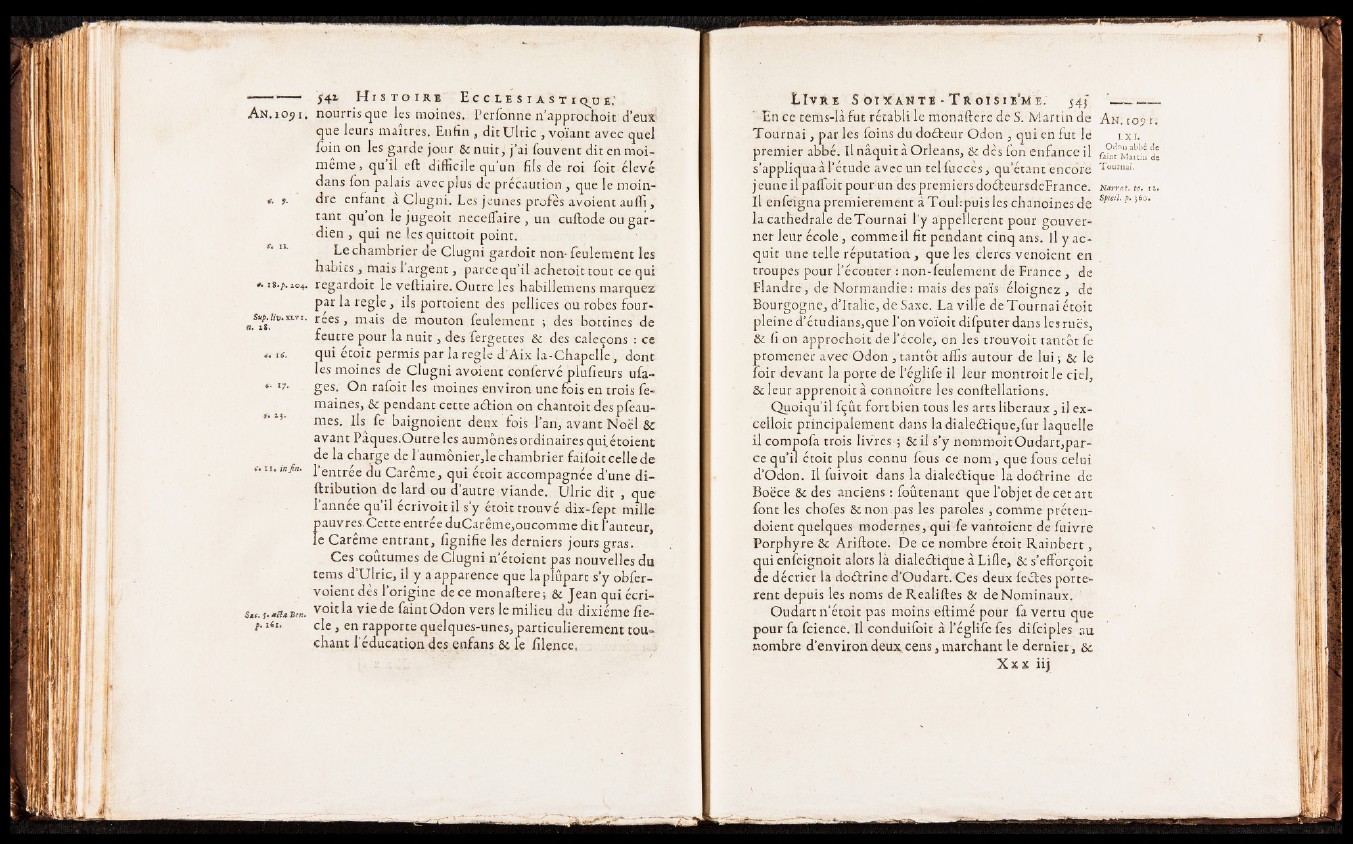
----------- S4l H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e . 1
A n .io ^ i. nourris que les moines. Perfonne n’approchoit d’eux
que leurs maîtres. Enfin , dicUlric ,vo ïan t avec quel
foin on les garde jour & nuir, j ’ai fouvent dit en moi-
m em e , qui i eft difficile qu’un fils de roi foit élevé
dans Ion palais avecplus de précaution , que le rnoin-
t. y. dre enfant a Clugni. Les jeunes profès avoient auffi,
tant qu’on le jugeoit neceflaire , un cuftode ou gardien
, qui ne lesquittoit point.
Lechambrier de Clugni gardoit non-feulement les
habits , mais 1 argent, parce qu’il achetoittout ce qui
*.!«./>. «4. regardoit le veftiaire. Outre les habillemens marquez
par la re g ie , ils portoient des pellices ou robes four-
ré e s , mais de mouton feulement des bottines de
feutre pour la n u it , des fergettes 2c des caleçons : ce
f. 16. qui étoit permis par laregle d’Aix la-Chapelle, dont
les moines de Clugni avoient confervé plufieurs ufa-
*• *?i ges. On rafoit les moines environ une fois en trois fe-
maines, 2c pendant cette aôtion on chantoit des pfeau-
mes. Ils fe baignoient deux fois l’an, avant Noël Sc
avant Pâques.Outre les aumônes ordinaires quiétoienc
de la charge de l'aumônier,lechambrier faiioit celle de
| infn' l’entrée du Carême, qui étoit accompagnée d’une di-
ftribution de lard ou d’autre viande. Ulric dit , que
l’année qu’il é c rivoitil s’y étoit trouvé dix-fept mille
pauvres.Cette entrée duCarême,oucomme dit l’auteur,
le Carême entrant, fignifie les derniers jours gras.
Ces coutumes de Clugni n’étoient pas nouvelles du
tems d'Ulric, il y a apparence que la plupart s’y obfer-
voient dès l'origine de ce monaftere ; & Jean qui écri-
voit la viede faintOdon vers le milieu du dixième fie-
t■ cle , en rapporte quelques-unes, particulièrement tou«
chant l ’éducation des enfans & le iïlence,
E I v r e S o ï x a n t e - T r o i s i e ’m e . 545"
En ce tems-là fut rétabli le monaftere de S. Martin de
T o u rn a i, par les foins du doéteur Odon , qui en fut lè
premier abbé. Il naquit à Orléans, 2c dès ion enfance il
s’appliqua à l’étude avec un teliuccès, quêtant encore
jeune il paiToit pour un des premiers doôteursdeFrance.
Il enfeigna premièrement à Toubpuis les chanoines de
la cathédrale deTournai l ’y appellerent pour gouverner
leur é co le , comme il fit pendant cinq ans. il y acquit
une telle réputation, que les clercs venoient en
troupes pour l’écouter : non-feulement de France , de
Flandre, de Normandie: mais des païs éloignez , de
Bourgogne, d’Italie, de Saxe. La ville de Tournai étoit
pleine d’étudians,que l ’on voïoit difputer dans les rues,
& il on approchait deTécole, on les trouvoit ratitôt fe
promener avec Odon , tantôt aftîs autour de lui ; 2c le
loir devant la porte de l’églife il leur momroitle ciel,
&Ieur apprenoit à connoître les conftéllations.
Quoiqu’il fçût fort bien tous les arts libéraux, il ex-
celloit principalement dans ladialeètique,fur laquelle
il compofa trois livres ; & il s’y nommoitOudart,parce
qu’il étoit plus connu fous ce nom, que fous celui
d’Odon. Il fuivoit dans la dialeètique la doètrine de
Boëce 2c des anciens : foûtenant que l’objet de cet art
font les chofes 2c non pas les paroles, comme préten-
doient quelques modernes, qui fe vantoient de fuivre
Porphyre 2c Ariftote. De ce nombre étoit Rainbert,
qui enfeignoit alors là dialectique à Lifle, 2c s’efforçoit
de décrier là doètrine d’Oudart. Ces deux feétes portèrent
depuis les noms de Realiftes & de Nominaux.
Oudart n’étoit pas moins eftimé pour fa vertu que
pour fa fcience. Il conduifok à l’églife fes difciples au
nombre d’environ deux, cens, marchant le dernier, 2c
LXI.
Odon,abbé de
iamt Martin de
Tournai,
Narrai, to. i z .
Spicil. p> 560.