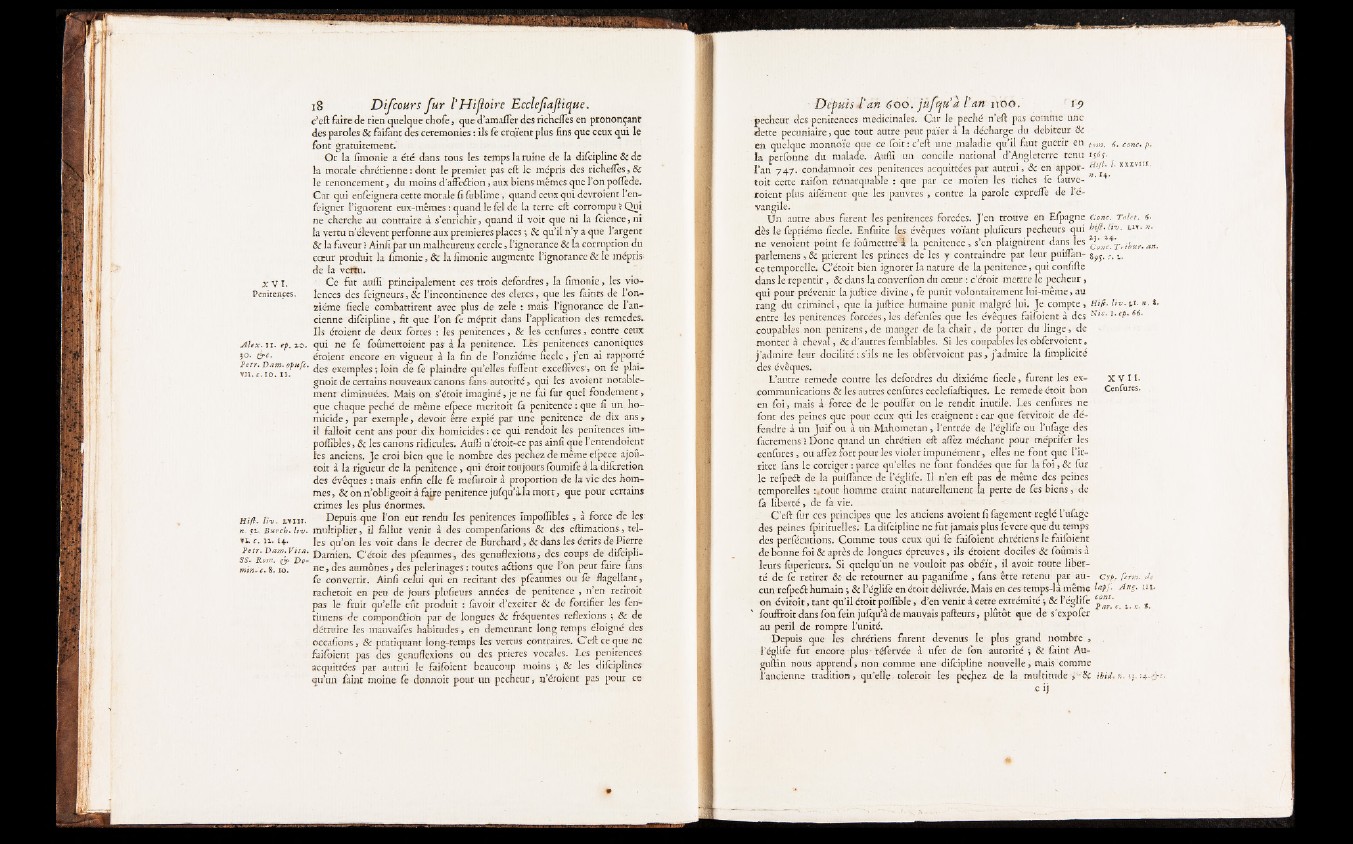
XVI .
Penitences.
A l e x . i l . ep. z o .
30. é'C.
P e tr . Dam. opufc.
vil. c. 10. 11,
c’eft faire de rien quelque chofe, que d’amafler des richefies en prononçant
des paroles & faifànt des cérémonies : ils fe crqïenc plus fins que ceux qui le
font gratuitement.
Hifi* liv. LVXII.
». 5'ïx Burch. /*•*/.
V I . C. I I . 1 4 .
P^ir. Dæ/». Vita.
S S . Rom. & D o -1
min.-c. 8.10.
Or la fimonie a été dans tous les temps la ruine de la difeipline & de
la morale chrétienne : dont le premier pas eft le mépris des rïchefïès, &
le renoncement, du moins d ’affeétion, aux biens mêmes que l’on pofïède.
Car qui enfeignera cette morale fi fublime, quand ceux qui devraient l’en-
feigner l’ignorent eux-mêmes : quand le fel de la terre eft corrompu ? Qui
ne cherche au contraire à s’enrichir, quand il voit que ni la fcience, ni
la vertu n élevent perfonne aux premières places 3 8c qu’il n’y a que l’argent
8c la faveur ? Ainfi par un malheureux cercle, l’ignorance 8c la corruption du
coeur produit la fimonie, & la fimonie augmente l’ignorance 8c le mépris
de la veîfu.
Ce fut auiïï principalement ces trois defordres, la fimonie, les violences
des feigneurs, 8c l’incontinence des clercs, que les fâints de l ’on-
ziéme fiecle combattirent avec plus de zele : mais- Pignorance de l'ancienne
difeipline, fit que l ’on fe méprit dans l’application des remedes,.
Ils étoient de deux fortes : les penitences, 8c les cenfures , contre ceux
qui ne fe foûmettoient pas à la penitence. Lès penitences canoniques
étoient encore en vigueur à la fin de l’onzième fiecle, j’en ai rapporté
des exemples 3 loin de fe plaindre qu’elles fuiTent exceilîves-, on fe plai-
gnoit de certains nouveaux canons fans, autorité, qui les avoient notablement
diminuées. Mais on s’éroit imaginé, je né fai fur quel fondement,
que chaque péché de même efpece meritoit fa penitence : que fi un homicide
, par exemple, devoit être expié par une penitence de dix ans y
il falioit cent ans pour dix homicides : ce qui rendoit les penitences im-
poilibles, 8c les canons ridicules. Aufii n’étoit-ce pas ainfi que l’enrendoient
les anciens. Je croi bien que le nombre des pechez de même efpece ajourait
à la rigueur de la penitence, qui étoit toujours foumife à la diferetion
des évêques : mais enfin elle fè mefuroit à proportion de la vie des hommes
, 8c on n’obligeoit a faÿe penitence jufqu’àla mort, que pour certains
crimes les plus énormes.
Depuis que l ’on eut rendu les penitences inipofiibles , à force de les
multiplier, il fallut venir à des compeniàtions & des eftimations-, telles
qu’on les voir dans le décret de Burchard, & dans les écrits de Pierre
Damien. C ’étoit des pfeaumes, des génuflexions, des coups de difeipline
, des aumônes, des pèlerinages : toutes aérions que l’on peut faire fans
fe convertir. Ainfi celui qui en récitant des pfeaumes ou fe flagellant,
radierait en peu de jours plufieurs années de penitence , n’en retirait
pas le fruit qu’elle eût produit : favôir d’exciter 8c de fortifier les fen-
rimens- de componério'n par de longues 8c fréquentes reflexions. 3 8c de
détruire les mauvaifes habitudes, en demeurant long temps éloigné des
occafions, & pratiquant long-temps les vertus contraires, C ’eft ce que ne
faifôient pas des génuflexions ou des prières vocales. Les penitences
acquittées par autrui le faifôient beaucoup moins 3 8c les difciplines
qu’un faint moine fe donnoit pour un pecheur, n’é/oient pas pour ce
pecheur des penitences médicinales. Car le peehé n’eft pas comme une
dette pecuniaire, que tout autre peut païer à la décharge du débiteur 8c
en quelque monnoïe que ce foit : c’eft une maladie qu’il faut guérir en tnm. 6. conc. p.
la perfonne du malade. Aufii un concile national d’Angleterre tenu 1
l ’an 7 4 7 . condamnoit ces penitences acquittées par autrui, 8c en appor- XX?VÎII‘
toit cette raifon remarquable : que par ce moïen les riches fe fauve-
roient plus aifément que les pauvres , contre la parole exprefiè de l’évangile.
Un autre abus furent les penitences forcées. J ’en trouve en Efpagne Conc. Tolet. 6.
dès le feptiém© fiecle. Enfuite les. évêques voïant plufieurs pecheurs qui itv- LIY- n'
ne venoient point fe foûmettre'% la penitence, s’en plaignirent dans les an
parlemens, 8c prièrent les princes de les y contraindre par leur puiflan- 895. c. t.
cç temporelle. C ’étoit bien ignorer la nature de la penitence, qui confifte
dans le repentir, & dans la converfion du coeur : c’étoit mettre le pecheur,
qui pour prévenir la juftice divine, fe punit volontairement lui-même, au
rang du criminel, que la juftice humaine punit malgré lui. Je compte, Hifi. liv .1.1. n.
entre les penitences forcées , les défenfes que les évêques faifôient à des Niir‘ l ' eP‘ 66'
coupables non penitens, de manger de la chair, de porter du linge, de •
monter à cheval, 8c d’autres femblables. Si- les coupables les obfervoient,
j ’admire leur docilitéls’ils ne les obfervoient pas, j ’admire la fimplicité
des évêques.
L’autre remede contre les defordres du dixième fiecle, furent les ex- X V I I *
communications 8c les autres cenfures ecclefiaftiques. Le remede étoit bon Cenfures.
en foi -, mais à force de le poufièr on le rendit inutile. Les cenfures ne
font des peines que pour ceux qui les craignent : car que ferviroit de défendre
à un Juif ou à un Mahometan, l ’entrée de l’églife ou l’ufage des
facremensî Donc quand un chrétien eft afiez méchant pour méprifer les
cenfures, ou afiez fort pour les violer impunément, elles ne font que l’ir-t
riter fans le corriger : parce qu’elles ne font fondées que fur la fo i , 8c fur .
le refpeâ de la puiiîànce de l ’églife. Il n’en eft pas de même des peines
•temporelles :,tout homme craint naturellement la perte de fes biens de
fa liberté , de fa vie.
C ’eft fur ces principes que les anciens avoient fi iâgemenr réglé l ’ufage
des peines' fpirituellesi La difeipline ne fut jamais plus fevere que du temps
des perfécutions. Comme tous ceux qui fe faifôient .chrétiens le faifôient
de bonne foi & après de longues épreuves, ils étoient dociles’ & foûmis a
leurs fuperieurs. Si quelqu'un ne vouloir pas obéir, il avbit toute liberté
de fe retirer & de retourner au paganifme , fans être retenu par aù- cyp, firm. Je
cun refpeét humain ; & l’églife en étoit délivrée. Mais en ces temps-là même l*tJ- A“g- UI-
on évitoit, tant qu’il étoit poflible, d’en venir à cette extrémité ; & l’églife c^ "r 'c K t
' fouffroit dans fou fein jufqu’à de mauvais pafteurs, plutôt que dè s’expofer
au péril de rompre l’unité.
Depuis que les chrétiens furent devenus le plus grand nombre ,
l ’églife fut encore plus-'réfervée à ufer de fan autorité ; & faint Au-
guiiin nous apprend s non comme une difeipline nouvelle, mais comme
l ’ancienne tradition, qu'elle coleroit les pecjiez de la multitude ibU. ». »3.
c i j