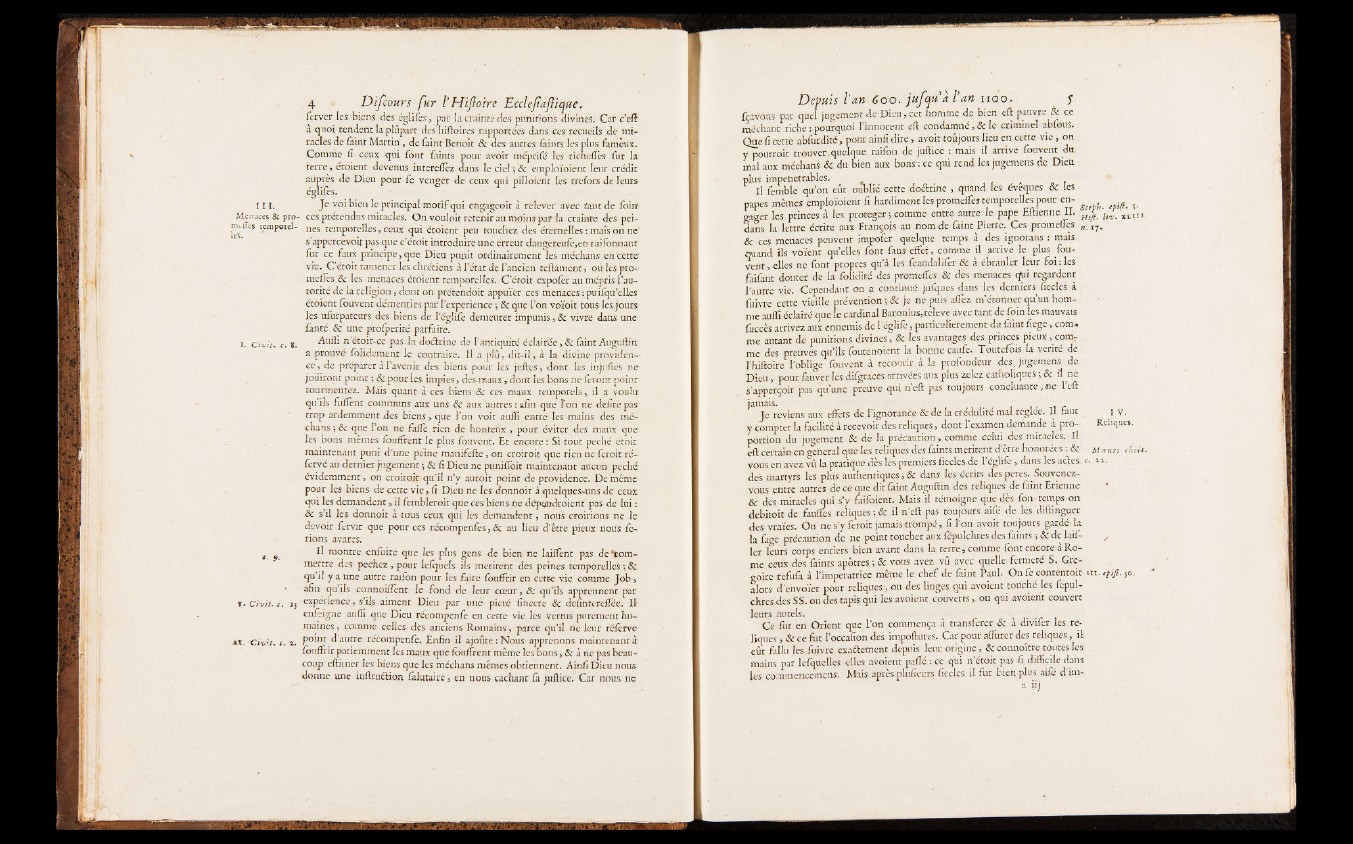
ierver les biens des églifes, par la crainte des punitions divines. Car c’efî
a quoi tendent la plupart des hiftoires rapportées dans ces recueils de miracles
de iàint Martin , de iaint Benoît & des autres faints les plus fameux.
Comme fi ceux qui font faints pour avoir meprifé les richeiles fur la
terre, étoient devenus intereflez dans le ciel •, & emploïoient leur crédit
aiipres de Dieu pour fe venger de ceux qui pilloient les trefors de leurs
égliies.
I I I . Je V°1 ble11 le principal motif qui engageoit à r'elevei' avec tant de ioiiï
Menaces & pro- ces prétendus miracles. On vouloir retenir au moins parda crainte des pei-
mu es temporel- lîes temporelles, ceux qui étoient peu touchez des étemelles : mais on ne
s’appercevoir pas que c’étoit introduire une erreur dangereufe,en raisonnant'
fur ce faux principe,que Dieu punit ordinairement les méchans encette:
vie. C ’étoit ramener les chrétiens à l’état de l’ancien teftament, où les pro-
méfiés 8c les menaces étoient temporelles. C ’étoit expoièr au mépris l’autorité
de la religion, dont on prétendoit appuïer ces menaces : puisqu'elles'
étoient Souvent démenties par l’experience *, & que l’on voïoit tous les jours
les ufurpateurs des biens de leglife demeurer impunis,8c vivre dans une
fanté & une proiperité parfaite,
x. civit. c. 8. Audi nétoit-ce pas la doétrine de l’antiquité éclairée, & faint Auguiîin
a prouvé folidement le contraire. Il a plu, dit-il, à la divine providence,
de préparer à l’avenir des biens pour les juftes, dont lés injnfies ne
jouiront point ; 8c pour les impies, des maux, dont les bons ne feront point
tourmentez. Mais quant à ces biens 8c ces maux temporels., il a voulu
qu’ils fuflent communs aux uns 8c aux autres : afin que Fon ne defirepas
trop ardemment des biens,que l’on voit auflî entre les mains des méchans
•, 8c que l’on ne fafiè rien de honteux , pour éviter des maux que
les bons memes Souffrent le plus Souvent. Et encore : Si tout peché étoit
maintenant puni d’une peine manifefte, on croiroit que rien ne feroit ré-
fervé au dernier jugement ; 8c fi Dieu ne puniiloit maintenant aucun peché
évidemment, on croiroit qu’il n’y auroit point de providence. De même
pour les biens de cette vie, fi Dieu ne les donnôit à quelques-uns de ceux
qui les demandent, il fembleroit que ces biens ne dépondroierit pas de lui :
& s il les donnoit à tous ceux qui les demandent, nous croirions ne le
devoir Servir que pour ces récompenfès, 8c au lieu d’être pieux nous ferions
avares.
$ * Il montre enfuite que les plus gens de bien ne laiflent pas de Commettre
des pechez, pour lefquels ils méritent des peines temporelles •, 8c
qu il y a une autre raifon pour les faire fouffrir en cette vie comme Job,
afin qu ils connoiiïènt le fond de leur coeur, 8c qu’ils apprennent par
expérience , s’ils aiment Dieu par une pieté fincere 8c defintereflêe. Il
enieigne auflî que Dieu récompenfe en cette vie les vertus purement humaines,
comme celles des anciens Romains, parce qu’il ne leur réiefve
point d autre récompenfe. Enfin il ajoute : Nous apprenons maintenant a
fouffrir patiemment les maux que Souffrent même les bons, & à ne pas beaucoup
cftimer les biens que les méchans mêmes obtiennent. Ainfi Dieu nous
donne une inftru&ian falutaire, en nous cachant fa juflice. Car nous ne
V. C iv it. c.
X X . C iv it . c.
fçjtvons pat quel jugement de Dieu?cet horume de bien eft pauvre 8c ce
méchant riche : pourquoi l’innocent eft condamné , 8c le criminel abfous.
Que fi cette abfurdité, pour ainfi dire, avoit toujours lieu en cette vie, on
y pourroit trouver,quelque railon de juftice : mais il arrive fouvent du
mal aux méchans & du bien aux bons : ce qui rend les jugemens de Dieu
plus impénétrables. . .
Il femble' qu’on eût oublié cette doiltine , quand les éveques & les
papes mêmes emploïoient fi hardiment les promelles temporelles pour en- ^ ;
gager les princes à les protéger ; comme entre autre le pape Eftienne II. XLIII.
dans la lettre écrite aux François au nom de iàint Pierre. Ces promeffes „ ,7.
& ces menaces peuvent impofer quelque temps à des ignorans ; mais
quand ils voient qu’elles font fans effet, comme il arrive le plus fou-
vent, elles ne font propres qu’à les feandalifer & à ébranler leur foi : les .
faifant douter de la folidité des promelies & des menaces q*ii regardent
l ’autre vie. Cependant On a continué jufques dans les derniers.: fiecles a
fuivre cette vieille prévention ; 8c je ne puis allez m’étotiner qu’un hom*
me auffi éclairé que le cardinal Baronius,televe àvec-tant dé foin les mauvais
fuccès arrivez aux ennemis de l’églife, particulièrement du faint fiege, com.
me autant de punitions divines, & les avantages des princes pieux,comme
des pteuves qu’ils ioutenoient la bonne caufè. Toutefois la vérité, de
l’hiftoire l’oblige fouvent à recourir à la profondeur des .jugemens de
Dieu, pour fauVer les difgraces arrivées aux plus zelez catholiques ; & il ne
s'apperçoit pas qu’une preuve qui n’eft pas toujours concluante, ne l’ett
jamais; - _ _ '
Je reviens aux effets de l’ignorance & de la crédulité mal reglee. Il faut i y.
y compter la facilité à recevoir des reliques, dont l’examen demande à pro- Reliques,
portion du jugement & de la précaution, comme celui des miracles. Il
eft certain en général que les reliques des faints méritent d’être honorées ; & Moeurs chrét.
vous en avez vû la pratique dès les premiers fiecles de l’églife, dausies aâes: t., ît.
des martyrs les plus authentiques, & dans les écrits des peres. Souveuez-
vous entre autres de ce que dit faint Auguftm des reliques de fiiint Erienne
& des miracles qui s’y faifoient. Mais il témoigne que dès fon-temps on
debitoit de faul&s reliques ; & il n’eft pas toujours aile de les. diftinguer
des vraies. Ori ne s’y feroit jamais trompé , .fi l’on avoir toujours gardé la
la fa»e précaution de ne point toucher aux fepulchres des faints , & de laifi* ^
1er leurs corps entiers bleu avant dans la terre , comme font encore a Rome
ceux des faints apôtres ; & vous avez vû avec quelle fermeté S. Grégoire
refufa à l’imperatrice même le chef de faint Paul. On fe contentait
alors d’envoïer pour reliques-,.ou des linges qui avoient touche les fépul-
c h r e s d e s S S . ou des tapis qui lesavoient couverts, ou qui avoient couvert
leurs autels. . . . - u t " - - . ' (
Ce fut en Orient que l'on commença à transférer- & a divifer les reliques
, & ce fut l’occafion des impoftures. Car pour alfurer des reliques , il
eût fallu les fuivre exaélement depuis leur origine, & connoître toutes les .
mains par lefquelles elles avoient paffé.: ce qui n’étoit pas fi difficile dans
les commencemens. Mais,après plufieurs fiecles il fut bien plus aifé d'im-
' " c ■ ' . ' a iij