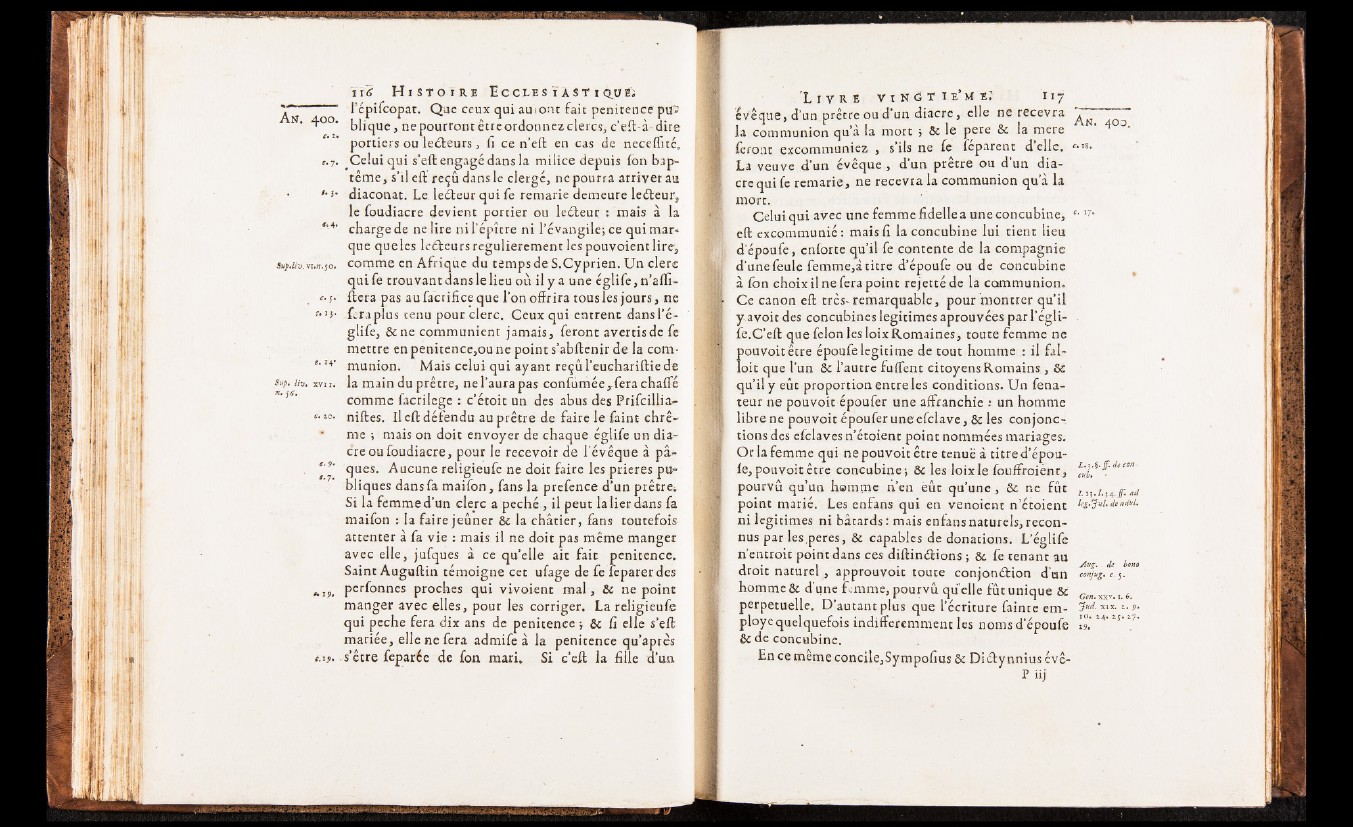
i r ? H i s t o i r e E c c l e s ï à s t i q ü e ï
Tépifcopat. Que ceux qui amonc fait penitence ptr2
. 400. Hiq u e , nepourrontêtreordonnezelercs, c’eft-à-dire
portiers ou leèbeurs, il ce n’eft en cas de neceflué,
r.7. Celui qui s’eft engagé dans la milice depuis fon baptême,
s’il eft reçu dans le clergé, ne pourra arriver au
'• É diaconat. Le. leéteur qui fe remarie demeure leèteur,
le foudiacre devient portier ou leèteur : mais à la
"'A' charge de ne lire ni Tépîcre ni l’évangile; ce qui marque
que les leéteurs regulierement les pouvoient lire,
suf.Uv.yi.tt.so. comme en Afrique du temps de S.Cyprien. Un clerc
qui fe trouvant dans le lieu où il y a une é g l i fe , n’affi-
c. y. ftera pas au facrifice que l’on offrira tous les jours, ne
P<,3- fora plus tenu pour clerc. Ceux qui entrent dans l’é glife,
Sene communient jamais, feront avertis de fe
mettre en penitence,ou ne point s’abftenir de la corn-
t,I+’ munion. Mais celui qui ayant reçu l’euchariftie de
su/>. uv. xYir. la main du prêtre, ne l’aura pas confumée„fera chafle
comme facrilege : c’étoit un des abus des Prifcillia-
c. 10. niftes. Il eft défendu au prêtre de faire le faint chrême
; mais on doit envoyer de chaque églife un diacre
ou foudiacre, pour le recevoir de l ’évêque à pâ-
eA' ques. Aucune religieufe ne doit faire les prières publiques
dans fa maifon , fans la prefence d’un prêtre*
Si la femme d’un clerc a péché , il peut la lier dans fa
maifon : la faire jeûner 8c la châtier, fans toutefois-
attenter à fa vie : mais il ne doit pas même manger
avec elle, jufques à ce q u e l le ait fait penitence.
Saint Auguft in témoigne cet ufage de fe feparerdes
perfonnes proches qui vivoient m a l , & ne point
manger avec elles, pour les corriger. La religieufe
qui peche fera dix ans de penitence ; 8c fi elle s’eft
mariée, elle ne fera admife à la penitence qu’après
f.ij». - s’être feparée de fon mari. Si c’eft la fille d’un
L i v r e v i h g t u ’ m i : 117
é v êq u e , d’un prêtre ou d’un diacre, elle ne recevra
la communion qu’à la mort ; 8c le pere 8c la mere
feront excommuniez , s’ils ne fe féparent d’elle.
La veuve d’un évêque , d’un prêtre ou d’un diacre
qui fe remarie, ne recevra la communion qu’à la
mort.
Celui qui avec une femme fidelle a une concubine,
eft excommunié: mais fi la concubine lui tient lieu
d époufe, enforte qu’il fe contente de la compagnie
d’une feule femme,à titre d’époufe ou de concubine
à fon choix il ne fera point rejette de la communion.
Ce canon eft très-remarquable, pour montrer qu’il
y avoitdes concubines légitimés aprouvées parl’égli-
fe.C’eft que félonies loixRomaines, toute femme ne
pouvoitêtre époufe légitimé de tout homme : il fal-
loit que l’un 8c l’autre fuftent citoyens Roma ins , 8s
qu’il y eût proportion entre les conditions. Un fena-
teur ne pouvoir époufer une affranchie : un homme
libre ne pouvoit époufer unee fclave, 8s les conjonctions
des efclaves n’étoient point nommées mariages.
Or la femme qui ne pouvoit être tenue à titre d’épou-
ie, pouvoitêtre concubine; 8s les loix le fouffroiènt,
pourvû qu’un homrne n’en eût qu’une , 8s ne fût
point marié. Les enfans qui en venoient n ’étoient
ni légitimés ni bâcards : mais enfans naturels, reconnus
par les,peres, 8c capables de donations. L ’églife
n’entroit point dans ces diftinétions ; 8c fe tenant au
droit naturel , approuvoit toute conjonètion d’un
homme 8c d’une femme, pourvû quelle fût unique 8c
perpétuelle. D’autant plus que l’écriture fainre em-
ployequelquefois indifféremment les noms d’époufe
&c de concubine.
En ce même concile,Sympofius 8c Dièlynnius évê-
P iij
A n . 400.
C, 18.
c. 17*
de c<fït>
cub»
L ï3./.34.j(fl ad
leg.Jvl. de a dut.
Atig. - de bono
conjugt c. 5.
Gen. x xv. 1. 6.
Jud. x ix . 2. $•
10. 24. i j .
î9»