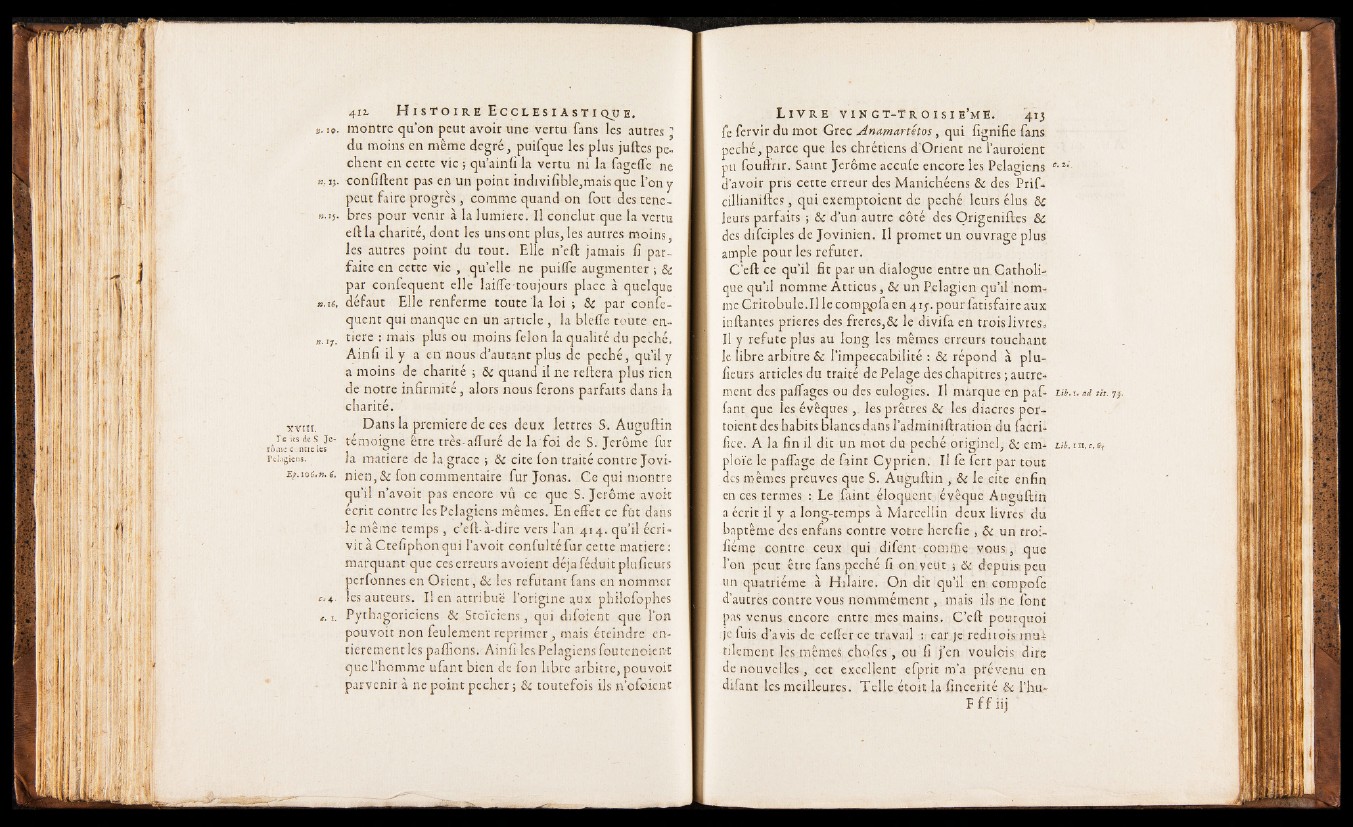
ÿ. 10.
» . I J .
» . 15.
».16,
». 17 .
X V I I I .
Te its de S Jérôme
centre les
Pelagiens.
£ / . 10 6 , n. 6 .
c< 4
t. 1.
412. H I S T O I R E Ec C L E S I A S T I QJJ E.
montre qu’on peut avoir une vertu fans les autres 3
du moins en même degré, puifque les plus juftes pèchent
en cette vie ; qu’ainfi la vertu ni la fageife ne
confiftent pas en un point indivifible,mais que l’on y
peut faire progrès, comme quand on fort des tene-
bres pour venir à la lumière. Il conclut que la vertu
eft la charité, dont les unsont plus,les autres moins,
les autres point du tout. Elle n’eft jamais fi parfaite
en cette vie , qu’elle ne puiife augmenter ; &
par confequent elle biffe-toujours place à quelque
défaut Elle renferme toute la loi ; & par confequent
qui manque en un article , la bleffe toute entière
: mais plus ou moins félon la qualité du péché.
Ainf i il y a en nous d’autant plus de péché, qu’il y
a moins de charité ; & quand il ne reliera plus rien
de notre infirmité, alors nous ferons parfaits dans la
charité.
Dans la première de ces deux lettres S. Auguftin
témoigne être très-affuré de la foi de S. Jerôme fur
la matière de la grâce ; &i cite fon traité contre Jovi-
n ien ,& fon commentaire fur Jonas. Ce qui montre
qu’il n’avoit pas encore vû ce que S. Jerôme avoit
écrit contre les Pelagiens mêmes. En effet ce fût dans
le même temps , c’eft-à-dire vers l’an 414. qu’il écrivit
à Ctefiphon qui l ’avoit confultéfur cette matière:
marquant que ces erreurs avoient déjà féduit plufieurs
perfonnes en Or ient , & les réfutant fans en nommer
les auteurs. Il en attribue l’origine aux philofophes
Pythagoriciens & Stoïciens, qui difoient que l’on
pouvoir non feulement reprimer , mais éteindre entièrement
les pallions. Ainfi les Pelagiens foutenoient
que l’homme ufantbien de fon libre arbitre, pouvoir
parvenir à ne point pecher -, &c toutefois ils n’ofoient
L i v r e v i n g t - t r o i s i e ’m e . 413
fe fervir du mot Grec Anamartétos, qui fignifie (ans
péché, parce que les chrétiens d’Orient ne l’auroient
pu fouftnr. Saint Jerôme accule encore les Pelagiens c-2'
d’avoir pris cette erreur des Manichéens & des Prif-
cillianiftes, qui exemptoient de péché leurs élus &
leurs parfaits ; & d’un autre côté des Origeniftes &c
des difciples de Jovinien. Il promet un ouvrage plus
ample pour les réfuter.
C ’eft ce qu’il fit par un dialogue entre un Catholique
qu’il nomme Ât t icus , & un Pelagien qu’il nomme
Cr i tobule.il le comppfa en 415. pour fatisfaire aux
inftantes prières des freres,& le divifa en trois livres.
Il y réfuté plus au long les mêmes erreurs touchant
le libre arbitre & l’impeecabilité : & répond à plufieurs
articles du traité de Pelage des chapitres ; autrement
des paffages ou des eulogies. Il marque en paf- ut.
fant que les évêques,. les prêtres & les diacres por-
toient des habits blancs dans l’adminiflration du facrb
fice.. A la fin il dit un mot du péché originel, & em- m .in.c.s,
ploïe le paffage de faint Cyprien. Il ie fert par tout
des mêmes preuves que S. Auguftin , & le cite enfin
en ces termes : Le faint éloquent,éyêque Auguftin
a écrit il y a long-temps à Marcellin deux livres du
baptême des enfans contre votre lierefie , & un troi-
fiéme contre ceux qui difent comme vous,, que
l’on peut être fans péché fi on veut i & depuis: peu
un 'quatrième à Hilaire. On dit qu’il en compofe
d’autres contre vous nommément , mais ils ne font
pas venus encore entre mes mains. C ’eft pourquoi
je fuis d’avis de ccffer ce trayail : car je rediiois mu4
tilement les mêmes, chofes , ou fi j’en voulois dire
de nouvelles., cet excellent efprit m’a prévenu en
difant les meilleures. Telle étoit la fincerité & l ’hu-
F f f iij